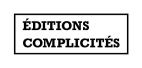L’enfant aux trois prÉnoms
Jérémie 20 : 14-18 : Qu'il soit maudit, le jour de ma naissance ! Que personne ne dise du bien du jour où ma mère m'a mis au monde !
Récit
Introduction
De tout temps des enfants ont été abandonnés à leur naissance, plus ou moins nombreux selon les époques et les lieux dans ce monde. Les accouchements secrets et l’abandon d’enfants n’ont pas été légalisés en France avant la Révolution (Catherine Villeneuve-Gokalp, chercheuse à l’Ined, dans rapport de Recherche, juin 2010). Dans notre pays, la législation n’a pas cessé d’évoluer jusqu’au 21ème siècle. Pour qui voudrait avoir un aperçu de ce phénomène, il lui serait profitable de lire L'histoire de la protection de l'enfance de Constance de Ayala, dans Le Journal des psychologues 2010/4 (n° 277).
Le présent récit pourrait-il donc ne présenter qu’une situation banale ? Si nous avons pris l’initiative de le publier, c’est que, de notre point de vue, il illustre l’abandon d’un enfant – puis le parcours chaotique de l’adulte qu’il devint – d’une classe sociale que l’on considère souvent comme exempte de ce type de conduite, puisque dans ces familles, l’honneur et l’esprit chevaleresque sont constamment invoqués, comme une incantation. En fait, il s’est agi d’une situation inhabituelle : récupéré par sa mère en 1929, à plus de huit ans, Jean avait été abandonné à la naissance comme enfant aux trois prénoms, alors que sa mère s’était mariée depuis quatre mois avec un autre homme que le géniteur. Etait-ce à l’insu du marié et de sa famille qu’elle portait cet enfant ? De plus, à travers le parcours du personnage principal, se révèlent la personnalité et leurs travers des protagonistes qui le côtoient dans son cheminement. Si nous donnons une large place au contexte social et psychologique dans lequel à l’âge de huit ans le petit Jean a été introduit, évidemment sans son consentement, c’est que ce background permet de comprendre le déterminisme dont il a été victime, et également, en aval, sa progéniture.
Les dates, les noms des personnages et des lieux sont fictifs, bien que les situations aient pu être réelles, en nous appuyant sur des échanges épistolaires, constituant la trame des dialogues.
En une lettre, tout est dit !
Gardat, le 28 mai 1954. « Chère maman, Je ne veux pas tarder davantage pour répondre à votre dernière lettre qui semble me faire comprendre que je vous ai réclamé quelque
chose et fait des reproches. Premièrement, je ne vous ai rien demandé pour ma fille sans que vous ne me disiez de vous indiquer ce qui lui manquait, que ce serait votre premier cadeau. Je vous
ai simplement dit qu’il ne lui manquait qu’une assiette à bouillie, et que si vos moyens ne vous permettaient pas de faire cette dépense, vous pouviez lui donner quelque objet personnel ou bijoux, à
votre choix, mais n’en parlons plus, gardez ce que vous avez, ma fille n’en a pas besoin, du reste on se passe plus facilement de bijoux que d’affection maternelle ou paternelle, et sous le rapport
cadeaux, elle a été comblée, et sa robe de baptême était entièrement recouverte de point d’Angleterre. Deuxièmement, si je ne vous ai point fait part de mon mariage, c’est que j’avais des
raisons. a) les parents de ma femme ne voulaient pas entendre parler de vous, étant divorcée ; cela est admis dans certains milieux, mais pas dans d’autres. Notre cousin Christian de Castro
n’a-t-il pas été tenu à l’écart par sa famille à cause de cela. b) mon abandon jusqu’à neuf ans de père et de mère inconnus. c) Les autres projets de mariage que vous avez fait casser par vos
calomnies. d) Les inepties d’hérédité syphilitique dont vous abreuviez les gens à mon sujet, que M. de C. était syphilitique et que je devais en tenir un bon coup, que j’étais anormal, etc. Vous ne
deviez pas ignorer que Jacques de C. était le fils d’un grand avocat de Paris qui était loin d’être un dégénéré. Du reste, les prises de sang que l’on a faites au moment de mon mariage sont là pour
détruire les calomnies et ma magnifique petite fille. En tout cas, ce n’était pas le rôle d’une mère d’inventer sans preuve des choses semblables. Troisièmement, votre façon d’agir depuis mon
retour d’Allemagne, disant à tout le monde que j’étais un propre à rien, en me mettant à la porte sans un sou en 1946. Votre mariage a été annulé peut-être légalement, or d’après votre correspondance
vous aimiez Eloy. Vous m’avez repris parce que mon grand-père vous le disait depuis des années et vous l’avouez dans une lettre du 30 octobre 1929, puis, parce que l’on vous avait dit qu’il
reviendrait en Livradois s’il y avait un enfant. Combien de démarches, vous, votre père et Dorgelet n’ont-ils pas faites pour vous le ramener. Votre visite à E. chez Ech., le projet de vous installer
à Charit, etc, etc. Les premières années de votre mariage, tout alla bien et vous seriez encore avec lui s’il ne vous avait pas quittée, s’il ne vous avait pas gaspillé votre dot et vos revenus, et
moi je serais toujours à l’assistance. Enfin, c’est là une question que je ne veux pas connaître et qui ne me regarde pas. Je sais qu’il est allé dans le Livradois, ces dernières années et qu’il a
pris le thé, ce sont là des choses que je ne comprends pas. Pour me retirer de l’assistance, j’ai lu et relu les lettres de Dorgelet à grand-père, les vôtres et celles de grand-père qui depuis tant
d’années vous disait de me reprendre, celles de tante Jeanne, celles de Germaine de Cangis disant qu’elle ne voulait pas s’occuper de cela, toutes les démarches, même celles vis-à-vis du doyen d’E.,
pour obtenir de grand-père l’argent, les N° des titres que grand-père avait en usufruit et qu’il a vendus pour vous donner les 10 000 nécessaires, soit 6263,50 réclamés par l’assistance et le
reste pour le voyage, mon habillement et les frais d’hôtel. Ensuite, n’avez-vous pas essayé par tous les moyens de me faire reconnaître par Taznal qui s’y est toujours opposé, payer une pension
alimentaire pour moi qui ne lui étais rien. Il est vrai qu’en octobre 1929, vous écriviez à votre père ‘vous me dites de faire mon devoir, mais je ne veux pas toucher au petit capital qui me reste
pour retirer mon enfant’ et deux ou trois ans plus tard, c’était pour payer les dettes de Taznal, vente du domaine de Biosse. Jusqu’à la sœur de grand-mère qui vous aida de mille francs pour moi. Je
vous en supplie, épargnez-moi ces tristes affaires. J’ai sous les yeux, dans les archives des Genévrier, la vie de tous depuis 1896, avec toutes les lettres, les successions, les inventaires, les
partages de tout, le nombre de douzaines de draps, de torchons, de tableaux, etc, de Genévrier, du Livradois, en 1904 et en 1918, toute la procédure de divorce, les lettres de Taznal depuis 1921 à
mon sujet, celles écrites de la rue Sansac à Toulouse, les lettres de Dorgelet, de Merol, Mme Taznal, etc. Ce que vous avez eu en vous mariant est dit tout au long de votre contrat de mariage et dans
la liste des bijoux, dentelles, partagées avec votre sœur qui, elle, a été déshéritée en partie. Inventaire de Mtre Crione, notaire en Livradois, meubles, tableaux, bijoux : 100 000
francs ; valeurs et créances recouvrement certain estimées à 784 000 francs ; propriété du Livradois, maison, prés, terres, bois (257 hectares), estimée à 200 000 francs ; en
nue-propriété, l’usufruit à M. le baron de Genévrier, diverses valeurs 100 000 francs ; total de l’apport de la future épouse : 1 189 000 francs. Les comptes de tutelle, je
les ai, mais ils n’ont rien à voir avec cela et tout le monde sait que les estimations qui sont faites pour un contrat de mariage sont toujours le plus bas possible pour les bijoux, linge, propriété,
etc et les bois du Livradois, à ce moment-là moins les ventes faites auparavant, représentaient quelle valeur ? Vous les avez perdus avec Jo. Comme avec Dechez le prêtre, Imbert et maintenant
Bertot, malgré sa condamnation. J’en sais trop pour que l’on puisse me raconter des histoires. Ma femme n’a pas été non plus très flattée par les réflexions que votre cousine lui a faites, lui disant
de ne pas croire tout ce que l’on disait ; elle m’a simplement demandé en partant, si elle avait vraiment l’air si naïve ou si bête pour qu’on vienne lui raconter des histoires de robe rouge et
de séquestration, or toujours vous m’aviez dit que votre grand-mère vous adorait et vous préférait à votre sœur, elle l’a du reste prouvé dans son testament. Vous me dites n’avoir plus de
bijoux ; en 1945 vous en aviez encore de très beaux. Les dettes de Taznal c’est sa mère qui les a payées et elle vous a remboursé celles que vous aviez payées, sauf celles du Livradois. En
septembre 1927, soit deux ans avant mon retour, vous avez vendu un pendentif-diamant pour 28 000 francs qui a servi à payer facture Coste, facture Roche, acompte Legros, Mye Vallet, Vialon,
dentiste, Grenier à V., Vorillon à C., remboursement à Dorgelet (600 francs), notes et factures diverses, soit total de 28 000 francs. A Seymiers, vous avez acheté pour 17 551,55 francs de
meubles, vous savez comme la liste des objets qui ont été réclamés par Taznal, plat de Rouen offert par les Piellot, Tertol… stick, trompe, guéridon, fusil de chasse et de guerre, sur cette liste,
vous avez mis oui ou non en face des objets que vous avez rendus. De bijoux et d’argenterie, il n’en est pas question, du reste, n’avez-vous pas toujours votre bague de fiançailles, ce beau brillant
que vous portiez en 1946 et 1948. En 1931, vous avez vendu le domaine de Biosse, 62 700 et 3 150 francs d’arriéré de fermage. Je pourrai vous dire ce que vous avez payé avec, mais je puis
vous rappeler qu’il n’y a rien pour moi. De 1929 à 1939, vous avez eu à subvenir à mon entretien, ce n’est pas très long. Ma fille, je commence à l’entretenir et je ne voudrais pas demander un sou à
quelqu’un pour l’élever et si j’ai d’autres enfants, je leur ferai des études pour qu’ils aient une situation, même si je dois les entretenir jusqu’à 27 ou 28 ans, s’ils veulent faire leur médecine,
leur droit ou d’autres carrières qui nécessitent des études longues et coûteuses et moi je n’ai pas votre fortune, 6 à 700 hectares de propriété, des valeurs en dépôt cher M. Dorgelet, un château…
Mais ne parlons plus de tout cela, je suis tiré d’embarras maintenant, j’ai une femme qui me fait honneur, qui m’a pris pour moi-même, non pour mon titre ou mon argent, j’ai une fille qui me fait
honneur, qui est loin de faire fille de dégénéré, ne vous faites pas de remords pour moi, je n’ai pas à vous juger, ce n’est pas le rôle des enfants, mais de grâce ne me parlez plus de tout cela.
N’avez-vous pas dit plusieurs fois que j’avais brisé votre vie, que vous vous repentiez du devoir accompli, etc (lettres de 1934, 37, 46). Je vous ai dit que je vous emmènerais ma fille, mais pour ce
qui est de ma femme, je ne puis la prendre par la main, du reste à quoi cela servirait-il ? Je termine, espérant que vous ne m’obligerez pas à revenir sur ce sujet et vous embrasse tristement
d’avoir à rappeler de telles circonstances tels fait. Jean. »
Qui sont l’auteur et le destinataire de cette lettre ? Il s’agit de Jean de Genévrier, alors âgé de trente-trois ans et de sa mère, Cécile de Genévrier, âgée de cinquante-quatre ans. Que signifie cette longue liste de griefs, ce réquisitoire, cet inventaire hétéroclite, cette critique en règles d’une mère par son fils ? Si on en restait à une simple lecture, la mère serait coupable et le fils victime ; mais de quoi ? Le récit suivant pourra-t-il expliciter les raisons que le fils invoque pour incriminer sa mère ? En tous cas, cet écrit de Jean de Genévrier annonce, comme un casting, la distribution d’un film ou d’une pièce de théâtre, la plupart des protagonistes qui intervinrent et interviendront dans sa vie. Essayons de comprendre en jetant un œil sur ce qui s’est passé avant et après cette lettre : du début du 20ème siècle à 1952, puis de 1952 aux environs de l’an 2000, soit une période d’environ cent ans !
L’arriÈre-plan
Quand Aymar de Genévrier se maria en 1892, dans le 7ème arrondissement de Paris, il ne pouvait pas imaginer que sa femme, héritière de la famille de La Rive, bourgeois bitords, descendant d’un maître cordonnier du 17ème siècle, aurait une courte vie, mourant en tombant de cheval, à trente-trois ans à la fin de l’année 1902, et lui laissant deux très jeunes filles, Claire et Cécile.
Cette famille de La Rive avait compté parmi ses ascendants exclusivement bourgeois depuis le 15ème siècle, un négociant de Lisbonne qui s’était affublé d’une particule (en somme l’illustration de la savonnette à vilain), peut-être parce qu’il avait établi en quelque sorte un record en ayant eu vingt-trois enfants avec Pétronille, une femme de dix ans sa cadette, qu’il avait épousée alors qu’elle n’avait que quinze ans. Nombre des enfants moururent en bas âge, cependant cette femme vécut jusqu’à cinquante-six ans, un bien bel âge pour l’époque !
Le mariage d’Aymar avait rassemblé quelques membres de l’aristocratie française : on comptait parmi les témoins des noms de ducs et de marquis. Par cette alliance, il aurait dû renflouer la fortune familiale plutôt écornée par les mauvaises affaires de son père, en faisant entrer dans son escarcelle un appréciable patrimoine : la gente demoiselle, outre de la monnaie sonnante et trébuchante, de nombreux titres financiers et des bijoux, possédait dans les Monts du Livradois une demeure ancienne, au cachet indéniable bien que plusieurs fois remaniée, entourée de près de cinq cent hectares de terres et de forêts. Ce château et ces terres avaient été achetés en 1686 par son aïeul Antoine Grossier, marchand apothicaire dans la capitale auvergnate. Une chapelle récente de la fin du 19ème siècle sanctifiait le tout… Si l’on en avait cru Aymar portant jugement sur la fidélité de son épouse, peut-être le lieu en avait-il besoin. En outre, elle possédait des immeubles de rapport en Auvergne et à Paris. Des domestiques allaient de soi pour donner à tout ça un air seigneurial !
Pour situer le contexte à cheval sur la fin du 19ème et le début du 20ème siècle dans lequel cette société déclinante évoluait, rappelons que les Genévrier étaient antisémites, comme bien des gens de leur milieu social. Et pourtant un des leurs avait terni le lignage en épousant une Juive en 1891. Oui, Anatole de Genévrier, frère cadet d’Aymar, avait fauté ! Pire encore, Amélié le fils de ce couple damné épousera en 1918 sa cousine germaine Claire, sœur de Cécile et donc fille aînée d’Aymar ! Les témoins à la naissance d’Amélié avaient été Jean-Marie Gaborit de Montjou et Nikolai Aleksandrovich Rimsky-Korsakoff, lointain cousin du compositeur Nikolaï Rimski-Korsakov. Peut-être pourrait-on, sans digression excessive, faire figurer ici une anecdote cocasse concernant ce Genévrier, intitulée, Piteuse course-poursuite avec la bande à Bonnot, extraite du Guide du Paris des faits divers (Editions Le Cherche Midi) :
« Déboulant de la rue d'Amsterdam, le 27 février 1912, une Delaunay-Belleville coupe le carrefour, sans contourner le refuge central. Choqué, l'agent François Garnier s'égosille dans son sifflet. La voiture se retrouve coincée par l'autobus Javel-Saint-Lazare. Le gardien de la paix se précipite, saute sur le marchepied et s'écroule, abattu par l'un des passagers, Octave Albert Garnier. Le véhicule de la bande à Bonnot s'échappe par la rue du Havre. Mais c'était sans compter sur la pugnacité policière. Les agents Lucy et Henaff réquisitionnent l'automobile d'Anatole de Genévrier qui passait par là et se lancent dans la première course-poursuite des annales. Elle s'achève piteusement boulevard Haussmann. Les poursuivants percutent une passante, Maria Chandor, qui perdra l'usage d'un bras. Elle intentera un long procès avant d'obtenir de l'Etat une maigre indemnité. Quant aux ‘bandits à l'auto’, ils disparaissent... Le préfet de police Lépine décrète : « Toutes les fois que les chauffeurs d'automobiles chercheront à se soustraire par la fuite, les agents ne devront pas hésiter à crever les pneus à coups de sabre. »
Ainsi un Genévrier avait-il, malgré lui, participé à un fiasco de la police parisienne au début du 20ème siècle !
Après la mort de sa femme, en 1902, Aymar de Genévrier se sentit bien seul. Il dut organiser la vie de la famille : il prit avec lui Claire, sa fille aînée, alors âgée de six ans, dans son château passablement délabré des abords fiolants, et confia sa fille Cécile âgée de deux ans, à sa belle-mère de soixante-cinq ans, vivant dans la demeure du Livradois. Une jeune gouvernante anglaise, Miss Harriet, se chargeait d’éduquer la fillette, ce qui expliquait que Cécile parlait et écrivait l’anglais. L’Anglaise et Cécile garderont d’excellentes relations puisqu’en décembre 1924, quatre ans après le mariage de Cécile, cette ancienne nurse lui écrira quelques très longues et aimables lettres, continuant de l’appeler my dearest little child.
Aymar n’aimait pas cette enfant qu’il soupçonnait être le fruit de l’infidélité de sa femme avec un homme de passage. On peut comprendre que quelques années plus tard, approchant la quarantaine, chargé partiellement de l’entretien et de l’éducation de ses deux filles de onze et sept ans, il ait souhaité reprendre une vie conjugale.
Au printemps 1907, Aymar se remaria en Angleterre, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Londres, avec Mary, fille d’un officier de Sa Majesté britannique. L’arrivée de cette belle-mère dans le cercle familial fragilisé fut vécue d’autant plus douloureusement par les fillettes qu’à la fin de 1908 naissait à Londres un petit Edward.
Les demoiselles grandirent. Se déplaçant au gré de la volonté du châtelain d’Auvergne à Paris et de Paris en Grande-Bretagne, la vie des filles Genévrier ne fut pas des plus enjouées entre un père distant et une belle-mère entièrement consacrée à son fils. Heureusement, leur grand-mère du Livradois, perspicace, avait pris des dispositions testamentaires leur étant favorables, écartant volontairement leur père. Cette granny était dépositaire des biens provenant de la lignée maternelle de Claire et de Cécile.
Très tôt, Claire l’aînée, restée près d’Aymar, se rebella et se réfugia dès qu’elle le put à Paris pour échapper au lourd climat familial instauré par son père. A vingt-trois ans, quoi de mieux que d’épouser son cousin germain de deux ans son aîné ? Les langues s’étaient déliées depuis longtemps dans le voisinage, propageant le bruit – fondé ou non – qu’elle multipliait les amants. En Livradois et en Bourbonnais, on parlait d’elle comme d’une ribaude, selon l’expression rurale du coin. Elle s’installa à Paris et divorcera deux ans plus tard de son cousin germain, petit-fils de Salomon Revel (1825-1887) et de Sipora Fredericka Silva (1837-1891), heureusement sans enfant, pour se remarier promptement avec Auguste Plugeu de Vinros de trois ans son cadet. Claire, enceinte, mourra à trente-deux ans, quasiment au même âge que sa mère, en mettant au monde en 1926 des jumeaux mort-nés. Elle laissera un garçon de six ans et une fille de quatre ans à la charge de son mari qui lui survivra vingt-trois ans. Pour l’heure, Cécile était loin de s’imaginer tout ce malheur. Vivant auprès de sa grand-mère maternelle en Livradois depuis son enfance, elle n’avait que peu de rapports avec son père. Pourtant, comme sa sœur, elle commença à s’opposer à lui, le châtelain, et à sa belle-mère, l’austère Anglaise.
Les avis n’étaient pas concordants sur l’éducation que Cécile devait recevoir de cette grand-mère. Un cousin d’Aymar lui écrivit le 29 janvier 1914 – la fillette n’ayant alors que treize ans – qu’il avait été chargé d’une mission en qualité de subrogé tuteur de Claire et de Cécile. Il reprochait sévèrement à Aymar non seulement de ne pas s’occuper de sa plus jeune fille, mais aussi :
« De l’avoir abandonnée entre les mains de sa grand-mère qui, bien qu’animée des meilleurs sentiments, se trompe dans la façon dont elle l’élève, tant au point de vue physique qu’intellectuel. »
Il précisait sans fioritures que c’était à Aymar de s’en rendre compte, car lui seul, en tant que père, était responsable. Il le rappelait à l’ordre :
« Souvenez-vous de la lamentable histoire survenue à votre fille aînée il y a quelques années, cela aurait dû vous ouvrir les yeux sur les inconvénients qu’il peut y avoir pour un père à ne pas s’occuper de ses enfants. »
Tout en reconnaissant que la grand-mère avait toujours témoigné de l’affection pour ses petites-filles, il persistait à croire que cette aïeule se trompait sur l’éducation à donner à Cécile. On peut se demander ce qu’avait été cette « lamentable histoire, survenue il y a quelques années » sachant que Claire devait être bien jeune quand cela était arrivé, puisqu’en janvier 1914 elle n’avait que vingt ans. Faisait-il allusion à sa liaison avec son cousin germain, Amélié de Genévrier qui débouchera sur un mariage malheureux en 1918 ?
La grand-mère de Cécile, ayant eu connaissance de cette lettre, écrivit à Aymar de Genévrier, de Paris, le 27 février 1914 :
« Mon cher Aymar, Dès que j’ai reçu votre carte-lettre, j’ai mis sous enveloppe la lettre de M. Roger Bertot que vous me demandiez de retourner. J’espère qu’elle vous est bien parvenue. Je vous prie de m’en informer. Je cherche en vain à pénétrer le motif qui a pu déterminer M. Roger Bertot à vous écrire cette lettre qui constitue une dénonciation adressée à mon égard. Je fais tout le possible pour que Cécile soit bien élevée, physiquement et moralement. Je m’en occupe personnellement à chaque heure du jour. Je veille sur elle avec la plus tendre sollicitude. Que veulent dire ces insinuations sans la moindre précision ? Je suis à me demander si mon neveu jouit bien de ses facultés pour vous écrire une semblable lettre, alors surtout que, jamais quand il est venu me voir, ce qui lui arrive souvent, il n’a fait l’ombre d’allusion à une modification possible dans l’instruction et l’éducation de l’enfant. Du reste, vous vous êtes rendu compte par vous-même que Cécile était dans un état aussi satisfaisant qu’on peut le désirer, tant comme santé que comme instruction et éducation. J’ai été heureuse de constater que la dénonciation de M. Roger Bertot n’avait produit aucune impression fâcheuse sur vous et que vous me continuez la confiance que vous m’avez donnée depuis la mort de ma pauvre fille. Cette confiance, je vous demande de me la continuer pour le bien de l’enfant comme pour la consolation de mes derniers jours. Je me suis attachée à elle ; elle est attachée à moi et à Miss Harriett Hunt qui lui est toute dévouée. Je vous serre affectueusement la main, mon cher Aymar, et je serre dans les vôtres celle de votre femme. J’embrasse Claire et votre joli petit Edward. »
Cette lettre révèle a posteriori l’hypocrisie d’Aymar. En effet, il n’hésitera pas, six ans plus tard, en septembre 1920, devant le conseil de famille, à utiliser le courrier de Bertot mettant en cause sa belle-belle, pour contraindre Cécile. De plus, la raison pour laquelle il avait laissé Cécile auprès de sa belle-mère n’était pas la confiance qu’il lui manifestait, mais parce qu’il n’éprouvait aucune affection pour cette enfant qu’il pensait être celle de l’amant de sa femme.
Comme sa sœur Claire, Cécile n’eut de cesse que de fuir l’atmosphère irrespirable que son père faisait régner. La disparition de sa grand-mère en août 1917, chez qui elle vivait depuis la mort de sa mère en décembre 1902, précipita les événements. Jusqu’à ses dix-sept ans, ses études secondaires se déroulèrent à Sainte-Elvire, excellente institution privée de la capitale auvergnate où elle était en pension. On peut souligner que, selon un courrier d’Aymar à Saurat, son homme d’affaires, du 18 février 1918, elle y avait été malade, alitée à l’infirmerie pendant quinze jours. En effet, elle avait été secouée par des quintes de toux si fortes qu’elle avait eu des saignements de nez et des vomissements. On avait suspecté la coqueluche et elle avait dû quitter l’établissement scolaire, la directrice, Mademoiselle Chassaing, craignant qu’elle puisse contaminer ses camarades. Elle aurait, selon son père, exagérait son état pour revenir, avec sa complicité, auprès de sa gouvernante. Etaient-ce les prémices d’une santé défaillante et d’un certain goût pour l’esbroufe ?
Après la mort de sa grand-mère, elle dut partir pour le Bourbonnais chez son père, tout en sachant que sa sœur Claire avait quitté le château paternel pour Paris. Aymar de Genévrier trouva ainsi l’occasion de mettre la main sur la gestion des biens que l’aïeule avait destinés à Cécile encore mineure. Il faut dire que la plupart des échanges épistolaires, tout au long de la vie du châtelain, traitaient d’embarras financiers, comme ce sera le cas pour sa postérité ! Il faut dire que les ennuis financiers étaient récurrents chez les Genévrier depuis de nombreuses décennies, puisque l’un d’eux avait déjà été emprisonné à la fin du 18ème siècle pour dettes et qu’à la moitié du 19ème siècle, un autre Aymar de Genévrier était criblé d’arriérés ! On ne résiste pas à l’envie de publier ici un extrait de la lettre d’Aymar à Saurat, son homme d’affaires, car elle illustre parfaitement l’esprit vénal régnant dans cette famille et qui se perpétuera jusqu’au 21ème siècle :
« … Inclus la note de R. concernant Claire. Les gens ne voudraient pas perdre leur argent pas plus que B., J.C., fermier à La Ch., et les autres créanciers qui ont avancé imprudemment des fonds sans mon consentement. Ne pensez-vous pas qu’il y aurait lieu de faire une opposition collective sans m’oublier non plus et me faire rembourser le manteau neuf acheté à Cécile aux Galeries Lafayette. »
Cette demande de remboursement de manteau était particulièrement odieuse ; en effet, il s’agissait d’un vêtement offert à Cécile par sa sœur Claire. Circonspecte, la grand-mère du Livradois avait désigné comme exécuteur testamentaire, Maître Breton, avoué à Paris à qui, soit dit en passant, elle légua, comme diamant, la somme de six mille francs. Outre les biens matériels, elle aurait – selon d’aucuns – transmis quelques-unes de ses qualités à sa petite-fille Cécile, en particulier la générosité. On peut en douter au regard des décennies qui suivirent. Cette grand-mère n’avait-elle pas légué en 1903 la somme de douze mille francs, ce qui correspondrait à une belle somme en euros d’aujourd’hui, à Miss Harriet, gouvernante de sa petite-fille orpheline de mère ? Par codicille, elle précisait léguer à Cécile, parmi d’autres bijoux, une parure de corsage en diamants et un collier en corail ainsi que vingt-sept assiettes chinoises ou japonaises. Selon la volonté de sa grand-mère, Cécile devait bénéficier de l’intégralité de la quotité disponible. Cette générosité ne se sera assurément pas transmise d’une génération à l’autre !
Pour respecter les dispositions de son testament, au décès de la grand-mère on prévint l’abbé Palissier de Paris. Elle fut enterrée dans le cimetière de Montparnasse après avoir été embaumée. En bonne catholique, elle avait prié son exécuteur testamentaire de faire dire, immédiatement après sa mort, cent cinquante messes pour le repos de son âme, à cinq francs l’une.
En bref, la famille de Genévrier désirait présenter au début du 20ème siècle l’apparence de l’ancienne noblesse. La réalité était tout autre. Désargentés, les Genévrier avaient dû s’allier à la fin du 19ème siècle à la bourgeoisie d’argent pour tenter, si possible, de maintenir un semblant de rang privilégié. Pour autant, Aymar se révélait être en réalité un vil personnage.
Le baron, un triste individu
Nous insérons ici une lettre non datée (probablement en 1918) de Cécile à Saurat, compte tenu qu’elle est envoyée du château de Genévrier, donc vraisemblablement après la mort de la grand-mère et alors qu’elle était encore pensionnaire dans la capitale auvergnate. Cette lettre n’appelle aucun commentaire :
« Château de Genévrier. Cher Monsieur, Depuis 2 jours je voulais prendre la plume pour vous écrire mais l’acte d’un homme dépourvu momentanément de ses facultés m’a condamnée aux pires souffrances dues à des fortes contusions à la tête, figure et aux bras. Je n’ose pas vous dire que cet homme est mon père qui mardi ayant égaré une lettre m’en a imputé la faute. Moi je rentrai dans la pièce afin de lui dire bonjour. Il me dit que j’ai pris cette lettre en réponse à mon bonjour. Je réponds ‘non Papa, je ne l’ai pas vue, ce que je peux jurer’. Il me répond que puisqu’il dit oui je n’ai rien à répondre. Ce n’était pas plutôt dit que je reçois une avalanche de coups sur la figure, la tête puis il me tire par les cheveux qu’il avait rendus épars et me dit les pires grossièretés tandis qu’usant de toute ma volonté et mon courage je ne soufflais un mot à toutes ces injures toutes fausses. Tandis que sa main couverte de ferrailles finissait de meurtrir ma tête et mon visage. Cher Monsieur, si vous ne voulez le croire, j’ai des témoins. Résultats, depuis 2 jours je ne puis fermer l’œil la nuit et la fièvre me dévore parfois. La cause : la veille il a dû sortir 43 000 F. de sa poche, il n’a pu avaler cette pilule. Ici tout le monde était en larmes à la vue de cet acte de barbarie ; moi-même il me semble être encore dans un rêve. Il faut que je voie les traces sur ma propre figure pour le croire. Cher Monsieur, je regrette de venir vous attrister par ce récit, mais je puis vous assurer que si jamais il se renouvelle je ferai des plaintes. Une fille ne doit pas recevoir (au moins 50 coups de poing, griffes par le simple caprice de son père). J’ai été très touchée de ce que vous m’avez dit sur le sujet pécuniaire. J’ose donc enfin me permettre de vous demander si vous pouviez m’avancer un peu d’argent. Comme vous le savez, je vais aller à Londres dans le monde. Il me faut donc m’habiller. Impossible d’arriver à m’acheter quoi que ce soit. Il est d’une nécessité urgente que je m’achète des bas, souliers, blouses. Impossible avec 100 F. afin de me payer une paire de bottes convenables, il a fallu entamer mon mois de décembre. Il me reste donc 10 F. jusqu’au 1er janvier pour me fournir une paire de souliers du soir, une ou deux blouses et des bas. Vous voyez mon impossibilité et je ne voudrais pas accumuler dettes sur dettes. Je vous serais donc infiniment reconnaissante si vous pouviez me rendre la tâche moins dure. Je vous prie de garder cette lettre confidentielle. Veuillez agréer, cher Monsieur, l’assurance de mes meilleurs sentiments. Cécile de Genévrier. »
Il suffit de lire quelques-unes des lettres de 1917 d’Aymar pour ne plus avoir de doutes sur la réelle bassesse de l’individu.
Au général Poline, de Tours, le 20 octobre 1917 : « Mon général, Suivant votre pressante demande, et conformément à ma promesse formelle de vous tenir au courant de ce que je saurais de nouveau, je m’empresse de vous exprimer mon étonnement à la suite de faits portés à votre connaissance, en recevant de mon vaurien de neveu, la lettre ci-jointe, jeudi dernier 18 courant, que je tiens à vous communiquer. Il serait depuis quelque temps au camp du Ruchard, près d’Azay-le-Rideau, alors que j’étais intimement convaincu qu’il était à Niort. Il va sans dire que je ne lui répondrai pas. Ainsi que vous pourrez le constater, l’en-tête de sa lettre porte encore qu’il est ‘maréchal des logis’. L’est-il encore et a-t-il le droit de le porter ? Puis-je espérer qu’il partira bientôt au front ? Il n’y a vraiment pas de tranquillité possible pour nous tant que nous le sentirons à proximité d’ici. Je compte sur votre obligeance et le bienveillant appui que vous m’aviez promis pour la sécurité de notre ‘foyer’, en faisant le nécessaire en ce sens. Bien pardon de vous importuner aussi souvent. Veuillez agréer, je vous prie, mon général, avec mes remerciements réitérés, l’hommage de mon profond respect. Baron Aymar de Genévrier »
Acharné délateur, trois jours plus tard, le valeureux baron remettait ça :
Au général Poline, de Tours, le 23 octobre 1917 : « Mon général, De la même personne, je reçois par ce courrier la lettre ci-jointe dont inclus la copie exacte, sans y changer un mot. Je crains bien que ce n’est qu’un début et qu’il faudra m’attendre à recevoir des correspondances similaires aussi longtemps que les naïfs par trop généreux et confiants par les paroles et les promesses mensongères de mon garnement de ‘neveu’, supposeront que je donnerai bénévolement mon consentement au mariage projeté de ma malheureuse fille captivée sous le charme de ce ‘bandit’ que je voudrais voir en 1ère ligne de feu sur le front au plus tôt ! Combien je serais heureux et soulagé si ce fut lui qui eut été tué à la place de notre cher ‘Guynemer’ dont la mort récente sera de longtemps regrettée par notre chère Patrie dont il était le joyau et l’admiration de tous ! Voilà une perte ! Veuillez croire, je vous prie, mon général, à mes sentiments très respectueux ! Baron Aymar de Genévrier. »
Il alla loin dans son intention de nuire à son neveu et à sa fille Claire. On le devine à travers la réponse du maire du 8ème arrondissement de Paris, à une lettre que lui avait adressée le baron six jours auparavant. Ce magistrat républicain lui rappela la loi :
Gaston Drucker, maire du 8ème arrondissement de Paris, 26 octobre 1917. « Monsieur et cher collègue, J’ai l’honneur de vous faire connaître, en réponse à votre lettre du 20 octobre, que Melle votre fille étant née dans le 7ème arrondissement, la délivrance de son acte de naissance concerne M. le maire de cet arrondissement à qui je transmets en conséquence votre lettre. Aucun dossier n’a été constitué dans notre mairie en vue du mariage de Melle votre fille ; mais, si elle produisait, ainsi que M. votre neveu, les pièces nécessaires et justifiait d’autre part de l’existence des notifications prescrites par l’article 151 du Code civil, je ne pourrais refuser de procéder à la célébration du mariage que sur le vu d’une opposition régulière notifiée par huissier. Veuillez agréer, Monsieur et cher collègue, l’assurance de mes sentiments très distingués. Le maire, Gaston Drucker. »
La réponse de Gaston Drucker, qui sera en 1931 témoin au mariage de Gaston Doumergue, Président de la République française du 13 juin 1924 au 13 juin 1931, ne pouvait pas satisfaire l’intrépide baron. La hargne mortifère de ce pseudo patriote ne s’arrêta pas là. Il tenta de diffuser largement son venin :
Au maire du 8ème arrondissement de Paris, le 29 octobre 1917 : « Monsieur et cher collègue, Des raisons très graves (qu’il serait long pour moi d’énumérer par écrit) s’opposent absolument au ‘mariage’ projeté de mon neveu : Monsieur Armand, Michel de Genévrier (âgé de 25 ans), né à Paris le 3 octobre 1892 à 2h du soir, N°10, avenue de l’Alma (actuellement mobilisé), avec sa cousine germaine (ma fille aînée), Melle Claire de Genévrier (âgée de 23 ans), née à Paris le 1er janvier 1894, au N°53, rue de Varennes (7ème arrondissement). Je vous demande instamment de bien vouloir donner des instructions personnelles à votre secrétaire attaché au Bureau des Archives, de ne pas délivrer l’acte de naissance qui pourrait lui être réclamé par ma fille à qui j’ai refusé mon consentement, ni de procéder à cette ‘union’ que je désapprouve complètement. Veuillez croire, je vous prie, à mes remerciements anticipés et sentiments très distingués. Baron Aymar de Genévrier, maire de Genévrier. »
Même s’il était vrai que ce neveu de vingt-cinq ans avait déserté et qu’il était sans doute atteint du syndrome Genévrier se manifestant pas une personnalité troublée, il n’en reste pas moins que, à la lecture de ces écrits, on ne peut pas ne pas penser à ce que le baron aurait fait vingt-cinq ans plus tard. En effet, le style et l’abondance de détails précis rappellent étrangement les courriers des dénonciateurs, pseudo-patriotes français, de la période d’occupation de la France par les Nazis.
Cependant, les manœuvres d’Aymar à l’encontre de sa fille et de son neveu n’aboutirent pas, puisqu’ils se marièrent en juin 1918 à Limoges. Il est vrai qu’ils divorcèrent en 1920.
Malheureuse idylle
En ce début d’été 1920, une chaleur torride – qui avait succédé à une vague de froid – accablait ce coin d’Auvergne comme les autres provinces de France. Vers dix-heures, légèrement vêtus, les jeunes cousins Cécile et Jacques, indolents, en papotant s’éloignèrent lentement du château par une allée embaumée de fortes et captivantes senteurs de lilas finissants. Cécile avait tout juste vingt ans, un physique sans grâce évidente, le regard triste malgré son jeune âge.
Tout en minaudant, elle se remémorait sa courte et pourtant triste vie. Elle ne se souvenait pas de sa mère, la châtelaine, morte dix-huit ans auparavant. Son père, bien qu’il eût participé aux épreuves équestres d'entraîneur de courrier aux Jeux olympiques d'été de 1900, était considéré comme une vieille culotte de peau dont l’esprit rigide était connu du voisinage. Sans doute, l’atavisme jouant, avait-il hérité de l’exécrable caractère de son lointain cousin, portant le même prénom d’Aymar, dont on avait écrit en 1851 : « C'était un homme d'un caractère absolu ; il voulait dans sa famille une discipline aussi sévère, une obéissance aussi complète que celle qu'il exigeait au régiment. » Ce personnage ridicule, s’était affublé du titre de vicomte de Genévrier. L’usage de titres de complaisance (certains, pour atténuer le ridicule, disent titre de courtoisie) avait cours dans la famille depuis plus de deux siècles. Les Genévrier ne prétendaient-ils pas aussi à un titre de baron, sans fondement légal ? Ainsi cette famille, comme tant d’autres parmi les pseudo-aristocrates, se donnait-elle alternativement du baron et du vicomte, s’imaginant, sans doute, que cela leur servirait de talisman.
Comme nous l’avons déjà souligné, Aymar s’était remarié cinq ans après la mort de sa femme, avec une de ces froides Anglaises, un peu plus âgée que lui, qui avait donné à Cécile un frère, Edward, de huit ans son cadet.
- Quelle perspective me reste-t-il, pensa Cécile, suis-je condamnée à vivre une vie aussi misérable que celle de ma sœur ?
Depuis son installation au château paternel, Cécile était esseulée. La venue de Jacques de Cangis, ce cousin parisien d’à peine deux ans son aîné, ne pouvait qu’embellir sa morne existence. Militaire au 8ème Régiment du Génie, dans la Compagnie SR3 d’une garnison parisienne, il avait un physique avantageux. Il captiva sa jeune cousine à qui il faisait – par jeu – du pied depuis des mois lors des rencontres familiales à Paris ou en Auvergne. Mais le connaissait-elle vraiment, elle qui honnissait sa tante, la mère de Jacques ? Ce cousin et ses parents n’avaient-ils pas vécu pendant trois ans et huit mois dans le château fiolant, alors qu’elle habitait avec sa grand-mère en Livradois ? En effet, en application des dispositions testamentaires de leur père, mort en 1884, la sœur aînée d’Aymar et son frère cadet pouvaient légitiment occuper une partie du château.
A quelques centaines de mètres du donjon, s’étalait un bosquet où la fraîcheur engageait au farniente. Cécile et Jacques n’en sortirent qu’en entendant la cloche tinter. Il était temps d’aller déjeuner.
Le châtelain, toussotant, grommela :
- Toujours en vadrouille ?
Les jeunes gens s'assirent, le visage en sueur déjà bruni par le chaud soleil de ce début d’été. Ils se fixaient sans se voir, tant le regard du père de Cécile effaçait toute joie dans ce château mal entretenu. La mine renfrognée, Aymar retenait sa colère. Il écourta le déjeuner et s’adressa à Jacques :
- Ton séjour se termine demain, je te demande de rentrer à Paris. Toi et Cécile, vous passez trop de temps ensemble. Au village, on commence à jacasser.
- Mais, mon oncle, on n’est que le 25 juin et demain samedi je risque de ne plus avoir de train pour Paris.
- Ecoute-moi bien, toi qui te prends pour un génie, je sais ce que tu manigances avec ta mère, tu tentes de séduire cette pauvre Cécile qui brigue le mariage pour échapper au climat familial, comme elle le dit stupidement… comme a fait sa sœur il y a deux ans, mais il est évident que tes objectifs et ceux de ma sœur, ta mère, sont de mettre la main sur la fortune de Cécile, cette pauvre petite complètement décervelée.
- Mais mon oncle, vous vous trompez, j’aime bien Cécile, mais c’est seulement ma cousine et…
- S’il te plait, ne me prends pas pour un crétin, comme cette tête de linotte de Cécile qui clame à tous vents qu’elle veut s’affranchir à tout jamais de l’autorité paternelle. Je sais pertinemment ce que vous tramez, toi et ta mère. Vous savez parfaitement ce que sa grand-mère auvergnate, morte il y a trois ans, lui a octroyé et ça ne peut pas vous laisser insensibles, vous qui êtes fauchés, et la mort de ton père l’année dernière n’a rien arrangé !
- Papa, vous vous trompez, mais de toutes les façons, et vous le savez bien, je ferai comme je l’entends, quoi que vous en disiez !
- Toi Cécile et ta sœur Claire, vous avez craché sur mon autorité mais aussi sur la tendresse que votre belle-mère vous a prodiguée depuis des années.
- De toutes les façons, je suis déterminée, dit Cécile en élevant la voix.
Aymar, le visage cramoisi, se mit à hurler :
- Vous iriez à la catastrophe, toi Cécile, tu veux faire comme ta sœur Claire qui s’est mariée avec son cousin germain Michel et qui est en train de divorcer ? Heureusement qu’il n’y a pas d’enfants ! De toutes les façons, l’église émettrait toutes les réserves… Aie un peu d’honnêteté, Jacques ! Tu laisses entendre hors de la famille que tu n’es pas des plus emballés par ta cousine, même tu es allé jusqu’à dire à des amis que tu ferais un énorme sacrifice en consentant à la prendre comme femme, alors pourquoi ne pas dire la vérité ici, devant elle ?
Les jeunes gens, la tête baissée, écoutaient leur père et oncle rugir :
- J’en ai assez dit ! Jacques, prépare-toi à partir pour Paris.
Ce neveu était le fils de sa sœur Jeanne. Veuve deux fois. Elle avait eu deux enfants de son premier mariage dont une fille morte à vingt-huit ans en 1917. Remariée un an après la mort de son premier mari âgé de trente-deux ans, elle fut de nouveau veuve du père de Jacques de Cangis. Elle avait alors cinquante-trois ans.
Le téléphone sonna dans le bureau du châtelain ; il quitta promptement la table :
- Bonjour Aymar, c’est Edmond… je te rappelle pour régler le retour de Jacques à Paris dans les meilleurs délais.
- On est bien d’accord. Il se prépare. Il sera de retour demain.
Cécile et Jacques quittèrent la salle à manger vieillotte et mal éclairée.
Dans la chambre, Jacques rassembla ses quelques affaires, boucla sa valise et se dirigea vers la chambre de Cécile à quelques mètres.
- Dis-moi, Jacques, crois-tu qu’il y ait une filiation du malheur ? Est-ce que, comme ma mère, je mourrai jeune ? Vois, comme mon père me dédaigne et se consacre à mon demi-frère qui n’a que douze ans… Je pleure encore ma chère grand-mère morte il y a trois ans et je pense souvent à ma sœur Claire qui a fichu le camp… Je me demande ce que me réserve cette vie…
- Tu sais, Cécile, je ne suis pas plus heureux que toi, nous sommes faits du même bois, ton père et ma mère sont frère et sœur et nous devons certainement drainer dans nos veines une part d’adversité… En tout cas, ton père et ses proches voient très mal que nous ayons des relations. Je pars demain… tu me donneras de tes nouvelles rapidement.
Le chaud été 1920 parut très long à Cécile.
LE DÉSHONNEUR
En ce mardi 10 août 1920, on entendit des cris et des jurons dans le grand salon du château et on pouvait saisir qu’il s’agissait de la vertu de Cécile. Son père et sa belle-mère, l’austère Anglaise, évoquaient les récentes relations estivales de Cécile et de son cousin Jacques qui avaient porté du fruit, si l’on osait ainsi parler. Enrageant, le châtelain se remémorait les frasques de ses deux filles adolescentes. En particulier, en mars 1916, avec l’aide d’une Marie Vital, une comparse, Cécile n’avait-elle pas simulé un accident de circulation à Paris ; elle aurait eu la jambe droite écrasée et aurait été transportée à l’hôpital Biset ? Par malveillance à son égard – pourquoi ? – Aymar avait ainsi été victime d’un canular. Ulcéré, Aymar avait envisagé de faire intervenir la police secrète !!!
Le courroux du châtelain était à son comble. Comment lui, maire du village où était implantée sa famille depuis deux siècles, allait-il à nouveau vivre le déshonneur ? Déjà, des années auparavant, la relative fidélité des femmes de la famille avait fait jaser les villageois. Lui-même avait émis des réserves sur la paternité de sa fille Cécile. Et voilà qu’à cinquante-deux ans passés, il devait de nouveau affronter la honte !
Cécile avait dû avouer un retard de règles de deux mois. Naturellement, d’après elle, elle n’avait eu de rapports qu’avec Jacques de Cangis ces derniers mois et il ne pouvait être que le père. En 1920, comment aurait-on pu envisager un avortement ?
Dans l’esprit du châtelain, il fallait agir rondement pour endiguer le qu'en-dira-t-on. Fort de ses relations locales et de l’appui de certains de ses proches, Aymar de Genévrier élabora un plan qui ne relevait pas, selon l’enseignement chrétien, du plus haut niveau moral. Sous l’égide du juge de paix du bourg dont dépendait le château, il décida de convoquer dans les plus brefs délais un conseil de famille rassemblant la proche parenté mais aussi l’avoué Saurat, son homme d’affaires. Cependant, le magistrat, prudent, avait écrit à Aymar le 26 août 1920 :
« Monsieur le baron, Avant de vous fixer une date pour la réunion dont vous me parlez, j’ai absolument besoin de vous voir au sujet du motif de cette réunion que je dois exposer dans la délibération. Puisque Maître Saurat votre avoué est au courant de la chose, veuillez donc lui écrire pour qu’il m’expose dans une note les motifs de votre requête. En possession de ce document, je m’entendrai ensuite avec vous pour que vous puissiez prévenir les membres du Conseil de famille. Veuillez agréer, Monsieur le baron, mes civilités les plus empressées. »
Obtus, Aymar de Genévrier tenta de circonvenir le magistrat en manifestant son dépit à Saurat
« Je ne comprends pas le juge de paix ? Je lui avais tout expliqué par écrit il y a de cela 5 jours au moins. Veuillez l’activer, comme il n’y a pas de temps à perdre et que je me trouve retardé dans mes convocations à présent par sa faute pour fixer le jour. Aurons-nous le temps de tenir la réunion mercredi prochain (mercredi 1er septembre 1920) comme il était décidé hier entre nous ? Comme c’est ennuyeux ! Je vais envoyer demain un messager exprès pour le mettre au courant. Si je n’avais pas des invités au château et que pour eux et les distraire je n’étais pas astreint de partir pour le Puy-de-Dôme, j’y serais allé moi-même. Ci-joint, la lettre reçue ce matin de mon futur gendre (qui sera le second mari de sa fille aînée Claire deux ans plus tard, celle-ci étant alors en procédure de divorce de son cousin germain qui sera effectif quatre mois plus tard !). Je crains bien qu’il trouve la pilule amère de donner un conseil judiciaire à Cécile mais je ne céderai pas et vous demande de faire tout ce qui dépendra de vous pour brider ce couple décidé de cœur joie à se marier contre nous. »
Le châtelain avait manœuvré, tentant d’ameuter sa parenté et de la rallier à sa cause. On peut souligner qu’Aymar de Genévrier transmettra à sa postérité cette disposition à la manipulation. En fait, sa hâte était dictée par la crainte de se voir privé des subsides qu’assurait la présence de sa fille Cécile auprès de lui. Il savait parfaitement que l’état de ses finances ne lui permettait pas de briller socialement comme il l’aurait souhaité. Déjà son père avait eu de gros déboires financiers au siècle précédent, en collaborant avec le demi-frère de Napoléon III.
Stratagème et tractations
Matois, Aymar de Genévrier prépara ainsi un plan pour contrer les intentions de Cécile et de Jacques. Bis repetita placent, on retrouvait ainsi le funeste personnage qui, plus de deux ans auparavant, avait mené contre sa fille ainée et son fiancé une campagne de dénigrement auprès du général Poline et du maire du 8ème arrondissement de Paris. Il tenta de réunir un conseil de famille, allant jusqu’à convoquer son neveu, fils de son frère cadet, qu’il avait mis à l’écart depuis son mariage avec une Juive en 1891. Mais la mère de ce neveu avait écrit à Aymar le 9 août 1920 pour repousser cette invitation.
A quelques jours près, Jacques de Cangis lui écrivit de La Bourboule, le 24 août 1920 :
« Mon cher oncle, Cécile me parle dans sa lettre d’aujourd’hui de quelques papiers que vous me demanderiez. Le notaire du Livradois qui est mon intermédiaire dans tous ces actes ne m’a encore avisé d’aucune réponse de vous. Il serait peut-être plus simple, plus rapide, et aussi normal que nous ayions une petite entrevue. Je me permets donc de vous proposer que j’aille en Bourbonnais vendredi. Nous pourrions, je l’espère, nous comprendre mieux et nous entendre. Je vous demanderais si vous pourriez me faire chercher et conduire et à quels trains cela vous dérangerait le moins (Je passe par …). Excusez-moi de vous déranger ainsi, j’y vois un intérêt grave pour chacun. Encore une fois je regrette de vous troubler encore et en attendant votre réponse je vous prie de partager avec ma tante les affectueux respects de votre neveu. PS : La présence de Maître Saurat pourrait peut-être permettre d’avancer plus rapidement certaines questions… et en tous cas avoir son utilité. »
Aymar, tout en multipliant les interventions, eut bien du mal à réunir le conseil de famille. Le 26 août 1920, il répondit à Jacques de Cangis, le fauteur de troubles, une lettre agressive :
« Jacques, Impossible de t’avoir ici, ni de faire droit à ta requête. Rien ne saurait être décidé avant la réunion du conseil de famille qui doit statuer prochainement. Maître Saurat sera chez lui samedi prochain. Libre à toi de le voir ce jour-là si tu le juges à propos. Le mariage forcé (contraire à mon gré) ne pourra se faire qu’à Paris, pas ailleurs et dans la plus stricte intimité et pour cause, cela va sans dire ! J’attends de toi la lettre comme dans les termes indiqués et dictés à Cécile pour couvrir ta responsabilité quant à la légitimité de l’enfant, en cas de malheur. Ton colonel recevra un mot de moi en temps opportun pour régulariser ta situation. PS : Ta tante (la religieuse) et moi t’invitons à éviter le scandale. C’en est assez ! »
Cette tante religieuse était Hélène de Cangis, la sœur cadette du père de Jacques qui était née en 1861 et qui mourra en 1950. Que sortit-il de ce conseil de famille tenu en septembre 1920, sous l’égide du juge de paix Champin ? Mais Aymar de Genévrier, avec sans doute l’aide paradoxale de Claire, sa fille aînée, avait réussi à convaincre Cécile d’écarter Jacques de Cangis. Mais aussi peut-on s’interroger sur l’attitude finale de ce dernier ; avait-il envoyé la lettre suggérée par son oncle Aymar, par laquelle il devait admettre être le père légitime de l’enfant à naître ?
Le 28 août précédent de trois jours la tenue prévue du conseil de famille, Aymar avait obtenu (sans doute avec l’aide de Saurat) du tribunal de première instance voisin, l’expédition ordonnant la convocation du conseil de famille pour donner son avis sur l’opportunité de la mesure sollicitée. De fait, le conseil de famille eut lieu le mercredi 1er septembre 1920, à 11h00 du matin, rassemblant bien sûr Aymar de Genévrier naturellement assisté de Saurat, le juge Champin assisté du greffier Bourgougnon. Dans un premier temps, Champin exposa les raisons pour lesquelles on avait réuni ce conseil. Aymar estimait que :
« Il se trouvait dans la pénible situation de provoquer la nomination d’un conseil judiciaire contre sa fille mineure, car, expliqua-t-il, cette mesure n’est que trop justifiée par sa grande prodigalité, ses caprices, une instruction négligée la rendant incapable de gérer seule sa fortune à sa majorité. »
Etions-nous en République ? Les titres de complaisance s’exhibaient ne heurtant apparemment pas les républicains locaux. En effet, le conseil de famille avait réuni, outre Saurat l’avoué, Champin le juge et Bourgougnon le greffier, quelques proches parents de Cécile. Du côté paternel, naturellement Aymar dit le baron de Genévrier, son oncle le frère cadet d’Aymar, dit le vicomte de Genévrier, l’avocat Dufournoux représentant, absent, Léopold dit le marquis de Montclair, lointain cousin de Cécile. Et du côté maternel, Henry, dit le comte de Château-Rendron, cousin de Cécile, Raoul de Frégilonde, autre cousin et Maître Pergoux, notaire du bourg voisin.
On présenta dans le détail la situation de la jeune fille mineure :
« Élevée par sa grand-mère, femme âgée, son instruction avait été négligée, elle ne connaît pas la valeur de l’argent… sa grand-mère l’avait si bien compris que dans son testament, elle a chargé un exécuteur testamentaire de son administration jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans de la quotité disponible qu’elle lui léguait. »
Les participants ne semblent pas avoir été gênés par leur contradiction ; en effet, comment cette grand-mère aurait-elle pu tout à la fois être l’auteur de la mauvaise éducation de sa petite-fille et d’une décision de retarder la jouissance de son héritage jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans ! Et le compte rendu continuait ainsi :
« Ces mesures s’imposent d’autant plus qu’elle est à la veille de se marier avec un homme relativement jeune… En conséquence, il y a lieu de pourvoir ladite demoiselle Cécile de Genévrier d’un conseil judiciaire. »
De nouveaux subrogés tuteurs furent désignés, mais en fait, tout cela avait été combiné par Aymar qui entendait rester maitre de la situation. Surprise à la lecture de ce procès-verbal : aucune allusion à la grossesse de Cécile. Cela faisait à l’évidence partie du plan d’Aymar !
N’avait-il pas dès le 13 juillet 1918, onze mois seulement après la mort de sa belle-mère, écrit au garde de la propriété du Livradois, lui intimant l’ordre « d’interdire d’enlever quoi que ce soit… appartenant à Mademoiselle Cécile ! » De son point de vue, la situation inattendue créée par sa fille devait servir ses desseins puisque, enfin, elle éloignerait définitivement son neveu et les sombres projets qu’il prêtait à sa sœur et ses enfants. Cependant, Aymar avait dû aussi faire face à l’opposition de sa fille aînée qui n’avait pas oublié un père versé dans la magouille. Il écrivait à Saurat :
« Je ne vois que dans la façon d’agir de Claire le but évident de chercher à m’être désagréable et de m’agacer, mais à mon âge, cela ne prend plus, et cela ne m’a pas empêché de bien dormir toute la nuit comme un bienheureux ! Il est à craindre que le nommé ‘Buisson’ (dit Jô) qui doit assurément être un des nombreux agents véreux avide d’argent en poussant Claire à agir dans le sens qu’il lui indique, ne cherche qu’à vouloir intimider le garde ou encore à le gagner de leur côté question de nous chicaner et abuser de la naïveté et légèreté de ma fille aînée pour lui extorquer de l’argent. Maintenant il faudrait absolument que vous fassiez tout votre possible pour presser de votre mieux le tribunal pour se prononcer afin que la situation devienne au plus tôt nette et définitive avant que nous nous décidions à partir d’ici (son château en Bourbonnais) pour nous installer dans le Livradois et soyons fixés définitivement qui est reconnu propriétaire et seule maîtresse tant du château que de ladite propriété à seule fin de ne pas être exposés à éprouver du tumulte, désagréments suscités par Claire et sa suite, profitant de cette situation incohérente et indéterminée pour nous expulser de bon gré ou de force, ce qu’il faut absolument éviter. A ce propos, je tiendrais personnellement à ce que le tribunal m’autorise en me donnant droit jusqu’à la majorité de Cécile d’habiter le temps qu’il me plairait dans la propriété du Livradois (accompagné de ma femme, si bon me plaît) pour surveiller l’exploitation des bois, me rendre compte du bon entretien tant de ladite propriété que des domaines, en ma qualité de tuteur légal et administrateur direct des biens auxquels je dois veiller pour la sauvegarde des intérêts de ma fille mineure en agissant en vertu des droits qui me sont conférés par la loi, ne voulant pas éprouver aucun ennui ni contestation aussi bien de la part de Claire que de sa sœur, disposée peut-être à vouloir me dicter ses caprices et volontés profitant de ce qu’elle apprendra qu’à partir du 1er juillet écoulé elle est considérée seule maîtresse au château du Livradois. Vous devez comprendre que je tiens, comme de juste, à occuper pour ma sécurité et tranquillité absolue une situation nette et catégorique. C’est la raison qui me pousse à m’adresser à votre obligeance coutumière, pour ne pas avoir le moindre ennui ni d’un côté ni de l’autre et savoir sur quel pied danser, sans être moindrement inquiété par des désagréments toujours à prévoir avec des caractères aussi bizarres que variables et autoritaires pour ne pas dire entiers parfois. Ne perdez point, je vous prie, l’objet de ma demande et profitez de ce que le tribunal doit prochainement se prononcer pour ratifier et homologuer la vente de la futaie du Livradois pour me concéder les pouvoirs sollicités, pour ma quiétude personnelle… »
Cette lettre à elle seule pourrait résumer le personnage, mais il ne s’était pas limité à ce courrier à Saurat. Oui, n’avait-il pas envisagé, en influençant Cécile, de vendre les domaines du Livradois ayant appartenu à sa femme ? Il avait chargé un géomètre, expert auprès des tribunaux, d’évaluer la propriété. Un échange épistolaire de septembre 1918, entre cet expert et Joseph, le garde particulier attaché au château de la grand-mère de Cécile, était révélateur des intentions du châtelain. Dans ce courrier de l’expert, il était question d’évaluation, d’une opération avantageuse pour Madame de Genévrier, la femme d’Aymar, l’Anglaise, et Mademoiselle Cécile. Cette évaluation de 180 000 francs comprenait les bois, les cheptels, le château et les meubles. L’expert se chargerait de trouver un acquéreur. Ainsi l’inquiétude d’Aymar pouvait-elle s’expliquer. Mais aussi n’y avait-il pas un conflit d’intérêt l’opposant à son neveu Jacques de Cangis, dans un projet avorté d’une trouble affaire d’exploitation d’une compagnie d’eau ?
N’avait-il pas, quatre mois après la mort de sa belle-mère, tenté de vendre des tableaux attribués à Théodore Rousseau mais qui se sont révélés être des faux ? Ce qu’atteste un procès-verbal de décembre 1917, signé des experts désignés par la cour d’appel de Paris ? Voici les conclusions du commissaire-priseur Coutanceau adressées à Saurat :
« Il en résulte une diminution très sensible dans le produit éventuel de la vente mobilière. Lorsque vous m’avez demandé si je pouvais me charger d’acquérir… des objets profitant à la vente, je pensais qu’il ne s’agissait que d’un nombre très limité. Jamais il ne me serait venu à mon esprit que les achats s’appliqueraient à la presque totalité. Ce pour quoi je me suis engagé envers le propriétaire de l’immeuble et ne pas me dessaisir du produit de la vente jusqu’à ce que les loyers fussent payés. En n’encaissant qu’une fraction minime du produit de la vente, je me libère de mon engagement constaté par lettre. Combien il est regrettable que des questions soient soulevées à la dernière heure ? Notez que je vous ai écrit dès le 12 novembre ! Il y a donc plus d’un mois. Donc il était très facile d’aborder beaucoup plus tôt la question des achats à la vente. Dans ces conditions, j’ai pensé qu’il serait préférable de vous demander de venir vous-même, comme vous me le proposiez. »
Aymar avait ainsi eu l’intention de liquider tous les biens de sa belle-mère. Mais les procédés du châtelain furent mis en cause par le commissaire-priseur lui-même. Bien sûr, les filles d’Aymar avaient du ressentiment contre lui et il y avait incontestablement de bonnes raisons, cependant peut-être n’étaient-elles pas exemptes de malignité atavique. Un mot du 22 août 1918, écrit à Saurat par le garde de la propriété du Livradois, est un indice du comportement probablement blâmable de Claire, quelques temps après la mort de la grand-mère maternelle :
« Cher Monsieur, M. le baron de Genévrier doit venir en Livradois ce 28 courant. Confidentiellement, comment dois-je faire savoir à M. le baron l’histoire de Mme Claire. Je crains qu’il vérifie avec l’inventaire le mobilier, alors il verra les affaires prises par Mme Claire. Auriez-vous mis M. le baron au courant de cette affaire ? Veuillez, cher Monsieur, me donner la marche à suivre en cette circonstance. Je vous remercie… Garde J. E. »
Rien de surprenant à relever les traits psychologiques et comportementaux caractérisant la famille Genévrier, se perpétuant depuis des décennies. La rancœur d’Aymar de Genévrier à l’égard de son neveu était au paroxysme. Assurément, il considérait comme un raté Jacques de Cangis, ce jeune homme de vingt-deux ans. Comme il l’avait fait deux ans auparavant pour sa fille aînée Claire et son fiancé (son cousin germain) il se résolut à écrire en août 1920 à un proche parent à qui il tint des propos durs et définitifs, révélant une situation familiale bien loin de l’esprit chevaleresque dont se gargarisaient habituellement les gens de cette caste :
« C’est un garçon sournois qui insidieusement aidé de ma sœur, sa mère, travaille sans relâche depuis dix-huit mois à atteindre le seul but convoité, la fortune de Cécile, pour en disposer et doter Germaine, la jeune sœur de quinze ans de Jacques. Et la pauvre Linotte de Cécile ne voit rien. Il est vrai que mon beau-frère est mort l’année dernière sans laisser de gros moyens à sa famille. »
Il dessina un sinistre tableau de sa parenté :
« Une fois le mariage accompli, ils se paieraient toutes leurs fantaisies, jouant aux cartes, à la Bourse, voyageant aux frais de ma malheureuse enfant, devenue leur vache à lait. »
Et il continua ainsi, déversant son fiel, à décrire les pires des personnages qu’auraient été sa sœur Jeanne et ses neveux. Il affirmait que Jacques était privé de toute qualité intellectuelle et morale :
« Pas un centime, pas un diplôme, aucune situation présente et à venir en perspective, que des dettes et c’est tout, n’ayant même pas de quoi s’habiller, ni se nourrir, tout récemment évincé et chassé de l’école de Saint-Maixent, mais par contre, un arriéré criblé de dettes, de créanciers et fournisseurs impayés jusqu’ici qui ne consentent d’atermoyer, patienter et leur accorder un léger crédit sous l’heureuse perspective du très prochain mariage de la riche héritière appelée à venir à leur secours pour les rembourser et apurer leurs dettes, comme ils en ont de tous les côtés et de longtemps. Vous voilà fixés ! »
Il persista dans ce style alambiqué, se plaignant d’être abandonné du Ciel et de subir la douleur et la déception d’avoir mis au monde deux filles aux goûts si pervers qui attentaient à son honneur ! Et il concluait sa lettre :
« Je disais récemment à Cécile que si je ne pouvais pas répondre de son honneur, de sa dignité et de sa loyauté comme de sa franchise, en tant que père et tuteur, je ferai tout ce qui dépendra de moi pour sauver sa fortune et elle s’est contentée de me répondre d’un ton fort dégagé : c’est ça, vous ferez bien ! »
Si, en effet, sa sœur Jeanne était en difficultés financières au point d’emprunter tous azimuts, les finances du châtelain n’étaient pas pour autant reluisantes et la hargne contre ses filles pouvait s’expliquer. Il n’était pas aussi vertueux que la leçon de morale assénée à ses enfants l’aurait laissé entendre dans la lettre à son parent par alliance et ami Henri de Rondan. La riche grand-mère maternelle de Claire et Cécile les avait désignées comme ses héritières, bien qu’ultérieurement elle ait partiellement déshérité l’aînée estimant son comportement irrecevable. Aymar avait été du même coup écarté. Cette fortune provenait de leurs ascendants maternels, armateurs normands. Court-circuité, Aymar – à l’instar de ce qu’il suspectait chez sa sœur et ses neveux – visait à faire entrer l’héritage de sa fille dans son giron, en vue de financer l’avenir d’Edward de Genévrier son dernier-né.
Au secours, la bourgeoisie !
Aymar de Genévrier arrangea donc un plan pour régler la situation à son avantage. A une vingtaine de kilomètres au Nord-Ouest de son fief, vivaient les Taznal, une famille de riches propriétaires terriens qui pour singer l’ancienne noblesse avait acquis en 1868 un imposant château du 13ème siècle. Le fils aîné, Eloy, sans grande valeur intrinsèque, n’avait alors que vingt-deux ans et connaissait de loin Cécile.
Le 10 septembre 1920, le père de Cécile téléphona aux Taznal :
- Mon cher Jean-Baptiste, pouvons-nous nous entretenir d’une situation qui pourrait à la fois me faire sortir d’une ornière pénible et vous permettre, si vous y consentez, de caser votre fils Eloy dont on connaît l’insouciance ?
Un rendez-vous fut fixé. Aymar se déplaça dans l’impressionnante demeure montmaraultoise.
Bien que la famille de Genévrier ne fût issue que de hobereaux, le châtelain s’autorisa à en faire un portrait pompeux, ne refusant pas qu’on lui donnât du Monsieur le baron ! Sans doute une caractéristique acquise des Genévrier qui se perpétue jusqu’aux débuts du 21ème siècle. Il parla, parla, évoqua les yeux levés vers le plafond, l’ancienneté et la notoriété de sa famille qui l’avait menée, quelques dizaines d’années auparavant, dans l’entourage de Napoléon III, en particulier du demi-frère de l’empereur. Persuasif, il hameçonna le bourgeois en mal d’anoblissement avant de lui faire connaître son plan.
- Voici, mon cher Jean-Baptiste, je vais vous livrer mon désarroi… Vous seul pouvez m’aider et en même temps y trouver un certain intérêt ! Ma fille, celle que j’ai eue il y a une vingtaine d’années avec ma première femme, morte prématurément à l’âge de 32 ans, a eu récemment une relation furtive au château avec son cousin germain venu passer quelques vacances au début de cet été. Et je viens d’apprendre, il y a quelques jours seulement, qu’elle est enceinte. Evidemment, il est exclu qu’ils puissent se marier. Lui, petit militaire sans envergure ni ambition, est complètement immature et instable, de plus désargenté… Elle est encore désorientée par l’absence de sa mère, le décès récent de sa grand-mère maternelle, par mon remariage et la présence de son demi-frère, mon dernier-né Edward.
Le silence s’imposa dans le grand salon. Jean-Baptiste baissa longuement les paupières, puis à voix basse, mais fermement, il ordonna à la domestique :
- Allez chercher ma femme !
D’un pas décidé s’avança, maîtresse femme, la cinquantaine, la Dame du Lieu. Elle s’assit en face de Jean-Baptiste :
- Gabrielle, notre ami Aymar vient de m’exposer longuement une situation bien compliquée mais qui pourrait trouver solution si nous l’étudions de près.
Et Jean-Baptiste parla pendant vingt minutes, alternant entre les références au passé glorieux de la famille du châtelain et à la situation problématique de leur fils Eloy.
- En somme, dit calmement la femme de Jean-Baptiste, pragmatique, vous nous proposez de marier votre fille de vingt ans, enceinte, avec notre fils de vingt-deux ans. Dans le principe, je ne m’y oppose pas, mais cela doit s’étudier de près car il faudra bien trouver une solution pour l’enfant à naître. Nous sommes en septembre, et si j’ai bien compris, elle est ainsi enceinte de trois mois et donc l’enfant devrait naître en mars prochain. Je ne me trompe pas ?
- C’est bien ça, chère Madame, répondit Aymar.
Ils échangèrent longuement, élaborant un plan sophistiqué. Aymar se leva et salua courtoisement :
- « Je vous téléphonerai la semaine prochaine, conclut-il. »
Le châtelain valétudinaire respira mieux. Il avait, semble-t-il, su convaincre ces bourgeois en mal de reconnaissance à tout prix.
l'affaire est dans le sac
Le temps sembla long à Aymar. Cette attente fut fructueuse, puisqu’à peine quinze jours après leur entretien, un appel téléphonique de Jean-Baptiste Taznal apaisa son inquiétude :
- Mon cher Aymar, nous avons longuement réfléchi à vos propositions et nous sommes tombés d’accord pour le mariage de nos deux jeunes gens, cependant il ne nous semble pas possible de garder l’enfant. Nous vous proposons de tout organiser pour novembre. Etes-vous d’accord ?
- Comment ne le serais-je pas, cher Jean-Baptiste, vous qui avez trouvé la solution à cette bien triste situation, mais qui pourra sans doute trouver une issue heureuse.
Pour neutraliser toute velléité de Cécile, le châtelain lui demanda d’annoncer à sa sœur aînée Claire, son mariage avec Eloy Taznal ; elle lui répondit dès le 14 septembre 1920.
Dans cette lettre, elle commençait par la remercier de son courrier lui annonçant son mariage et lui présentait ses vœux les plus sincères de bonheur (on sait que cela sera inopérant !) Mais ce qui paraît le plus étrange, et relèverait d’une certaine duplicité, c’est qu’elle lui disait avoir fait le bon choix tout en lui reprochant de ne pas l’avoir mise au courant avant, bien que les échanges entre les deux sœurs aient été rares. Elle avouait d’une certaine manière que leur père, Aymar de Genévrier, l’avait informée, sans que Cécile ne l’ait su, de son intention d’épouser son cousin Jacques. Alors qu’elle-même avait subi quelques années auparavant le même sort que Cécile, elle estimait que sa sœur avait été entraînée dans un mauvais pas et écrivait, cultivant sans doute l’ambiguïté :
« Malgré les bons conseils de papa et un peu plus tu aurais fait la même bêtise que j’ai faite, pour ne l’avoir pas écouté… ta lettre m’a rassurée… je ne doute pas que tu seras très heureuse… »
En passant, elle faisait allusion à la santé déficiente de son père et disait à sa sœur qu’elle ne pouvait pas lui donner son adresse car elle était sur la Côte d'Azur et ne savait pas quand elle rentrerait. Elle concluait :
« En tous cas, Maître Saurat est toujours au courant de mes villégiatures et je suis certaine qu’il ne te refusera pas, comme il vient de le faire très aimablement, de m’envoyer tes lettres. »
A la lecture de cette correspondance, on pourrait supposer que Claire ne savait pas que sa sœur était enceinte. Ce Saurat n’était autre que l’avoué et homme d’affaires d’Aymar, installé dans un bourg du Bourbonnais, ville à qui l’on attribuait à tort la devise Nul ne s'y frotte si gant n'a. Il était en outre l’homme d’affaires des Genévrier depuis le début du 20ème siècle.
L’efficacité bourgeoise
En prévision du mariage de Cécile et d’Eloy, les bourgeois, fortunés et bien organisés, se chargèrent de tout. Une liste fut établie de deux cents invités, classés selon leur rang social, distinguant les notables et les châtelains de la région ! La signature du contrat et la cérémonie de mariage eurent promptement lieu le lundi 15 novembre 1920, dans le fief d’Aymar, où s’était établie au début du 18ème siècle – par achat des terres et du château d’une ancienne baronnie éteinte dans le nom – la famille Genévrier (sans particule, celle-ci ayant été ajoutée postérieurement), issue de hobereaux du 15ème siècle.
Pour autant, le mariage religieux – la grossesse en cours de Cécile n’était pas un obstacle, car, comme l’écrira postérieurement Cécile à l’homme d’affaires de son père, « on s’arrange toujours avec le ciel » ! – eut lieu en Livradois. On doit rapporter ici une anecdote d’un goût douteux : la nuit précédant la cérémonie, des plaisantins avaient disposé à l’entrée de l’église un tombereau plein de fumier. Etait-ce un présage ?
A l’évidence, les aristos de la province ne s’étaient pas bousculés au portillon de la demeure pour répondre à l’invitation. La photo de mariage ne révèle pas une assemblée des plus élégantes, plutôt un groupe de terriens replets et endimanchés. Même, Joseph Lepive, magistrat, historien, maire du bourg proche du fief d’Aymar, apparenté à la mère d’Eloy, et sa femme Yvonne, avaient décliné l’invitation.
En tout cas, ils avaient manqué l’essentiel : le dîner pantagruélique dont voici le menu :
Consommé double sans-gêne
Petites bouchées financières
Médaillon de saumon blanc américaine
Filet de charolais Dubarry
Perdreaux et poulardes truffés
Salade
Petits pois mode d’Isigny
Gâteau succès
Friandises
Fruits
Gâteau favori
Parfait abricot
Dessert
Repas joliment présenté au verso d’une carte montrant au recto le château des Genévrier à son avantage !
L’écervelée se rebelle et découvre la réalité
Après les cérémonies, le couple s’installa dans la propriété du Livradois dont Cécile était la légitime héritière. Très rapidement, elle se rendit compte que son père avait mis la main sur ses finances, bien qu’elle fût légalement émancipée par son mariage. Elle envoya une note à Saurat, l’avoué et homme d’affaires de son père, qui révèle que, malgré son mariage avec Eloy, elle ne disposait pas de sa fortune. Cette fortune dont se gargarisait Aymar de Genévrier dans la lettre à son ami Henry. C’est avec amertume qu’elle écrivait à Saurat :
« Vous et mon père vous me disiez sans cesse tant que j’étais jeune fille que j’avais un million cent mille francs de capital (si l’on en croit le convertisseur officiel de l’INSEE, cela correspondrait à une véritable fortune en euros) et depuis que je suis mariée je n’ai comme revenus que la modeste somme de trois mille quatre cent quatre-vingt-dix francs de la Banque Chalus. L’amour ne fait pas vivre, et si je n’ai que le revenu de Chalus pour le mois de mars, je posséderais l’immense somme de dix francs et les comptes de tutelle. Je crois que vous et mon père croyez que nous les avons oubliés. Régulièrement, nous devions les avoir à notre mariage et voilà trois mois que nous les réclamons ; il y a un tripotage qui se combine ; nous saurons quand même voir s’ils sont exacts et agir comme il conviendra. »
Les embarras financiers de Cécile ne faisaient que commencer. Ils la suivront tout au long de sa vie, jusqu’à sa mort, se traduisant par d’innombrables courriers, d’abord avec son père et Saurat puis avec les banquiers, enfin avec son fils.
Vous avez dit « X »
Un moment de honte est si vite passe
Le plan qu’avaient élaboré Gabrielle Taznal et son mari Jean-Baptiste, Aymar le châtelain et très certainement sa femme, l’austère Anglaise, et peut-être d’autres comparses ayant constitué le conseil de famille, avec, à l’évidence, l’acquiescement des jeunes mariés, prévoyait – on aurait pu hurler d’indignation – l’abandon sous X de l’enfant ! Toute cette élégante société – réduite de fait à une étrange engeance – envisageait, sans douter un seul instant, que le jeune couple mettrait au monde, le moment venu, un héritier légitime, alliant fortune et noblesse.
On peut se demander comment ces jeunes gens de vingt et vingt-deux ans vécurent les quatre mois de grossesse qui suivirent leur mariage jusqu’aux premiers signes de l’accouchement. Le moment venu, tous deux partirent pour Toulouse. Dans le but de donner suite au sombre projet, Cécile se trouvait dans une institution catholique, attendant le pire : la mise au monde et l’abandon de son enfant dans l’anonymat. Son mari était là, compère.
Ainsi, huit jours avant la naissance, Cécile était dans la chambre où son enfant sera déposé. Et, toujours se considérant sans moyens financiers à la hauteur de ses prétentions, c’est de cet établissement qu’elle écrivit à nouveau à Saurat une note cinglante réclamant ses revenus de la Société Générale :
« Il est ridicule pour un jeune ménage dans notre position (La morgue de classe réapparaissait malgré la situation incongrue) d’emprunter lorsqu’il a de l’argent qui dort. »
Alors qu’elle et Eloy étaient à quelques jours de l’abandon, elle devint exigeante :
« Il nous faut absolument de l’argent immédiatement, ce n’est pas dans un mois ou quinze jours mais de suite. Vous devez bien savoir qu’il n’est pas dans nos principes d’emprunter à droite et à gauche. »
En mars de l’année 1921 venait au monde un garçon né de père et de mère non dénommés, désigné par trois prénoms, le dernier servant de patronyme ! Un anonyme. Serait-il un de ces innombrables condamnés à naître sans raison, laissant présager une vie d’incertitude, se prolongeant par faiblesse et se terminant par accident ? Pourtant, le dernier prénom, peu commun en France (Cécile l’avait probablement choisi en mémoire de sa nounou anglaise), fait l’objet de curieux commentaire ; c’est une énigme :
« C’est un précurseur, ou un marginal. Enfant, il est curieux et inquiet, enclin à se poser beaucoup de questions. Ses parents se doivent de lui répondre, afin de ne pas tarir sa soif de connaissances. Sa double personnalité à la fois rieuse, rusée, éclectique, surtout s'il est né en mars. »
Il fut alors confié à une veuve de guerre de la région toulousaine devant – théoriquement – lui assurer un futur viable.
quand la vénalité est garante de l’atavisme
Comme il avait caractérisé la filiation précédente, le rapport à l’argent fut aussi un réel problème pour Cécile, comme il le sera pour les générations suivantes ; ce travers réapparaîtra, accablant sa progéniture, comme une maladie héréditaire récurrente. On peut se poser légitimement la question du déterminisme psychologique et social qui se traduira chez Cécile et sa descendance par de perpétuels et cruels conflits d’argent.
A dix-huit ans, en 1918, Cécile recevait de son père cinquante francs par mois d’argent de poche pour ses menus achats, somme élevée selon la conversion de l’INSEE. Elle était alors pensionnaire dans une institution catholique de la capitale auvergnate, mais pour autant sortait beaucoup et faisait une large consommation de bas de soie, de gants…
Lors de son mariage avec Eloy Taznal, sans profession, en novembre 1920, le contrat sur la base du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts fut établi devant Mtre Pyrou, précisant que Cécile apportait une dot d’un million cent quatre-vingt-neuf mille francs, constituée de divers meubles et objets mobiliers, tableaux et bijoux d’une valeur de cent mille francs, de diverses valeurs et créances d’un recouvrement certain de sept cent quatre-vingt-quatre mille francs, d’une propriété en Livradois évaluée à deux-cent mille francs, de diverses valeurs estimées à cent cinq mille francs. Eloy le reconnaissait et consentait à en être chargé vis-à-vis de Cécile de Genévrier.
Lui-même apportait cent quatre mille francs, constitués de la somme de cent mille francs en bons de la Défense Nationale, divers meubles et objets mobiliers évalués à quatre mille francs. De plus, Jean-Baptiste Taznal, père d’Eloy, accordait à son fils en considération du mariage, une rente ou pension viagère de trois mille francs ; elle pouvait être reversée sur la tête de Cécile en cas de décès d’Eloy. En cas de décès de Cécile, cette rente serait reversée sur la tête des enfants nés du mariage et devait cesser au décès du donateur.
Sans doute était-ce à l’initiative de son père, pour payer sa part des frais de mariage en 1920, qu’une très grosse vente de bois lui appartenant avait été effectuée, mais était-ce exclusivement au profit de Cécile ? Toujours en difficultés financières, elle s’adressa à nouveau en décembre 1921 à Saurat, quelques semaines après son mariage. Plus encore – exaspérée d’attendre l’argent qu’elle estimait lui être dû – elle lui envoya un huissier. Alors l’avoué, fidèle homme d’affaires des Genévrier depuis une vingtaine d’années, lui répliqua le 30 décembre, rappelant qu’elle portait le nom de Genévrier… Il précisait dans une lettre de décembre 1921 :
« Madame, c’est vous qui m’envoyez l’huissier, vous qui portez le nom de Genévrier, de cette famille dont je défends depuis près de vingt ans avec le dévouement que l’on sait, la fortune et l’honneur, arrêtant, hier encore les langues déliées sur Toulouse au risque d’une histoire épouvantable. C’est la reconnaissance ! Oui, c’est vous qui tentez de me nuire en permettant à un huissier, au receveur d’Enregistrement de croire que je peux être votre débiteur alors que vous me devez plus de TRENTE SIX MILLE FRANCS. C’est le remerciement ! Avoir tiré net un million avec intérêts, de bois que l’on était sur le point de céder à 650 000 francs à terme sans intérêt. Être empoisonné depuis quatre ans de cette affaire et recevoir du papier timbré de vous. C’est peu banal ! Je n’ai jamais eu depuis près de vingt-cinq ans que je suis avoué la moindre difficulté avec un client. Je n’en aurai pas davantage avec vous. Je vous fais signifier par huissier le compte qu’à deux reprises je vous ai adressé. Je suis à votre disposition pour le vérifier avec les pièces à l’appui. Entendre vos observations et le régler devant votre beau-père. Je vous présente, Madame, mes salutations. »
On peut évidemment noter combien le comportement de Cécile avait offensé l’avoué et homme d’affaires d’Aymar. En fait, le sentiment partagé dans la famille de Genévrier était que Saurat avait l’art d’associer ses intérêts à ceux de ses mandants et que donc la propre fortune de l’avoué ne s’était pas bâtie sur ses simples compétences. Ainsi, d’autre part, Saurat soulignait-il que la grossesse et l’accouchement de Cécile, puis l’abandon de son enfant n’étaient pas passés inaperçus tant à Toulouse qu’en Auvergne et que le scandale avait failli éclater. Il sous-entendait avoir assuré un rôle protecteur de l’honorabilité de Cécile.
Peut-on s’imaginer ce qu’a pu être alors la vie au quotidien de ce couple se réclamant de la bonne société, qui venait d’abandonner – en connaissance de cause – un enfant dans l’anonymat d’une institution religieuse à plus de 400 kilomètres de sa famille naturelle, cette famille qui l’avait largué comme un objet sans valeur. N’était-ce pas là l’ultime expression du cynisme et de la suffisance sociale ? On ne peut pas ne pas penser au livre de Michel Polac, Maman, pourquoi m’as-tu laissé tomber de ton ventre ?
Le poids de l’hérédité
Cécile avait-elle fait part à son cousin Jacques de Cangis de cette situation dont ils étaient, nolens volens, solidairement la cause ? Oui. Les échanges de courriers entre son cousin germain et son père démontrent que Jacques de Cangis avait envisagé le mariage. Il avait même écrit à la mairie proche de la propriété du Livradois pour affirmer sa volonté d’épouser sa cousine, contrairement à ce que laissait supposer çà et là Aymar de Genévrier. Pour autant, Cécile, des années après, dira cruellement à son fils que cet homme avait été atteint de syphilis, comme le petit Jean, devenu alors Jean de Genévrier, le rappellera dans sa lettre du 28 mai 1954, figurant au début de ce récit. Quelques cinq ans après la naissance de son fils naturel, sous le coup du remords peut-être, Jacques de Cangis se suicidera à Paris en août 1926. Mais était-ce la vérité ? D’aucuns racontèrent qu’il avait été assassiné ! Pourtant, en mai de l’année de sa mort, il écrivait à l’avoué Saurat pour régler l’affaire de la société des eaux Ozina qui l’opposait à son oncle, le père de Cécile. Y avait-il un rapport quelconque entre les conflits de Jacques de Cangis et son oncle Aymar de Genévrier et les circonstances de sa mort ?
Que furent, pour les uns et les autres de cette fine équipe, les quelques années qui suivirent l’abandon de Jean ? Car tel fut momentanément l’un des prénoms de cet enfant déposé dans une chambre anonyme. Un enfant aux trois prénoms.
Et la postérité alors ?
Pour répondre à l’attente de leur famille respective, Eloy et Cécile tentèrent de donner du sens à leur couple en envisageant une progéniture. Mais il arrive que la liberté de mœurs ait des effets négatifs, même tardivement. Une grossesse se termina par un enfant mort-né. Atteinte de salpingite, Cécile devint stérile. Dès lors, on peut s’imaginer ce que fut le climat familial au quotidien de ce couple. Que pouvait donc être cette vie ? Un prêtre, l’abbé Moreau, avait un regard des plus réalistes. Il écrivait à Cécile en juillet 1923 :
« Je ne comprends que trop le tragique de votre situation et ne puis que vous dire ‘espérez en Dieu’ envers et contre tout […] J’avais déjà appris le départ de vos domestiques… cela seul était de fâcheuse augure pour la stabilité de votre intérieur […] Votre santé ne s’est pas améliorée me dites-vous et vos exigences personnelles ne se sont pas accommodées jusqu’ici du service d’un train de maison restreint. Si dure que soit cette épreuve pour votre amour propre, il vous faudra l’accepter… pour l’amour de Dieu et de votre mari, quand même. J’en suis à me demander s’il ne vaudrait pas mieux vous débarrasser de vos dettes inquiétantes par une vente d’une partie quelconque de votre propriété. Je sais que votre père, étant donné son caractère, ne se dessaisira jamais d’une somme dont il a l’usufruit. Son train de maison est tel à lui aussi !... Et puis, le ferait-il, j’en suis à me demander aussi, votre situation serait-elle liquidée après ? Non que je sache le total de vos dettes, mais je n’ignore pas, ma pauvre enfant, vos goûts qui ne cadrent plus, hélas avec vos moyens. Oh, que votre angoisse morale me fait penser à des choses que je ne puis confier à ce papier ! Les desseins de la Providence à votre endroit me paraissent assez clairs, mais vous les dire est extrêmement délicat, il me faudrait un entretien avec vous et votre mari ensemble […] Plaie d’argent n’est pas mortelle, si vous gardez l’amour de votre mari, vous avez le principal et vous l’avez n’est-ce pas. »
L’abbé ayant des doutes sur l’état d’esprit de Cécile, lui écrivit à nouveau en octobre 1923 :
« Où en êtes-vous de vos affaires, de vos procès, de vos domestiques ? J’ai bien pensé à vous tous ces temps et surtout pendant que vous étiez à Lourdes. Dans votre dernière lettre vous ne me parlez pas de Monsieur Eloy. J’espère que tous vos ennuis n’ébrèchent en rien sa solide santé […] Melle Laubignat m’a donné quelques nouvelles de votre tante de Cangis qui est aux abois n’ayant plus de quoi vivre et empruntant à qui peut lui prêter, Melle Laubignat en sait quelque chose. Votre père m’avait annoncé que votre frère Edward allait changer encore une fois de collège. Je dis ‘encore une fois’, car c’était pour le moins la troisième. Avec ce système, je doute qu’il arrive à faire un bachelier. »
Par acquis de conscience, cet ecclésiastique envoya un mot à Cécile et à son mari en novembre 1923 :
« Mes chers amis, Je rentre de voyage […] Déjà trois ans que vous êtes mariés ! Que d’événements pendant ces trois premières années de votre mariage : votre installation en Livradois, vos déboires avec vos domestiques, vos procès, les coups de votre ancien régisseur, le partage des biens de votre père ou beau-père, sans compter le reste. En style de guerre, je dirais votre ‘curriculum vitae’ est déjà bien fourni. Mais vous êtes jeunes et l’avenir vous sourit malgré toutes vos épreuves. Ah ! si vous aviez un chérubin pour égayer votre intérieur, comme toute difficulté s’aplanirait !
Ces échanges épistolaires sont bien utiles à l’évidence, pour comprendre l’évolution de ce couple. On remarquera que ce prêtre semblait ignorer l’abandon du petit Jean. On notera aussi que la culture du procès était déjà ancrée parmi les Genévrier depuis plusieurs générations. Une affaire d’héritage – déjà – avait fait l’objet d’un important article dans la Gazette des Tribunaux du 8 octobre 1851, concernant un autre Aymar de Genévrier, aussi procédurier que ce lointain cousin dont nous parlons dans le présent ouvrage. Ne disait-on pas de lui que :
« Capitaine au régiment de Conti-Dragons en 1778, c'était un homme d'un caractère absolu ; il voulait dans sa famille une discipline aussi sévère, une obéissance aussi complète que celle qu'il exigeait au régiment. »
Ce goût pour les querelles familiales fratricides se transmettra aux générations suivantes. D’ailleurs, des décennies plus tard, certains parmi les Genévrier se prendront – sans avoir fait d’études particulières – pour des hommes de loi, s’imaginant qu’il suffit de singer le vocabulaire judiciaire pour s’improviser avocat !
En fait, tout alla mal. Premier symptôme : en 1924, Eloy déserta le domicile conjugal. Sans progéniture, le couple vacillait. Il semblerait que ce fut cet état de fait mais aussi les conseils avisés d’un religieux, l’abbé Dorgelet, qui les amenèrent, l’un et l’autre, sans doute avec l’assentiment des parents, à envisager, dès 1927, de reprendre, comme un objet laissé en gage en quelque sorte, le petit Jean abandonné six ans auparavant dans une famille aimante de la région toulousaine. Mais peut-être, souhaitons-le, le châtelain, souffreteux et vieillissant, avait-il eu un remords, teinté d’humanité. Pouvait-il oublier qu’il avait lui-même un jeune fils de treize ans ?
Le couple battait de l’aile. La belle-mère de Cécile, Gabrielle, la redoutable mère d’Eloy, ne manquait jamais l’occasion d’humilier sa belle-fille et de raviver les querelles.
Aymar vieillissait mal, entre douleurs physiques, hostilité de ses filles et préoccupations financières permanentes. Il avait déjà soixante-et-un ans et il se souvenait que son père était mort à soixante-quatre-ans, son grand-père à quarante-sept ans, sa mère à trente-neuf ans… alors ? Alors, même s’il avait envisagé très tôt d’amener sa fille à reprendre son enfant abandonné, il devait réfléchir à ce qu’il avait suscité ou permis au cours des six à sept années précédentes. Qu’était devenu cet enfant ? Son petit-fils, qu’il l’ait voulu ou non. Naturellement, comme la majorité des familles de sa caste, le châtelain entretenait des relations avec les représentants de l’église. Ce ne sera pas le cas du petit Jean, devenu Jean de Genévrier, et de sa postérité qui, ignorants de l’enseignement de l’Eglise, se comporteront comme des impies.
Fin décembre 1924, Cécile, sans doute nostalgique, échangeait avec Miss Harriet son ancienne gouvernante anglaise, pieuse et bienveillante, évoquant les années heureuses de l’enfance auprès de la grand-mère du Livradois qui, selon les souvenirs de cette Anglaise, était si généreuse. Cette ancienne gouvernante avait subi de nombreux décès et maladies et elle exprimait le regret de ne pas pouvoir retourner en France, pays qu’elle aimait. Sans doute ces échanges épistolaires adoucissaient-ils la triste vie de Cécile. Bien évidemment, cette pieuse femme ignorait tout de l’abandon du petit Jean par son ancienne Little girl.
Acheter l’enfant pour se racheter
De l’indécis projet de récupérer l’enfant, considéré comme un antidote à l’infécondité du couple, on passa à la décision de reprendre effectivement l’enfant abandonné, puis aux démarches concrètes. Dès 1927, le couple privé de postérité fut activement aidé et conseillé par l’abbé Dorgelet, proche de la famille de Genévrier. Il connaissait parfaitement la situation et était devenu, en quelque sorte, le directeur de conscience de Cécile. Mais ces décisions ne furent pas exemptes de vives discussions.
L’abbé avait réussi à conduire Eloy à de meilleures considérations, en se demandant tout de même si cela durerait. Et en décembre 1928, sans doute en traînant les pieds, Eloy Taznal signa une déclaration officielle s’engageant à recevoir l’enfant de sa femme dans son foyer. Ce document fut établi en présence du représentant de l’inspection de l’assistance publique de la Haute-Garonne et la signature d’Eloy officiellement légalisée par le maire du bourg proche de la propriété du Livradois.
Encouragée par l’engagement de son mari, Cécile de Genévrier reconnut son fils, en août 1929, devant le tribunal le plus proche en Livradois. Il avait huit ans et cinq mois ! Selon Boris Cyrulnik, à cet âge, les jeux sont faits ! Mais pour autant la remise de son fils par les services de Toulouse ne pouvait être effective qu’au terme d’une longue et coûteuse procédure. Le père de Cécile demanda conseil à un Sieur Bresson, directeur des services des Enfants Assistés de la Seine dans le bourg où Saurat officiait comme avoué.
Aymar en informa sa fille le 11 novembre 1929 :
« Je suis le premier à applaudir à la nouvelle consolante et rassurante des bonnes dispositions d’Eloy à ton égard, pourvu qu’elles se maintiennent ainsi (Dieu le veuille) ; à son âge, il devrait vraiment être sérieux et ne point se faire critiquer par tout le monde dans notre région qui blâme énormément son attitude, tout comme sa frivolité inadmissible et indifférence marquée envers toi […] Je m’empresse de te transmettre exactement les renseignements verbaux que j’ai pris hier samedi […] La première chose à faire est d’écrire à la Direction du lieu où se trouve ce pauvre petit pour demander de vous envoyer le bordereau exact des dépenses effectuées à ce jour et faire en même temps une offre pour le reprendre […] Au reçu de votre demande, l’Administration ouvrirait une enquête pour être complètement renseignée sur ta « MORALITE » personnelle surtout et suivant que les renseignements qui leur parviendraient là où ils jugeront à propos de les demander, l’Administration se montrerait plus ou moins coulante pour accepter ou non votre proposition »
Ainsi, pragmatique, calculateur, Aymar conseilla-t-il sa fille :
« Inutile de te livrer tout de suite en offrant une somme importante, cela ne changera rien aux choses. L’administration seule en décidera une fois son enquête effectuée sérieusement […] Je suis disposé de mon côté à te venir en aide mais il me faut l’acceptation écrite d’Eloy consentant à reconnaître et reprendre cet enfant, de plus une décharge, en vue de l’avoir, m’est absolument indispensable signée de vous deux en vue d’éviter des ennuis ou difficultés après mon décès, suivant le modèle que je m’empresserai de soumettre à votre attention, pour ne point entacher les clauses stipulées sur votre contrat de mariage, ni m’exposer (sinon mes héritiers, après ma mort) à provoquer une contestation et réclamation future en revendication des titres à ton nom dont j’ai la jouissance de ma vie durant, autrement dit l’usufruit sur lesquels, pour te faciliter le remboursement réclamé par la Direction de l’Assistance publique. Je suis tout disposé pour vous rendre service mutuellement à en céder une partie. Vous pourriez, dans ces conditions, bénéficier des revenus, sinon vendre ces titres, à votre choix, sans débourser d’argent. N’ayant aucune disponibilité en raison de mes bien modestes revenus personnels, comme de la propriété qui joint tout juste les 2 bouts avec ses recettes annuelles, une fois tous les impôts et charges acquittés, j’ai considéré que c’était l’unique moyen de parer à la difficulté pendante pour combler vos désirs. Je ne puis mieux dire, je crois, et vous devriez admettre que c’est un réel sacrifice de ma part, en raison des dépenses assez importantes et sacrifices que nous devons nous imposer maintenant, mon fils étant majeur, à qui nous devons assurer ses revenus annuels et l’aider pour finir ses études supérieures pour affronter le concours des Affaires Etrangères et se créer une situation un jour. Il faut pour cela que nous économisions pour y arriver ! »
Cette longue et amphigourique lettre du châtelain à sa fille, décidée à reprendre son fils confié par l’Assistance publique à une famille d’accueil de la région toulousaine, démontrait que cet homme calculateur, à la morale abondante quand il écrivait à son ami Henri en 1920, avait une éthique à géométrie variable, plus soucieux de ne pas se démunir que d’aider sa fille à récupérer son fils, son propre petit-fils. On apprenait du même coup qu’il restait réservé sur les intentions d’Eloy, en se demandant s’il respecterait son engagement de décembre 1928. En fait, la perspective de l’arrivée du petit Jean provoqua le pire.
D’autre part, Aymar évoquait les études de son fils Edward, destiné, selon lui, aux Affaires étrangères. Il omettait de dire que sa scolarité était laborieuse, ce garçon ayant changé de nombreuses fois de collège. Un des prêtres connaissant bien Aymar et sa famille s’interrogeait en 1923 :
« Je doute, avait-il écrit, qu’il arrive à faire un bachelier. »
La réalité s’oppose aux bonnes intentions
C’est Dorgelet, cet abbé bienveillant, qui accompagna Cécile et Eloy à Toulouse pour y récupérer l’enfant mis entre parenthèses. C’est aussi lui qui les aida dans le laborieux parcours administratif. L’ecclésiastique, devenu le directeur de conscience de Cécile, décrivit, dans une lettre adressée au châtelain, sa contribution à la restitution de l’enfant, le petit Jean. Il disait être heureux « d’avoir pu rendre ce service et avoir travaillé à aplanir les difficultés pour arriver à ce but qui, dit-il, s’imposait. » La rencontre entre l’enfant de huit ans et ce couple qui lui était étranger, était décrite par l’abbé Dorgelet comme un moment d’extrêmes émotions et il tenait à préciser que « grâce au ciel, ce petit a été très bien élevé par une nourrice qui le regardait un peu comme son fils. » De nombreuses années après, le petit Jean, devenu Jean de Genévrier, alla à Toulouse pour revoir cette nounou, mais trop tard ; elle était morte depuis quelques mois.
Le châtelain tergiversa, exaspéré par la situation. Cependant à la suite des nombreuses exhortations de l’abbé Dorgelet, il contribua financièrement, bon gré mal gré, au règlement des frais de 18 000 francs réclamés par l’Assistance publique pour rendre son petit-fils. Aymar avait aussi agi sur l’insistance du doyen dont il dépendait. Cécile, en effet, avait saisi les autorités religieuses locales se sentant foncièrement coupable et sans moyens réels d’action. En réalité, en ce temps, l’intervention des gens d’église sous-tendait souvent l’action des familles traditionnelles. Le doyen était théoriquement le plus âgé des prêtres des paroisses environnantes, et elle l’avait alors remercié :
« Monsieur le Doyen, Je vous accuse réception de votre bonne lettre et je tiens à vous dire de suite que si vous n’avez pas vu mon père, la lettre que vous lui avez adressée me semble l’avoir amené à de bons sentiments à mon égard. En effet, il m’a téléphoné mardi dernier pour me dire qu’il m’accorderait la somme nécessaire pour le retrait de mon enfant et qu’il comprenait la hâte que je témoignais. Il n’y a pas de doute que la grâce de Dieu lui a fait comprendre son devoir et je vous remercie bien vivement d’avoir été l’intermédiaire de la bonté divine. Excusez-moi, Monsieur le Doyen, si je n’ai pas hésité à avoir recours à vos bons offices et à votre charité et veuillez recevoir l’assurance de mes sentiments très respectueux. »
En fait, son père avait mis la main sur ses finances. Pour preuves, écrivant de Toulouse, au moment de retirer le petit Jean de l’assistance publique, elle demandait à nouveau à Saurat d’intervenir pour récupérer ce qui lui était dû. Les reproches ne tardèrent pas, comme Dorgelet en fit part au châtelain dans une longue lettre. Il rappelait que la belle-mère de Cécile, Madame Taznal, la redoutable mère d’Eloy, commençait à distiller les remarques acerbes. Naïvement sans doute, cet abbé pensait que « la chose » s’arrangerait, « à la condition de faire preuve de quelque diplomatie. Il eut été bien préférable de jouer franc jeu dès le début… » C’était surestimer les protagonistes de cette triste tragi-comédie. Comment ne pas penser que la duperie avait accompagné la réintégration du petit Jean dans sa famille naturelle ? Malgré les promesses du baron et de son homme d’affaires, le couple n’était pas financièrement autonome, et l’abbé Dorgelet dut souvent écrire tant au châtelain qu’à la mère d’Eloy pour leur exposer la situation et leur demander de s’acquitter de leurs devoirs parentaux. Le baron n’avait toujours pas renoncé à mettre, d’une manière ou d’une autre, la main sur la fameuse fortune (l’Arlésienne) de sa fille dont il faisait largement état dans ses courriers.
Sortie de l’anonymat
Comment le petit Jean vécut-il son installation dans l’austère bâtisse du Livradois ? Il éprouva indubitablement un sentiment d’abandon de la part de sa nounou auprès de laquelle il avait passé les huit premières années de sa vie. Opportunément, la mère de Jacques de Cangis, grand-mère paternelle naturelle de cet enfant installé depuis décembre 1929 auprès de Cécile et Eloy, écrivit une lettre à son frère Aymar. Ce courrier éclaire la personnalité – selon sa mère bien sûr – de Jacques de Cangis, le père naturel du petit Jean :
« Hôtel de l’Univers, V., probablement début 1930. Merci, mon cher Aymar de m’avoir adressé la mensualité avec la si bonne et intéressante lettre sur ce petit Jean que je serais tellement heureuse de connaître comme tu peux bien le penser ! Souvenir vivant de cet être que j’ai tant aimé, et dont il a dû prendre, d’après ta description, plus d’un point de ressemblance. Mais je ne voudrais pas qu’Eloy en souffre maintenant qu’il a fait un beau geste et qu’il semble prendre la vie plus sérieusement. Tu es gentil, toi aussi, de l’emmener avec toi, de l’initier sans doute à bien des choses ; mais tu ne me dis toujours pas dans quel milieu il était, pour avoir autant d’instruction et surtout des manières aussi bien élevées ! Il avait peut-être d’autres enfants avec lui ? Il doit être étonné de tout ce qu’il voit depuis 2 mois, pourvu qu’il ne s’ennuie pas s’il était habitué d’avoir des camarades ! Tu as l’air de le préférer à Dédé de R. comme genre d’enfant ! (fils de Claire, sœur aînée de Cécile, un autre petit-fils d’Aymar) S’il a la mentalité de Jacques (enfant) c’était le rêve ! Jamais désobéissant, franc, ouvert, complaisant pour tout le monde (parents et domestiques), consciencieux pour ses leçons et devoirs quand il avait à les faires seul, on n’avait jamais à le gronder ; comprenant à mi-mots tout ce qu’on lui disait, ne parlant pas, mais écoutant, observant tout, et quand on avait fini la conversation que R. et moi avions, elle ne supposant jamais qu’il aurait entendu, le pensant distrait par autre chose, tout d’un coup demandait ‘pourquoi vous avez dit ceci, cela ?’ Pour quelle raison préférez-vous cette chose ? Ce sont des esprits toujours ouverts qui enregistrent tout ce qu’ils voient et entendent, le gardent en eux et quand on ne s’y attend pas, sortent leurs réflexions. C’est pour cela qu’il faut absolument que ce petit Jean n’ait que de bons exemples devant les yeux, que rien de louche ne puisse le faire se demander pourquoi ceci, comment cela ! La religion est un très grand point acquis ; c’est beaucoup et pour cela, Cécile saura l’y maintenir, pourvu qu’elle n’exagère pas non plus ; les garçons ne sont pas raisonnables comme les filles ; il faut du doigté ! Enfin ! ta lettre, mon petit Aymar, m’a bien émue et fait grand plaisir, car cette présence à Genévrier me rappelle l’autre au même âge, alors qu’on n’en avait que de la joie. Ma vie ici n’a pas repris encore son activité mondaine car j’attendais ma mensualité pour payer quelques petites notes arriérées et je ne le pourrai pas ! Moi aussi j’ai eu des étrennes obligatoires à donner qui n’ont rien d’agréable, mais forcées, et je n’en ai pas reçues, ce qui est gênant. Si j’avais supposé cela, je n’aurais pas été avec G. pour Noël, quoique je ne l’avais pas vue depuis juillet (6 mois) et qu’aussitôt Mrs Breset en état, elle fait son possible pour aller la rejoindre à l’époque où les dames de Paris partent toutes pour 5 semaines ! Je tâcherai de ne faire qu’un repas par jour pour rattraper un peu les dépenses là et pour manger quand il fait mauvais puisqu’il y a un restaurant en bas, tandis qu’à Paris, n’importe où je descendrai pour loger, il me faudra sortir pour chaque repas et cela par tous les temps ! Je suis enchantée qu’Edward travaille aussi bien, mais pourvu qu’il ne se fatigue pas la tête, et qu’il ne prenne pas du mal en courant d’un cours à l’autre ! Je me demande si cette Mme Lamary n’est pas l’ancienne pensionnaire de la Comédie Française qui était fort jolie et si comme il faut d’allure, que je me rappelle bien d’autrefois ! Je l’ai souvent applaudie quand j’étais jeune femme ! C’est un monde très intéressant surtout quand elles sont bien nées ! Je ne sais pas qui était Mme Lamary mais j’ai connu Mme Bartet qui était remarquable, son fils était officier de marine, tué pendant la guerre ! Il y a actuellement Mme Dévoyord qui est remarquablement distinguée, a un talent admirable, donne des leçons de diction à toutes les jeunes filles du monde où du reste on la rencontre souvent dans les salons. G. a suivi ses cours pendant quelques temps pour la diction. Mme Dévoyord avait épousé un comte suédois qui est mort il y a quelques mois. Elle a un charmant hôtel particulier près du boulevard Pireire. Mme Pierat a actuellement beaucoup de succès encore ; elle est la femme à présent d’un peintre célèbre ! Je l’ai connue chez le comte François de Dion, auteur réputé ! Edward connaîtra forcément tous ces noms célèbres ! C’est en effet une bien grande et bonne décision qu’a pris le ménage Taznal ! Je ne peux te dire l’émotion que cela m’a fait en lisant cela mais en tout cas une bien douce, bien reconnaissante sensation pour Eloy qui, je suis convaincue à présent qu’il a donné son approbation, sera bon et paternel pour le pauvre petit qui était bien innocent du fait accompli. Je savais par des amis à lui, qu’il a à V. qu’il répétait souvent que si rentrant chez lui, il y trouverait un enfant, il en partirait moins souvent ! Par conséquent, ce que tu me dis confirme cet « on dit » et peut, peut-être, lui faire prendre son rôle au sérieux ! Il faudrait surtout que ce petit n’ait jamais que de bons exemples sous les yeux, sans cela il faudrait peut-être regretter ses parents nourriciers qui d’après ce que tu me dis, sont de braves gens. Comme c’est rare de tomber actuellement chez de bons chrétiens, mais étaient-ce des paysans ? des fermiers ? Pauvre petit qui a peut-être souffert dans son cœur, dans sa délicatesse native, des choses grossières, communes, qu’il ne comprenait pas encore mais pour lesquelles il avait une répugnance instinctive, sentant une différence de caste ! Quel dommage que Cécile ait été privée depuis 8 ans des meilleures années dont la mère profite le plus quand c’est tout petit, surtout chez un garçon qui devra commencer des études sérieuses bientôt. Pour le regard d’Eloy, il vaut mieux qu’il ressemble à sa mère ! Cela lui sera moins pénible ! J’ai toujours pensé, été je me rappelle te l’avoir dit, je crois, Eloy un très bon garçon dans le fond, il faut savoir le retenir pour soi (la chair est faible). J’approuve tout à fait ta manière d’agir et de penser vis-à-vis de Mme Taznal qui vraiment a des naïvetés un peu ridicules à son âge. Elle aurait dû la première supposer que si une demoiselle de Genévrier épousait son fils, c’est qu’il y avait une raison majeure (ce que c’est que l’orgueil de l’argent ! On croit qu’un de Genévrier est à genoux devant ! que l’argent seul suffit !! Et si son fils était prévenu et qu’il n’a pas trouvé bon d’avertir sa mère, tu étais encore bien plus en droit de n’en pas parler ! Elle se défâchera à un moment si elle a pour 2 sous de cœur et un peu de religion. Si ce pauvre petit est vraiment affectueux et gentil, s’il est en confiance avec toute la famille quand il la connaitra mieux, il me semble que Mme Taznal ne peut qu’applaudir à ce geste de son fils qui peut au contraire maintenant gagner au moral tout ce qu’il avait perdu, et rendre Cécile plus heureuse, en somme devenir un meilleur mari !!! Je sais que j’aimerais énormément connaître ce petit, tu dois me comprendre ! Un souvenir vivant de cet être que j’ai tant aimé qui était ma consolation dans les jours pénibles de mes travaux de 1900 à 1907 ! qui ne nous avait donné jamais que des satisfactions au collège trouvant cela si facile et naturel ! Oh ce maudit Paris ! cause de sa mort. Je te remercie en tous cas mon cher petit Aymar de m’avoir annoncé cet événement qui me rassure sur le pauvre petit être auquel je pensais sans cesse et qui me faisait une pitié profonde, mais Cécile m’avait dit il y a 2 ans que le chiffre demandé était trop exorbitant ! Qu’elle doit être heureuse à présent et avoir la conscience moins lourde ! Au revoir mon bien cher Aymar, bon retour à Genévrier quoique l’ouest doive bien souffler dans les tours ! Embrasse ta femme pour moi ainsi qu’Edward, comme je t’embrasse de tout mon cœur bien tendrement ainsi que le petit Jean. PS : Est-ce que ta femme pourrait sans se priver moindrement m’envoyer un peu de thé car je n’en ai plus et je n’ai pas de quoi en acheter, toutes dépenses étant supprimées jusqu’à nouvel ordre ! On prétend que les assurances sociales ne passeront pas ou surtout ne resteront pas ; elles sont honnies de partout ! Je t’embrasse de tout mon cœur mon cher petit Aymar ainsi que ta femme et le petit sans le lui dire, cela peinerait peut-être Cécile. »
Cette lettre, écrite probablement début 1930, soit quatre ans après la mort de Jacques de Cangis, est essentielle pour essayer de se faire l’idée la plus juste possible du contexte dans lequel le petit Jean se trouva après avoir été récupéré. Bien sûr, il faut nuancer le sens de ce courrier et, évidemment, restituer un semblant de vérité en tenant compte de qui étaient les uns et les autres. La sœur d’Aymar, après quelques considérations mondaines et outre l’usage abusif de points d’exclamation qui dénote une certaine exaltation, sinon un enthousiasme, semblait être une femme sincère, profondément affectée par la mort dramatique de son fils, Jacques de Cangis (suicide ou assassinat ?), père du petit Jean. Elle voyait cet enfant comme une dernière trace vivante de son fils à qui elle attribuait des qualités dont nombre de mères (mais pas toutes) rêvent pour leur enfant. Il ne faut donc pas compter sur l’objectivité. La description psychologique qu’elle faisait de son fils était diamétralement opposée à celle que dix ans auparavant en avait fait son frère Aymar à son ami Henri. C’est aussi de cette sœur Jeanne que parlait si péjorativement Aymar.
Dès le début de sa lettre, elle soulignait qu’Aymar lui avait envoyé la mensualité. En fait, cela fait allusion aux dispositions testamentaires de leur père prévoyant qu’Aymar, l’aîné des garçons, aurait la propriété de Genévrier, mais qu’en contrepartie il devrait verser à sa sœur et son frère cadet, une rente à vie et leur réserver un appartement dans le château.
Comme nous l’avons déjà dit, cette lettre jette la clarté nécessaire pour mieux comprendre la nature réelle des rapports familiaux des Genévrier. En effet, indirectement (car cette lettre est une réponse à celle qu’Aymar lui avait préalablement envoyée) la rouerie, la tromperie du châtelain y transparaît, à l’évidence sans que sa sœur ne s’en aperçoive, ce qui révèle d’elle une candeur qu’elle reprochait elle-même à la mère d’Eloy ! Naïveté, disait-elle, dans sa lettre. En effet, à la lecture de ce qu’écrivait la sœur d’Aymar, on aurait pu croire que les parents d’Eloy n’avaient pas été mis au courant de la grossesse de Cécile avant le mariage. Et c’est certainement ce qu’Aymar avait laissé entendre à sa sœur. Il est clair que cette maman, affligée par la mort relativement récente de son fils, était vulnérable. Et son frère n’avait eu aucun scrupule à la berner en lui laissant croire qu’Eloy et sa famille avaient été ignorants de l’état de Cécile lors du mariage en novembre 1920. Comment donc Cécile aurait-elle pu cacher son état à son mari pendant les quatre mois où les signes apparents d’une grossesse sont les plus évidents ? Comment les Taznal auraient-ils pu être bernés, alors que Maître Saurat, avoué et homme d’affaire d’Aymar avait écrit dès 1921 à Cécile que « les langues s’étaient déliées sur Toulouse au risque d’une histoire épouvantable. »
A l’en croire – et c’est, à l’évidence, à partir de ce qu’avait écrit Aymar à sa sœur – le petit Jean dès son arrivée en Auvergne et particulièrement près de son grand-père (mais l’a-t-il vraiment côtoyé longuement ?) aurait présenté « autant d’instruction et surtout des manières aussi bien élevées. » Donc, fut-ce au contact de son grand-père que le petit Jean développa ultérieurement une personnalité telle que sa propre mère, Cécile, la qualifia d’affreuse ?
Jeanne, la sœur d’Aymar se révélait aussi comme le pur produit d’une classe sociale maniant aisément le mépris. Rappelons un extrait significatif de cette lettre :
« Elle (la mère d’Eloy Taznal) aurait dû la première supposer que si une demoiselle (elle omet la grossesse en cours) de Genévrier épousait son fils, c’est qu’il y avait une raison majeure (ce que c’est que l’orgueil de l’argent !) On croit qu’un ‘de Genévrier’ est à genoux devant ! que l’argent seul suffit !! Et si son fils était prévenu et qu’il n’a pas trouvé bon d’avertir sa mère, tu étais encore bien plus en droit de n’en pas parler ! »
D’abord, cette – en apparence – sympathique femme ignorait les usages concernant les noms à particule, sachant qu’on ne doit jamais dire « je suis un ‘de’ Genévrier », mais « je suis un Genévrier », sauf si on fait précéder le nom d’un prénom ou d’un autre terme (titre, famille…), comme Jean de Genévrier ou la famille de Genévrier. Ainsi, il semble que cette famille fut ignorante des usages-mêmes de la caste dont elle se réclamait par ailleurs ! Cette caste dont cette brave femme parle à son frère en ces termes :
« Pauvre petit qui a peut-être souffert dans son cœur, dans sa délicatesse native, des choses grossières, communes, qu’il ne comprenait pas encore mais pour lesquelles il avait une répugnance instinctive, sentant une différence de caste ! »
Elle sous-entendait qu’il aurait pu souffrir du milieu modeste qui s’était chargé de sa prime-éducation.
D’autre part, on peut constater que, bien qu’elle exprimât un certain mépris pour l’argent, elle ne faisait qu’en parler, comme d’ailleurs tous les Genévrier au cours des deux derniers siècles. L’argent ? Comment pouvait-elle s’en passer au point d’écrire :
« Je tâcherai de ne faire qu’un repas par jour pour rattraper un peu les dépenses. » ?
Et encore :
« Est-ce que ta femme pourrait sans se priver moindrement m’envoyer un peu de thé car je n’en ai plus et je n’ai pas de quoi en acheter, toutes dépenses étant supprimées jusqu’à nouvel ordre ! »
Quelques années plus tard, la sœur d’Aymar manifesta à nouveau son intérêt pour son petit-fils, dans une lettre adressée à Saurat. Ce courrier est tout aussi intéressant et utile que le précédent pour comprendre l’univers dans lequel le petit Jean avait été hâtivement plongé depuis sa venue dans le Livradois. Comme la première, cette lettre n’était pas datée, mais, d’après son contenu, on peut supposer qu’elle avait été envoyée après la mort d’Aymar en janvier 1934. Le petit Jean devait alors avoir quatorze ou quinze ans.
« Paris 8ème, 7 décembre ? – Cher Monsieur, je ne sais pas si vous êtes au courant de l’état très inquiétant de Cécile, qui se trouve à la clinique Saint-Dominique à C. depuis une huitaine ! C’est le pauvre petit Jean qui m’écrit cela le 4 décembre, me disant que sa maman avait une forte crise aiguë d’appendicite avec complications d’ovaires enflammés, qu’elle parle tout bas et n’avale absolument rien, que du reste elle a été administrée. J’ai immédiatement téléphoné à mon médecin de venir voir si je pouvais partir pour C., tenir compagnie à Cécile, mais hélas ! après avoir examiné mon cœur et constaté l’emphysème que ce temps humide m’occasionne, il me l’a expressément défendu ! Et puis je marche encore très peu dehors. Alors peut-être que vous pourriez aller la voir, voir où elle en est la pauvre fille ! Et puis surtout que ses affaires vis-à-vis du petit Jean soient bien en règle ! Je crois qu’elle l’a reconnu lorsqu’elle est partie à Toulouse le chercher ; mais est-ce bien établi chez un notaire en Livradois ou en Auvergne ? Je ne me rappelle pas où ! Et pour son nom, à ce petit, ne pourrait-elle pas le lui donner dès à présent car s’il arrive malheur à Cécile avant que cela ne soit bien établi on ne pourra plus le faire après ! Or, pour son livret scolaire (baccalauréat et service militaire), son acte de naissance sera demandé. Alors, sous quel nom ? Déjà à R., les maristes ont refusé de prendre Jean à cause de ce nom qui n’est pas celui de sa mère ni de son soi-disant père. A M. ils l’ont accepté lui disant qu’ils fermeraient les yeux mais il n’y restera pas, les ??? y sont indésirés. Dans tous les cas, je crois qu’avec la mauvaise santé en général de Cécile, il est prudent de tout mettre en règle pour que ce pauvre petit soit à l’abri des plus grandes difficultés ; ainsi pour le testament ! Cécile en a-t-elle fait un ? Pour Jean ? Autrement, le divorce n’étant pas prononcé, c’est Taznal qui hériterait et le petit, pour recouvrer quelques millions de francs aurait 40% à donner, tandis qu’étant reconnu pour son seul héritier, Jean aurait ce qui doit lui revenir de sa mère ! Vous devez comprendre, vous, Madame Saurat et Melle Françoise que j’adore ce petit Jean, que s’il arrivait malheur à Cécile j’aimerais garder ce petit ! J’en ai d’ailleurs prévenu Cécile pour que dans ses insomnies et sa fièvre, elle puisse être rassurée sur l’avenir de ce cher petit que je n’abandonnerai jamais. Evidemment pour l’élever comme il doit l’être, préparer une carrière ou un métier je n’ai pas le nécessaire, mais la fortune de sa mère justement (quand les affaires de Genévrier seront arrangées) devrait y suffire, n’est-ce pas ? La 1ère chose, en cas de malheur, est de savoir qui aimerait se charger de ce petit ! Il est naturel que cela soit moi, n’est-ce pas ? Je m’offre avec tout mon cœur de mère et de grand-mère ! Veillez, Cher Monsieur, à ce que la situation pour Jean soit claire et nette, même avant la solution du divorce qui sera Dieu sait quand ! Aurai-je jamais encore la pauvre petite pension de 500 F. par mois, divisée en 3, que me faisait mon frère ? Ce n’est pourtant pas beaucoup pour chacun chaque mois ! Edward ferait un voyage de moins en avion pendant quelques jours ! Je vous en prie, Cher Monsieur, insistez pour cette somme minime qui ne durera peut-être plus longtemps et me rendrait tellement service. Partagez avec Madame Saurat et Melle Françoise, cher Monsieur, mes meilleurs souvenirs. Vicomtesse de Cangis. »
Comme dans la première lettre, elle utilisait abondamment les points d’exclamation et le soulignage. Cependant, ce qui attire le plus l’attention dans ce courrier, c’est l’intérêt balourd de cette vicomtesse (bien entendu, titre de complaisance) pour l’éventuel héritage de son petit-fils provenant hypothétiquement de Cécile. Elle semblait être persuadée que sa nièce allait passer incessamment l’arme à gauche. Or, l’avenir qui lui était bien évidemment caché en jugera autrement. En effet, la vicomtesse mourra à soixante-et-onze ans seulement deux à trois ans après cette lettre, alors que Cécile mourra à près de quatre-vingt-treize ans, cinquante-cinq ans après sa tante.
Mais cette lettre pouvait aussi donner raison à Aymar d’avoir soupçonné une quinzaine d’années auparavant sa sœur Jeanne de jeter un œil envieux sur la fameuse fortune de Cécile.
Précarité
Rapidement après le retour du petit Jean, devenu Jean de Genévrier, Eloy Taznal, sous l’influence de sa mère, se mit rapidement à distance de Cécile. Il s’installa dans un hôtel à quelques kilomètres du château d’Aymar. En totale contradiction, sa mère ne manquait aucune occasion de le monter contre sa femme et pourtant ne les avait-elle pas au début de leur mariage aidés à acheter des meubles pour leur intérieur du Livradois ? Malgré cela, dans sa propriété, Cécile se trouva sans moyen de faire face à ses nouvelles obligations maternelles. Sa belle-mère refusant toute aide, y compris – apparemment – à son propre fils, les factures de la vie quotidienne s’accumulaient : le boulanger, l’épicier, le boucher se manifestaient. L’abbé Dorgelet avait sollicité l’aide du châtelain qui s’avéra insuffisante. La reconnaissance de son enfant puis son retour auraient dû en toute logique, comme l’avait écrit Dorgelet, aboutir à la légitimation du petit Jean par Eloy Taznal. Evidemment, si les questions juridiques se posèrent rapidement, ce furent surtout des considérations d’ordre psychologique qui s’imposèrent.
Dès lors, le but très louable, visé par l’abbé était la scolarisation du petit Jean. Le grand-père, incriminé par les nombreuses lettres de Dorgelet et l’intervention du doyen, avait bien sûr payé les frais de retrait de l’Assistance publique, mais aussi le trousseau indispensable au pensionnaire d’un établissement scolaire. Pour cela, il vendit naturellement des bois du Livradois appartenant à sa fille. Mais ce fut surtout grâce à l’action personnelle du directeur de conscience de Cécile, qui n’hésita pas à rappeler au châtelain que « son maigre budget (de Cécile) ne pourra pas assurer encore longtemps tout ce qui est nécessaire. »
La scolarité du petit Jean, devenu Jean de Genévrier, n’était pas facile. Dans un premier temps, de 1929/30, époque de sa venue en Livradois, au divorce de sa mère et d’Eloy Taznal en 1936, son identité fut fluctuante. Qui était-il ? Jean aux trois prénoms, sans père et mère identifiables ? Jean de Genévrier, avec une mère mais pas de père ? Jean Taznal ? Encore aurait-il fallu qu’Eloy l’eût légitimé. Et ça ne fut pas le cas.
La famille se disloque
Malgré l’apparente et surtout prétendue fortune de Cécile et des Taznal, les difficultés financières ne cessèrent pas. Pour faire face aux turpitudes de son mari, en 1932 Cécile vendit une rivière de quatre-vingt-trois diamants, puis en 1934, deux domaines attenants de la propriété livradoise.
Elle eut un accident – sa voiture ayant été projetée sur un bloc de maçonnerie dans le fossé – dû semble-t-il au mauvais état du chemin d’accès à la propriété. Elle demanda alors de l’argent à Saurat en termes sévères :
« Ce n’est pas parce que tant que j’étais mineure j’étais forcée de me taire et tout accepter qu’aujourd’hui je dois suivre la même méthode et ainsi permettre à des gens qui n’ont pas le sou de se f…. ainsi de moi. Si on veut me payer toutes les réparations que cette aventure occasionne à ma voiture, je n’ai rien à dire. J’espère que vous userais (Sic) de l’autorité que vous avez afin de mettre fin à cet abus… C. Taznal. »
Étrangement, l’écriture de Cécile muait depuis son mariage. Sa vie conjugale disloquée, la venue de son fils auprès d’elle expliquaient-elle une psychologie perturbée se traduisant par de fréquentes et inhabituelles fautes d’orthographe, des tournures étranges et une écriture passablement arrondie, comme le montre sa correspondance au cours de la période postérieure à sa séparation et son divorce ?
La mort du chÂtelain : la dÉbâcle
En fait, Eloy, principalement sous l’influence de sa mère, s’éloigna de sa femme et du petit Jean. Cécile, aidée de Dorgelet, engageait son mari à légitimer le petit Jean qu’elle venait de reconnaître. Le petit Jean avait bien reçu un nom, mais qui n’était pas celui d’Eloy, le mari de Cécile. A l’évidence, cela faisait du bruit dans le Landerneau auvergnat. Et la bâtardise était manifeste. Les heurts se répétèrent à un rythme inquiétant dans le couple. La séparation de fait devenue effective, Cécile visa alors la séparation de droit et le divorce, écrivant une lettre le 18 octobre 1933 à Saurat, qui révèle sa triste condition et le pénible état se ses relations avec son mari :
« Cher Monsieur, Ne trouvez-vous pas que les affaires trainent en longueur, et je vois approcher l’hiver avec craintes, car je me demande où je trouverais l’argent pour vivre ? Avez-vous pu envisager officiellement la séparation de corps et de biens ? Vous le savez comme moi, j’ai hâte de sortir de ce despotisme continuel, car je crains toujours le voir venir ici et me manger le peu qui me reste. Je voudrais tant que vous arriviez à ce que ma situation soit nette et libre, cette vie cloîtrée me pèse de plus en plus. Est-ce qu’avec le divorce je pourrais obtenir la pension alimentaire pour moi et Jean. N’en parlez pas à ma famille ni à M. l’abbé, mais si le divorce pouvait me sortir de cette situation terrible, intenable, je le ferais (il y a toujours des arrangements possibles avec le ciel.) Le boulanger a envoyé sa note à F., lui disant qu’il ne pouvait plus attendre le règlement de sa facture. D’autre part, je sais que M. l’abbé est impatient de toucher sa créance et vis-à-vis de lui, je suis très gênée car il semble parfois m’en faire grief (ceci entre nous). Je vous remercie encore beaucoup de tout ce que vous faites pour moi et j’espère que vous ferez tout votre possible pour me sortir de ce marasme et me rendre enfin ma liberté que j’ai si durement enchainée et si involontairement. Mon meilleur souvenir à Mme Saurat et à Françoise. Croyez, cher Monsieur, à ma vive reconnaissance. C. de Genévrier-Taznal. »
Alors que, pendant des années, elle avait eu des échanges difficiles avec Saurat, Cécile sembla alors le prendre comme confident, sinon comme ami ! Elle se confiait et ainsi révélait dans cette lettre ce qu’elle était réellement :
« Il y a toujours des arrangements possibles avec le ciel ! »
Cela la résumait-elle en quelques mots ? En tout cas, les dieux ne lui furent pas favorables. Etait-ce là l’expression de la fonction tangible que les Genévrier attribuaient à la religion ? En fait, une pratique formelle, ritualisée, une assurance contre les risques de l’au-delà ? Cette indigence religieuse était effective lors des événements ponctuant la vie des Genévrier et alliés : naissances, mariages, enterrements. On était bien loin de l’esprit chevaleresque dont ils s’imaginaient être les héritiers.
La disparition d’Aymar de Genévrier, en janvier 1934, précipita la déroute du couple. Quelques mois après la mort du châtelain, Eloy lui-même demanda la séparation et une ordonnance de non-conciliation fut prononcée en juillet 34. Le petit Jean avait treize ans, vivant avec Cécile dans la propriété du Livradois. Bien sûr, pour attirer les grâces du ciel, on veilla à son éducation en lui faisant faire sa communion solennelle en 1933. De même, il avait été baptisé deux fois : à sa naissance à Toulouse et à huit ans lors de son arrivée en Livradois ; deux précautions ne valent-elles pas mieux qu’une pour s’assurer l’entrée au Paradis ?
Les rapports d’Aymar avaient été des plus difficiles avec sa fille, son gendre et même l’abbé Dorgelet. Ce dernier ne s’était pas gêné pour lui rappeler la réalité dans de nombreuses lettres et ses devoirs paternels, chiffres en main :
Le 26 novembre 1932 : « Monsieur de Genévrier, Mes occupations et la nécessité de réfléchir à ce que vous m’aviez écrit ne m’ont pas permis de répondre plus tôt à votre lettre du 16 courant et je vous prie de m’en excuser. Vous jugez actuellement qu’il est urgent d’intervenir pour protéger les intérêts de votre fille… et les miens, puisque à défaut de sa famille, c’est moi qui par pitié et par humanité l’aide, ainsi que son fils, à vivre pour ainsi dire au jour le jour. Vous savez cependant depuis longtemps ce qu’il en est, puisque l’an dernier je vous avais écrit longuement pour vous signaler la situation lamentable dans laquelle se trouvait votre fille sans que, du reste, je n’ai jamais eu l’avantage d’avoir de votre part une réponse. De vive voix cet été je vous ai expliqué ce qu’attendait votre fille pour vous libérer du plus criant de vos devoirs. Vous m’avez invoqué vos charges, comme si votre enfant ne devait pas passer raisonnablement avant beaucoup d’autres obligations. En tous cas, vous estimez aujourd’hui qu’il est urgent d’agir contre Eloy pour sauvegarder les intérêts de votre fille. Tout d’abord, je ne conteste pas la plus ou moins grande part de vérité dans tout ce qu’on rapporte à son sujet et il est certain d’autre part, qu’étant donné le régime de la communauté sous lequel ils sont mariés, les créanciers d’Eloy pourront un jour se rabattre sur le bien de votre fille. Je me hâte de vous dire qu’il y a beau temps que nous avons très sérieusement envisagé cette mesure de la séparation de biens que vous préconisez et que si elle a été abandonnée jusqu’ici, c’est que nous nous sommes rendus compte qu’il y avait là gros jeu à jouer et qu’en définitive, la liquidation ne serait peut-être pas à l’avantage de votre fille. Il ne faut pas oublier : 1°) que vous n’avez jamais donné de dot effective à votre fille. En effet son contrat de mariage portait bien une dot de 1 million mais cette somme comprenait 500 000 francs provenant de la vente des bois, alors qu’elle n’en a touché que 80 000 francs et 500 000 francs représentant la valeur du château et de son contenu, ce qui constitue une valeur de pure fantaisie. Il faut mettre complètement à part les titres qu’elle a reçus au moment de son mariage puisqu’ils lui venaient uniquement de sa grand-mère. Dans ces conditions si une séparation de bien a comme principal but de faire rendre à la femme sa dot comment, en l’occurrence, voulez-vous parler de la restitution d’une dot qui n’a jamais existé ? 2°) qu’au contraire, en lui remettant la propriété du Livradois qui était sa part de sa mère, vous avez obligé votre gendre à un débours de plus de 300 000 francs comme part revenant à votre fille Claire sur cette propriété. 3°) qu’en conséquence, vous avez contraint M. et Mme Taznal a des emprunts qui sont la principale source et l’origine des difficultés que présente la situation actuelle. 4°) que cette malheureuse affaire de la vente de la forêt, faite par vos soins, dans de si déplorables conditions, a nécessité de la part d’Eloy des avances considérables de fonds dont il est en droit de réclamer le remboursement dans le cas d’une séparation de biens. Mme Taznal-mère a dû payer de grosses sommes pour les frais de ce procès qui n’est pas fini et même a dû verser au fisc la bagatelle de 42 000 francs pour défaut d’enregistrement de l’acte de vente que vous aviez passée. 5°) que si une séparation de biens était prononcée, ce serait votre fille qui aurait à payer annuellement a) plus de 8 000 francs d’impôts sur sa propriété ; b) environ 30 000 francs d’intérêts pour le service des emprunts précités, sommes que jusqu’ici a payées sa belle-mère, sans oublier enfin l’imprévu formidable auquel peut donner lieu la liquidation définitive du procès des bois. Vous pouvez entrevoir que tout serait loin d’être en faveur de votre fille. Aussi – et c’est à cela que je veux en arriver après cet exposé – pour qu’un homme d’affaires puisse donner un conseil utile, dans cette question de séparation de biens, il faudrait qu’il soit en possession de tous les éléments du problème, qu’on puisse faire établir à l’avance les différents postes qui seraient à l’actif ou au passif de votre fille et qu’en conséquence il ne suffit pas de se présenter de but en blanc devant le meilleur avocat qui soit, si on n’est pas à même de lui donner des précisions et de lui exposer la situation par le détail. Oui, la situation est des plus embrouillées mais, entre nous, vous devez avoir le courage de reconnaître que vous en êtes en partie responsable. Je n’hésite pas à vous dire ce que je pense puisque vous voulez bien avoir confiance en moi et que vous reconnaissiez ce que j’ai pu faire pour votre fille […] Mais assurer sa subsistance quotidienne et celle de Jean, c’est votre obligation présente et vous devez faire aujourd’hui pour elle ce que vous n’avez pas fait jusqu’ici. Je vous l’ai déjà dit, ce rôle d’aide et de soutien, ce ne devrait pas être le mien, mais le vôtre, et cela tout le monde le crie autant et plus peut-être qu’on ne critique la conduite d’Eloy. Quant à cette question même de procédure que vous envisagez, Maître Villerette est en possession de tous les documents qui devraient entrer en ligne de compte et il pourrait être utilement consulté. En tout cas, ce n’est pas vous seul qui pourriez exposer l’affaire à Maître Monicat. Celui-ci pourrait tout au plus être vu par vous, à titre consultatif, sur l’utilité et l’opportunité qu’il y aurait à engager une procédure, étant donné les circonstances que je vous ai exposées plus haut. A ce sujet, je dois vous dire aussi que les frais qu’entraînerait une telle procédure ne pourraient être supportés par votre fille à qui il ne reste plus rien que ses yeux pour pleurer. Je vous ai dit très franchement toutes ces choses, car j’estime qu’il n’y a pas d’intérêt à se cacher à soi-même la vérité, ni à la cacher aux autres. Il ne faudrait pas, en effet que vous songiez à engager cette affaire – à laquelle en principe je donne mon adhésion – pour détourner de vous les obligations paternelles que l’honneur de votre nom vous impose vis-à-vis de votre fille. Car il faut bien vous dire aussi que même si une séparation de biens amenait une liquidation favorable aux intérêts de Mme Taznal, jamais elle ne toucherait un sou de son mari vivant, étant donné la situation financière de celui-ci. Or la propriété du Livradois ne rapporte pas de quoi payer les impôts dont elle est grevée. En outre, les rétributions fournies par les paying-guests peuvent faire vivre la maison pendant deux mois mais n’ont pas permis au moins pour cette année de mettre de l’argent de côté. Je viens d’exposer du mieux que j’ai pu la situation telle qu’elle se présente dans les circonstances actuelles. Excusez la franchise avec laquelle je l’ai fait, voyez vous-même maintenant ce qui peut être tenté et dites-mois si je puis vous aider en quelque façon. Vous voudrez bien présenter mes respectueux hommages à Mme de Genévrier et à Mme de Cangis et croire plus que jamais à mes sentiments dévoués. Dorgelet. »
19 décembre 1932 : « Monsieur, A la suite de notre entrevue de jeudi dernier, j’ai fait connaître à Mme Taznal la conclusion à laquelle nous avions abouti au sujet d’une pension alimentaire. Je viens de recevoir sa réponse et je m’empresse de vous la communiquer. Elle est tout-à-fait de votre avis de ne pas chercher par le moyen du tribunal à obtenir un résultat dans ce sens et elle-même préférerait de beaucoup si intervenait une solution à l’amiable pour une pension versée annuellement ou par versements échelonnés au besoin à Mme Taznal une somme de…. Selon la formule que vous m’aviez indiquée. Reste à débattre le montant de cette somme étant donné le nombre de domaines dont M. Taznal a la jouissance, quel est à votre avis le minimum qu’il faudrait chercher à obtenir ? L’autre jour, nous ne l’avions pas déterminé. De son côté, Mme Taznal ne me fixe pas et laisse ce point à votre appréciation. A mon avis, comme Mme Taznal a la charge de la demeure conjugale – et elle est lourde malgré toutes les réductions de dépenses déjà opérées – je crois qu’une somme annuelle de 10 000 francs ne serait pas exagérée ! Je ne me dissimule pas que M. Taznal ne se laissera pas faire sans crier – qu’il faudra toute l’habileté de Maître Delcroux pour obtenir quelque chose – et surtout je crois que rien ne devra être tenté chez Mme Echégut, vous comprenez pourquoi. D’autre part, Mme Taznal demanderait à Maître Delcroux, après avoir obtenu satisfaction sur e premier point, de vouloir bien également chercher à obtenir de M. Taznal qu’il légitime le jeune Jean. Cet enfant pour lequel il a eu de l’affection et en a peut-être encore, lui écrit assez souvent et s’étonne de ne jamais recevoir de réponse. Comme sur ce point très délicat, M. Taznal, redoute, dit-il, les colères de sa mère, il y aurait peut-être lieu de lui faire remarquer que la chose peut s’arranger sans que sa mère n’en sache rien et que l’affaire ne soit rendue publique. En tout cas, je crois que le mieux serait aussi, s’il se laisse toucher, de lui faire signer de suite la pièce qui l’engagerait. Au sujet de cet enfant, Mme Taznal me faire savoir qu’elle possède en effet un dossier concernant la reprise de l’enfant et les versements effectués à l’Assistance, etc. Dorgelet »
1er mars 1933 : « Monsieur de Genévrier, Je vous accuse réception de votre lettre du 15 février, en m’excusant de n’avoir pas pu le faire plus tôt. En vous signalant la situation de Mme Taznal et en vous demandant votre aide, je n’ai jamais eu la prétention de vous demander des explications sur vos revenus et vos dépenses, ce qui ne me regarde pas. Je m’adressais à cotre amour paternel ou plus simplement à votre humanité et la façon dont vous me répondez, me prouve que je me suis sans doute mal expliqué. Tout d’abord, j’ai pu, par moi-même, obtenir un délai de deux mois pour le paiement de la somme en question, qui dès lors ne devient exigible que fin avril. J’avais pensé ce que je pense encore que vous pourriez au moins avancer cette somme, en déduction de ce qui doit revenir à Mme Taznal sur la part de sa mère, comme vous l’aviez fait déjà une première fois, lors de la reprise de Jean. Je dois vous dire du reste qu’en même temps qu’à vous, je m’étais adressé à Mme Taznal-mère qui a répondu à sa belle-fille qu’actuellement, malgré la réduction à l’extrême de son train de vie, et son désir de la sauver de ce désastre, elle ne peut rien, se demandant elle-même comment faire pour payer à l’échéance du 1er mars une somme de près de 30 000 francs, représentant notes, impôts, intérêts d’emprunt concernant son fils Eloy. Pour sauver les apparences ( ?), vous me parlez pour votre fille d’une séparation amiable ( ?), vous demandez aussi pourquoi elle ne cherche pas à faire valoir ses droits légalement… Vous savez bien cependant que sur votre conseil je suis allé moi-même consulter Maître Saurat qui m’a répondu comme je vous en ai avisé, qu’il n’était nullement certain qu’en fin de compte, la séparation soit profitable à Mme Taznal et qu’il n’était pas d’avis de la demander et qu’il était préférable de chercher à obtenir une pension alimentaire. Votre fille essaye donc bien par les moyens qu’on lui indique de sortir de cette impasse et c’est parce que j’avais espéré que vous pourriez quelque chose pour elle, dans le sens que je vous ai indiqué plus haut, que je me permets d’insister encore près de vous. En rentrant de vacances hier soir, j’ai trouvé une lettre de Maître Saurat qui me dit avoir eu par vous communication des lettres que je vous avais adressées et avoir pris des renseignements chez le notaire. Il en résulte que pour cette obligation, le mari reste débiteur principal, mais il n’en est pas moins vrai qu’à son défaut l’hypothèque légale porte sur les biens de la femme. La question reste donc entière et comme Maître Delcroux exerce encore en ce moment diverses poursuites en paiement contre Eloy, il ne faut pas s’attendre à pouvoir recouvrer sur lui le montant de ladite obligation. C’est pourquoi je reste d’avis d’y aviser dans le sens que je vous ai indiqué plus haut, en profitant du délai de deux mois qui nous est accordé. Maître Saurat me fait également savoir que deux rendez-vous avec Eloy n’ayant pas été tenus, pour la question de la pension alimentaire, Maître Delcroux se demande s’il pourra aboutir. Voilà tous les renseignements que j’ai en ce moment et ils ne nous fournissent pas l’indication d’une solution quelconque. Veuillez croire, M. de Genévrier, à mes sentiments respectueux et dévoués. Dorgelet. »
Et l’abbé s’était également adressé à l’homme d’affaires du châtelain, sans doute par précautions :
Le 6 mars 1933 : « M. Saurat, Je reçois ce jour une lettre de M. de Genévrier dont il me dit vous avoir envoyé la copie. Vous y avez vu qu’il consent pour le remboursement de l’obligation de 12 000 francs dont je vous ai déjà entretenu, à avancer cette somme, sur la somme dont il a l’usufruit et qui lui vient de la mère de Mme Taznal. Une première fois, il y a près de 4 ans, il avait consenti une avance du même genre, lorsque Mme Taznal avait repris son fils, je crois que cette première avance avait été de 9 ou 12 000 francs également. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c’est qu’il prétende qu’après la présente opération effectuée, il ne restera plus grand-chose à revenir à sa fille, alors que la somme dont il a l’usufruit est de 103 ou 105 000 francs me semble-t-il. J’ai très peur alors que cette dernière somme dont il est responsable, ait fondu en mauvais placements et qu’il se croira libéré lorsqu’il aura cédé les quelques titres à quoi elle se réduit. Je vous dis tout cela afin que toutes précautions soient prises dans le libellé du reçu qu’auront à fournir M. et Mme Taznal, en recevant de M. de Genévrier cette somme de 12 000 francs, c’est une avance qui leur est faite sur la somme dont M. de Genévrier a l’usufruit. Mais ce n’est pas la cession à eux faite des titres qui ne représenteraient que d’une façon très réduite ce qui doit rester du capital primitif. En outre, puisque Mme Taznal doit avoir l’assentiment de son mari pour toucher cette somme, il faudrait que vous ou Maître Delcroux vous vous chargiez – ce serait peut-être l’occasion, en faisant remarquer à M. Taznal que sa femme paie aussi cette dette contractée par lui – de lui demander en compensation de fournir à sa femme la pension alimentaire dont nous avions parlé. M. de Genévrier parle aussi dans sa lettre d’une séparation amiable qui pourrait être convenue mutuellement entre les deux parties et don vous, ou Maître Delcroux, pourriez préparer les pièces avant d’en référer à Mme Taznal. Je voudrais bien savoir ce que M. de Genévrier entend par là et quels seraient les effets et les conséquences de cette mesure. Dans l’espoir de votre réponse, je vous prie de croire, M. Saurat, à mes meilleurs sentiments. Dorgelet. »
de la sÉparation au divorce
Saurat prit encore plus d’importance dans le règlement du conflit familial d’Eloy et de Cécile. Pour bien comprendre les enjeux familiaux des Genévrier, il faut dire que ce personnage, supervisant les finances de Cécile, avait une étude d’avoué dans un bourg dont il avait été le maire, situé à une quinzaine de kilomètres au Sud-Est du château. Il était aussi l’homme d’affaires d’Aymar de Genévrier depuis de nombreuses années. Il avait lui-même une fille, Françoise, d’une quinzaine de mois plus jeune que Cécile. D’ailleurs, adolescentes, elles copinaient, fréquentant le même établissement scolaire de la capitale auvergnate.
Le divorce ne tarda pas. En juillet 36, le mariage d’Eloy Taznal et de Cécile de Genévrier fut dissous aux torts respectifs, par jugement du Tribunal de première instance d’une sous-préfecture auvergnate. Cécile dut faire face aux dépenses entraînées par la procédure en vendant les domaines et le cheptel dont elle avait hérité deux ans auparavant, à la mort de son père. Et pour vivre tout simplement dignement et payer le personnel à son service, elle ne cessa pas de vendre des coupes de bois d’année en année.
De plus, avait-elle dit à son fils, des années plus tard, pour respecter les usages, après son divorce elle avait rendu l’argenterie à la famille Taznal (les circonstances sont évoquées dans la lettre de Jean de Genévrier figurant au début de ce récit). Saurat dut intervenir pour obliger Eloy Taznal à respecter ses engagements envers Cécile de Genévrier.
L’abbé Dorgelet négocia avec Eloy et sa mère pour qu’une pension alimentaire fût versée à Cécile, mais le mari se montra récalcitrant et il fallut que l’ecclésiastique en passât par l’avoué Saurat qui préféra suggérer un accord à l’amiable plutôt qu’un procès long et coûteux. Même le montant de cette pension fut problématique. Eloy Taznal, tel qu’en lui-même, avait accepté du bout des lèvres de s’acquitter de ses obligations envers son ex-femme ; surtout parce que sa mère l’y autorisait ! Mais comment se comporterait-on dans une situation similaire ?
Cet homme d’affaires, Saurat, connaissait parfaitement les problèmes familiaux du châtelain et ne se privait pas d’en parler à sa femme Victorine et à sa fille Françoise : l’obscure naissance de Jean, son abandon, sa venue problématique dans la famille maternelle, tout cela était abondamment commenté dans le foyer de l’avoué.
Ainsi plaqua-t-on sur le petit Jean une identité nouvelle, le faisant passer à l’état-civil de l’anonymat de trois prénoms à trois prénoms plus un patronyme, celui de sa mère et donc du châtelain. Une promotion sociale en quelque sorte. Mais sa mère n’avait-elle pas été mariée avec Eloy Taznal depuis novembre 1920 ? Et l’enfant n’avait-il pas vu le jour cinq mois après le mariage ? Comment sa mère pouvait-elle laisser cet enfant sous son nom de jeune-fille sans que la bâtardise ne continuât d’éclater au grand jour ? Cette bâtardise du petit Jean, devenu Jean de Genévrier le 14 août 1929, par les délibérations d’un tribunal en Livradois, pesa lourd sur son identité et Cécile, sa mère, naïvement peut-être, crut bon de lui faire porter illégitimement le patronyme de Taznal, allant jusqu’à l’écrire sur la page de garde de son livre de messe, même après le divorce, ce qui amena Eloy, en juin 38, deux ans après le divorce, à faire signifier et déclarer à Cécile :
« Qu’il s’est marié avec elle à la mairie de Genévrier le 15 novembre 1920, qu’il n’a presque jamais habité avec sa femme qui semble ne l’avoir épousé que sous la pression de son père alors qu’elle s’était fiancée à un autre dont elle devait être enceinte au moment du mariage. Que par jugement du tribunal de Première Instance, en date du 25 juillet 1935, le divorce a été prononcé entre eux à leurs torts respectifs. Que le requérant vient d’apprendre que Madame de Genévrier, susnommée, à la date du 14 août 1929, devant Monsieur le maire de la commune, a déclaré reconnaître pour son fils un enfant du sexe masculin, né à Toulouse, le 24 mars 1921 et inscrit sous les noms de trois prénoms. Qu’en tenant pour exacte cette déclaration, l’enfant qui en est l’objet serait né moins de 180 jours après le mariage du requérant avec Madame de Genévrier. Que dans tous les cas, le requérant n’est pas le père de cet enfant. Que l’acte de naissance et la reconnaissance du 14 août 1929, s’ils concernent un enfant dont Madame de Genévrier serait la mère, n’indiquent point quel est le père et qu’ils ont eu lieu faussement et frauduleusement. Que le requérant, en faisant toutes réserves et protestations contre ces actes, désavoue formellement l’enfant reconnu à son insu par Madame de Genévrier le 14 août 1929 et qu’il entend poursuivre la procédure de désaveu, conformément aux articles 314 et suivants du Code Civil et contester la légitimité de l’enfant. »
A l’évidence, Eloy usait d’artifices. Du louable projet de faire sortir le petit Jean de l’anonymat, intention soutenue par le clergé, on passa au pire des scénarios. On peut noter qu’il fut à nouveau considéré comme un objet dont personne ne voulait véritablement assumer l’identité. Cécile vécut difficilement cette situation qui donnait d’elle un portrait bien dégradé, une espèce de perte de l’estime de soi allant mal avec les prétentions nobiliaires familiales. Son affection maternelle était vague, sans expérience à l’évidence. Elle n’avait pas conscience de priver son fils des quelques nouveaux repères qu’il s’était édifiés depuis son arrivée en Livradois.
Dorgelet aida activement Cécile à faire admettre son fils dans divers établissements scolaires privés et Jean fut ainsi ballotté comme interne d’Auvergne (dans quatre villes) en Savoie, ne revenant que très épisodiquement pour les vacances auprès de sa mère. Les vexations ne lui furent pas épargnées de la part de ses camarades d’école mais aussi de ses maîtres et professeurs, religieux pour la plupart, lui rappelant cruellement sa condition de bâtard.
Sa formation scolaire se limita aux cycles primaire et secondaire, jusqu’en seconde. Sa mère se disait désespérée. Alors qu’elle était allée lui rendre visite en Savoie pendant les vacances scolaires, Cécile porta un jugement sévère sur ce fils de près de dix-sept ans en écrivant à Saurat le 9 janvier 1938 :
« Je vous remercie de vos bons vœux que je voudrais bien voir réaliser, mais hélas tout laisse prévoir que l’avenir me réserve encore de plus grand calvaire à gravir que ceux par où je suis déjà passée. Je suis rentrée de Savoie où j’étais allée pour faire passer les vacances de Jean avant-hier et en revenant de la gare à quelques kilomètres d’ici, par suite d’un court-circuit, j’ai eu le feu à ma voiture que j’ai pu maîtriser grâce à mon extincteur et en arrachant la garniture où le feu courait vers le réservoir. Hélas, je ne suis pas assurée contre le feu, payant déjà gros d’assurance pour les accidents, donc me voilà sans voiture pour quelques jours et surtout une belle note de réparation. De plus je suis allée en Savoie où ce malheureux Jean a été pour moi un vrai désespoir. Il travaille horriblement mal, sa plus forte note est 7 sur 20 et il est 26ème sur 28 élèves. Très mauvaise expression, gâchant ses effets, malgré ma défense express à lui et à l’économe, se fait avancer de l’argent. Il dit qu’il veut mener la grande vie, veut être le maître ici, et tout commander. Comme morale, aucune. Il cite comme exemple Edward qui mène la grande vie et dit qu’il veut en faire autant… Bref, il est la nuit et le jour de ce qu’il était cet été. Alors je l’ai menacé que j’allais écrire afin qu’on le visse. Je me demande ce qu’il va devenir. Il se moque absolument de tout. Sur le moment, il promet tout, fait de belles phrases et 24 heures après tout est à recommencer. Le supérieur et les professeurs m’ont dit et écrit qu’il pourrait être très bon élève, mais quand il le voudrait, du reste lui-même avoue qu’il ne veut pas travailler, qu’il est très riche… Au sujet que le désaveu de paternité qui peut s’obtenir, ne pourrions-nous faire payer à Taznal les frais que cet enfant occasionne ? Le prix de pension est maintenant de 1760 francs par trimestre et il n’est qu’en seconde, il a au moins encore deux ans à faire. Il a l’air de vouloir faire sa carrière dans l’armée, mais il faut un bagage et de plus s’il l’obtient avec son caractère de révolte. Je le sais, mais dans un régiment disciplinaire alors !... Je m’excuse de vous dire mes peines, mais vous êtes le seul ami sincère à qui je peux dire mes peines, pourtant je n’ai rien à me reprocher de la manière d’élever cet enfant. Je l’ai pris par tous les sentiments, rien n’y fait et je sens que plus ça va, plus il me déteste. Du reste il espère, que dès que je n’y serais (Sic) , pouvoir dilapider tout ce qu’avec tant de peine j’aurai sauvé du naufrage. Il regrette beaucoup Taznal parce que ce dernier lui donnait parait-il de l’argent. C’est Jean qui le dis (Sic) . Oh si vous aviez été son subrogé tuteur, avec votre autorité vous auriez pu peut-être le mettre à la raison, mais avec des nouilles comme Edward et Auguste, c’est à désespérer… »
Que pourrait-on dire de l’appréciation d’une mère, impliquée tardivement dans l’éducation de son fils, le considérant comme un Jean-Foutre ? En tout cas, cette lettre démontrait que derrière Jean de Genévrier, le petit Jean était toujours là, en filigrane. En fait, déplacé à huit ans de sa famille d’accueil, aimante, dans une austère demeure du Livradois, il avait nécessairement généré des défenses légitimes. S’il avait voulu préserver ce qui lui restait de sa prime enfance, n’était-il pas juste qu’il affirmât, à sa manière, sa personnalité écorchée ? Au moment où sa mère avait écrit cette lettre à Saurat, il avait dix-sept ans. Depuis son arrivée en Livradois, il avait donc passé huit ans à chercher de nouveaux repères. Son grand-père, Aymar ne lui aurait-il pas dit, comme à son propre fils Edward : « Tu es un Genévrier, tu as un nom et ta famille a un passé. » C’est ainsi que l’ex-petit Jean né de père et de mère non dénommés, se prit pour le seigneur du lieu, narguant sa mère et les adultes de son entourage. Cette nouvelle condition, faisant en quelques semaines seulement effraction dans son univers d’enfant, n’avait-elle pas, en même temps, introduit le germe de troubles mentaux qui perdureront jusqu’à sa mort ?
Alors qu’à la lecture de la pitoyable lettre de Cécile de Genévrier à Saurat on pouvait déduire que son fils était un véritable cancre, on peut cependant aujourd’hui, au vu de ses écrits ultérieurs, dire que l’ex-petit Jean ne présentait pas l’illettrisme que des années après ses rejetons montreront. Paradoxalement, il avait des connaissances en grec ancien. Fût-ce l’influence de l’abbé Dorgelet ?
En tout état de cause, Cécile de Genévrier avait espéré récupérer un fils modèle en le reconnaissant à l’âge de huit ans, comme si, ce faisant, elle avait mis au monde magiquement un nouvel être ! De fait, elle avait découvert un enfant plein de défauts :
« Il promet tout, et fait de belles phrases, écrivait-elle, et vingt-quatre heures après, il a tout oublié. De plus, il avoue à ses professeurs qu’il ne veut pas travailler parce qu’il est très riche »
En janvier 1938, elle se plaignait qu’elle avait peut-être à gravir un calvaire encore plus grand et que son fils avait encore deux ans à faire, sous-entendu pour aller jusqu’au baccalauréat et – cela ressemblait bien à Cécile – elle voulait faire payer à Eloy Taznal les frais de scolarité de Jean alors qu’ils étaient divorcés depuis deux ans. On a beau laver la caque, elle sent toujours le hareng !!!
Pouvait-on dire, sans ironie, que cet enfant croissait en sagesse, en stature, et en grâce ?
Son fils atteignit dix-sept ans, cet âge crucial auquel parfois on bascule dans le pire. Et ce ne fut pas simple pour Jean, arraché à sa prime-enfance, vécue – semble-t-il – dans une famille d’accueil chaleureuse. Mais avait-il déjà les troubles qui se manifesteront ultérieurement : cruauté envers les animaux, propension au mensonge, à la mythomanie, tendance à la violence systématique lors de contrariétés et plus tardivement disposition à la séduction des femmes jeunes et moins jeunes, déviances sexuelles ? En fait, peut-être avait-il déjà le goût de la transgression, traits qui se développeront en s’accentuant jusqu’à la fin de sa vie. Freud, Cyrulnik au secours !
Il avait déjà eu un triste parcours, quittant Toulouse pour l’Auvergne en 1929 et sortant ainsi de sa prime enfance en même temps que de l’anonymat, après huit ans de mise entre parenthèses par le seul désir de sa famille biologique. Après l’abandon, pendant huit ans, a-t-il eu conscience d’avoir été rejeté ? Et huit ans après, a-t-il eu le sentiment d’être récupéré comme un objet en souffrance, comme une chose déposée au mont-de-piété ? Après tout cela, ne subit-il pas de fausses émotions jusqu’en 1938, quand il retourna à la bâtardise par le rejet légal et compréhensible du mari transitoire de sa mère ? A n’en pas douter, Jean, enfant puis adolescent, en avait bien conscience, même confusément. A l’adolescence, alors qu’il subissait en pension les moqueries de ses camarades, ne se demandait-il pas si sa venue en Auvergne par la volonté de sa mère, n’avait pas été un pis-aller ? En effet, ne serait-il pas resté à Toulouse – oublié comme un mauvais souvenir – si Cécile et Eloy avaient eu un enfant, comme ils l’avaient envisagé pendant les premières années de leur mariage ? Ces sentiments aigus, ce désarroi du petit Jean, devenu tardivement Jean de Genévrier, n’avaient-ils pas constitué le terreau d’une personnalité déstructurée, se transmettant à sa progéniture, faisant des ravages alentours ? Ce qui pourrait être une illustration de la psychogénéalogie développée par Anne Ancelin Schützenberger. En effet, faut-il rappeler en quelques mots ce que cela suppose ? Selon cette approche, les événements, les traumatismes, les secrets et les conflits vécus par les ascendants d'un individu conditionnent ses faiblesses constitutionnelles, ses troubles psychologiques, ses maladies, voire ses comportements étranges ou inexplicables. Une lettre écrite à sa mère, des années plus tard, à vingt-six ans, le démontrera, rappelant en particulier les humiliations subies pendant sa scolarité. Certains n’avaient-ils pas mis en avant la consanguinité de Cécile de Genévrier et de Jacques de Cangis, cousins germains, pour expliquer les troubles de leur fils, le petit Jean, devenu Jean de Genévrier ? Qui aurait pu subir une telle situation sans dommage ?
De la lettre de Cécile, on pouvait alors retenir que Jean de Genévrier, au terme de sa scolarité, avait émis le désir de s’accomplir dans une carrière militaire. Il allait être servi ! On peut se demander si cet homme atteignit la résilience, comme l’explique si précisément Boris Cyrulnik.
Bon sang ne saurait mentir, bis repetita
Les Genévrier subissaient de déplaisantes situations, liées, semble-t-il, à un fâcheux et insistant déterminisme familial. Comme écrit plus avant, le neveu d’Aymar de Genévrier, Amélié, le fils de son frère Anatole avait épousé en premières noces, en 1918, sa cousine germaine, fille d’Aymar, dont il avait divorcé en 1920. Ce qui avait donné lieu à la vindicte d’Aymar qu’il manifestera à nouveau deux ans plus tard à l’encontre de sa seconde fille, Cécile, vivant une situation similaire. Ce neveu Amélié épousa à quarante-deux ans, en Dordogne, en 1934, Louise King, la fille d’un aubergiste. Rien d’infamant en soi. Le mariage d’Anatole de Genévrier en 1891 avec une Juive aurait pu être un précédent bien plus dommageable pour ces gens. Et pourtant, ce même Anatole écrivait de Nice, en juin 1938, que son fils devait quitter au plus vite cette femme qui avait un enfant dont il n’était sûrement pas le père. Nouvel imbroglio familial chez les Genévrier ! Une nouvelle bâtardise pesait ainsi sur le nom ! Cependant, cet enfant, né en octobre 1936 à Bergerac, portera le nom de Jean-Marie de Genévrier, se mariera en juillet 1958 à Clermont-Ferrand et aura deux enfants. Il mourra le 20 février 2013.
De l’enfance à l’âge adulte sans transition
La situation internationale de la fin des années 30 laissait pressentir le conflit qui allait embraser le monde.
Jean de Genévrier atteignit dix-huit ans en mars 39. Il semble qu’à cette époque il ait été amoureux d’une jeune Parisienne, mais sa mère s’arrangea pour que cette idylle avorte. Il avait donc atteint l’âge de s’engager dans l’armée, ce que sa mère favorisa estimant probablement que ce serait un moyen de mettre à distance l’objet de ses tourments. L’ex-petit Jean signera son engagement volontaire à Chambéry, en mai 39.
Pendant l’enfance, puis l’adolescence de Jean, Cécile n’avait-elle pas subi les pressions, les humiliations, la honte… alors le moment n’était-il pas venu où elle avait devant elle un jeune homme portant son nom, mais n’en restant pas moins le signe vivant de sa défaite tant sentimentale que familiale ? N’avait-elle pas aspiré à une paix qu’elle estimait méritée ? Son fils fut incorporé dans les Chasseurs-Alpins à Strasbourg grâce à l’intervention de deux officiers, amis de la famille. Ainsi, engagé, y sera-t-il caporal-chef dès novembre 39. Il fut rapidement fait prisonnier. Une lettre de Cécile à Saurat datée de septembre 39, révélait une certaine inquiétude :
« Cher Monsieur Saurat, L’horrible cataclysme que nous appréhendions tant tous est déchainé. Je pense que vous êtes toujours à Gardat où je vous écris. J’ai eu des nouvelles de Jean ce matin après 15 jours de silence, il n’a reçu aucune de mes lettres ni mes colis contenant les tricots et des vivres. Il doit incessamment aller au front. Quant à moi j’ai obtenu un sursis et ne prendrai mon travail d’infirmière (probablement à Clermont-Ferrand) le 1er octobre car d’ici là, il faut que je reste ici pour faire l’inventaire et après le départ des J… »
Selon les écrits de Jean de Genévrier lui-même, voici son propre itinéraire au cours de sa captivité :
Evasion le 6 mai 1942. Cependant, ne donnant aucun détail de sa capture initiale et de son emprisonnement préalable, on peut supposer, à la lecture de l’ensemble de son récit, que cela avait été à Hamburg, mais quand ? Suit une Cavale de courte durée puisqu’il avait été à nouveau arrêté le 18 mai 1942 près de Bremen et ramené à Hamburg où il avait été interrogé, écrivait-il, par la Gestapo. Du 18 mai au 15 août 1942, il avait été interné dans la baraque 90 du camp disciplinaire de Sandbartel (???) XB. Il avait alors été envoyé en usine à Neumünster le 18 août 1942 dont il s’était évadé le 2 février 1943. Il y serait ainsi resté près de six mois en attente d’un jugement pour sabotage. On peut se demander s’il n’avait pas pris une certaine liberté avec la réalité des faits de cette période. En effet, comment un prisonnier de guerre, saboteur de surcroît, aurait-il pu être jugé en Allemagne, sans être passible de la peine de mort ! Il avait noté sans précision qu’il s’était évadé encore de Neumünster, mais avait mentionné la date à laquelle il avait été repris : le 9 février 1943. Donc très brève cavale d’une semaine. Puis il avait été interné près de Düren au camp d’Arnoldsweiler jusqu’au 24 mai 1943 d’où il avait été transporté en train pendant des jours, du 24 au 31 mai 1943, jusqu’au Stalag 325 de Rawa Lemberg, en Pologne, camp de représailles où il était resté de mai 1943 au 5 avril 1944. Ensuite, long voyage de retour en Allemagne, par le train, du 6 au 15 avril 1944. Il y avait connu à nouveau différents camps : XI B Fallibastel (?), III A Luckenwalde, III B Fürstenberg. Il se serait évadé d’Hohentanen (?) le 21 juin 1944 et aurait été repris le 20 juillet 1944 et aurait connu de nouveau la prison du stalag III B jusqu’au 15 août 1944. Il avait mentionné que ses camarades d’évasion étaient déjà morts au moment où il écrivait ses notes. Il avait dit avoir été dénoncé pour sabotage par un mouchard hollandais (Bogaert) à l’usine de Neumünster et avait alors fait huit jours de cellule au secret, puis avait été remis au travail comme aide-maçon.
Ce récit syncopé, qui le montre comme un courageux réfractaire, est peut-être à prendre avec une certaine réserve, car comment ne pas s’étonner de la clémence des Allemands avec un saboteur ?
En cette période de guerre, la préoccupation première de Cécile était constante : l’argent, encore l’argent. Elle écrivait de nouveau à Saurat, en novembre 39 :
« Cher Monsieur Saurat, j’ai reçu votre lettre du 2 novembre qui ne m’a nullement surprise au sujet du silence d’Edward (son demi-frère). J’ai l’intention de lui faire écrire une lettre recommandée par Fleury pour le mettre en demeure de me payer la somme qu’il me doit […] Veuillez donc avoir la bonté de me dire si légalement je peux agir ainsi […] J’ai été aussi très inquiète de Jean. Je n’avais aucune nouvelle de lui depuis le 19, lorsqu’avant-hier, j’en ai eu. Il est en première ligne du côté de Strasbourg. Voici son adresse : Caporal-chef de Genévrier 21/3.I.C.A, secteur postal 108. Il serait heureux d’avoir un mot de vous […] Je compte sur vous pour me dire le moyen rapide d’obtenir ma créance, car j’ai hâte de rendre à Fleury ce que j’ai emprunté et aussi finir de payer mes impôts… »
Elle interpellait fréquemment l’ancien homme d’affaires de son père qu’elle avait probablement engagé au même titre, malgré les oppositions des années 30, puisqu’elle lui écrivit du Livradois, en août 41 :
« Cher Monsieur Saurat, Vraiment j’ai disparu de votre mémoire, depuis des semaines que j’attends toujours un mot. Si le temps le permet, j’irai à Genévrier en vélo la semaine prochaine régler avec Lavrault, je pousserai jusqu’à Gardat vous voir, si vous étiez absent, envoyez-moi un mot, je suis très inquiète de Jean dont je suis sans nouvelles depuis fin mai. Il avait l’idée de s’échapper. Il va s’en (Sic) dire que depuis qu’Edward est rentré à Genévrier, sa mère a cessé toutes relations épistolaires avec moi. Je m’y attendais, il n’a encore pas compris… »
Ainsi Cécile s’inquiétait-elle de son fils. On peut au passage remarquer son courage physique, car le périple qu’elle envisageait d’accomplir à vélo représente tout de même deux-cents kilomètres aller-retour !
Dans cette lettre à Saurat, apparaissaient les signes du conflit avec son demi-frère Edward. Toujours et encore obsédée par l’argent, elle voulait récupérer le produit de la vente d’un terrain d’aviation situé à proximité de Genévrier, propriété de son demi-frère depuis la mort de leur père Aymar en 1934. Cécile demandait à Saurat de faire opposition à Edward. Cet homme deviendra traducteur, et alors qu’il n’avait que 26 ans, il sera maire de Genévrier. Elle prétendait que l’argent qu’il avait perçu de cette vente était le sien, car Edward, étant Anglais, ne jouissait plus des privilèges français. Il s’était engagé volontaire dans l’armée britannique, étant donné qu’il avait été réformé dans l’armée française. Elle avait insisté :
« Il me faut absolument mon argent. C’est incompréhensible que je n’arrive pas à faire respecter un acte légalement fait… mon affectueux souvenir à ces dames » (Il s’agit de la femme de Saurat et de sa fille Françoise qui jouera – comme nous le verrons – un rôle capital dans la vie de Jean).
Intermède
Que s’était-il passé durant cette période de guerre et de captivité ? Qu’avait subi le petit Jean, alias Jean de Genévrier ? Il avait eu, entre autres, une liaison homosexuelle avec un camarade de captivité dont il restera proche. Il le revit plusieurs fois après son retour et jusqu’aux années 1990. Ce camarade fut un journaliste connu, ami proche d’un des hommes politiques, initiateurs du PACS.
Les échanges épistolaires de Jean de Genévrier, en particulier avec sa mère, se multiplièrent mais le plus souvent pour exprimer une persistante difficulté de communication, malgré les mots apparemment affectueux, mais plutôt trompeurs, comme cette lettre du 14 juin 1946, préfiguration de celle figurant en tête de ce récit :
« Bien chère maman, Après tous les coups de téléphone vous deviez me croire perdu, les Grand croyaient que j’avais eu un accident ou quelque chose comme cela et l’abbé cherchait après son vélo : je n’étais pas perdu mais avais dû partir précipitamment. Vous savez qu’avec moi la vie est pleine d’imprévus. Nous avons discuté avec Françoise (Saurat) qui a vu le père de Jacqueline qui lui a dit qu’il ne voulait pas, et cela se comprend, prendre d’engagement pour sa fille avant 1 an ou 1 ½ , que je n’avais pas de situation et que d’un autre côté elle était trop jeune pour savoir vraiment ce qu’elle voulait, qu’il ne voulait pas que plus tard elle regrette de s’être mariée si jeune. Il va la prendre cet été après sa convalescence pour la faire sortir dans le monde et qu’elle connaisse la vie. Nous avons ensuite causé de situation. J’ai parlé des expertises, en plus que cela n’est pas un métier bien stable on risque d’être entraîné dans des combinaisons plus ou moins douteuses et je ne dois pas salir le nom de Genévrier qui a bien baissé (Sic) depuis les dernières générations. En plus de cela, logeant chez ce monsieur en tête à tête avec sa fille, il ne faudrait pas que les gens causent trop et qu’ensuite je me vois presque contraint à épouser sa fille qui a l’air très bien mais pédante, qu’elle ait la douceur suffisante pour que je m’attache à elle. J’ai tellement besoin d’affection qu’il me faut une femme douce et énergique, intelligente et qui sache ce qu’est l’argent. Ce matin j’ai vu Rachon. Il a parlé à nouveau à Ellia de Sables pour moi. Ils sont d’accord pour me prendre dans leurs services à Paris. Une fois dans la place je m’arrangerai toujours pour revenir dans la région, car c’est une organisation qui prendra de l’importance et une fois à Paris au bout de quelques mois je m’arrangerai pour être nommé dans la contrée. Il faudrait pour cela que je monte à Paris dès que je pourrai. Je tâcherai de monter avec lui. C’est là une porte ouverte comme situation. Ensuite, je suis descendu chez Michelin, ai vu M. Merle, chef de l’embauche, Rigot, chef du personnel commercial et Chanudet. J’ai demandé une place comme représentant en France ou étranger. On me prendra dans la branche du commerce dès que je voudrai. J’aurai un examen à passer et autre examen physico-technique (Sic, il voulait probablement dire psychotechnique), mais que je réviserai je crois facilement avec les relations des uns et des autres dans la maison. J’ai demandé de rentrer de suite au début juillet, car ayant le pèlerinage je ne pourrai m’absenter ensuite. On m’a conseillé de prendre qu’après les vacances de l’usine ; celle-ci ferme complètement du 3 au 18 ou 19 août et M. Merle et Rigoulet ont 3 semaines de vacances. Ils m’ont dit d’y aller autour du 25 ou 26 août. Je passerai ces examens et commencera un stage pendant lequel je serai appointé naturellement et partirai ensuite soit France dans une région ou une autre ou à l’étranger. Si je rentre de suite, il faut 8 à 10 jours avant que les papiers soient en règle puis 8 jours pour l’examen et l’admission, ce qui porte au début juillet et c’est le pèlerinage. Je ne pourrai donc pas commencer un stage pendant 8 ou 15 jours pour arrêter pendant 15 jours ou 3 semaines de vacances. Donc, il est plus raisonnable d’attendre. Aussi j’ai deux admissions en vue plus celle que M. Imbert me propose. J’ai poussé un gros soupir de soulagement en apprenant cela. Vos prières ont été exaucées. Jacqueline aussi en est très contente. Elle va préparer sa licence d’histoire de suite après son bac qu’elle passe mardi 28. Tout s’arrange comme situation. Je pourrai envisager l’avenir plus sérieusement surtout que chez Michelin c’est stable. Si l’on travaille on peut se faire une belle situation et se monter, surtout si Jacqueline peut donner des cours d’histoire et moi travailler de mon côté vu que nous serons dans une grande ville, cela sera très intéressant. Je vais voir M. Gorce pour Cistel, mais s’il vient vous payer n’acceptez à aucun prix, ni par chèque ni rien, car il vous doit l’année 46 et pense que vous n’y pensez pas. Laissez-moi donc faire, je m’en occuperai et pour le faire aussi. Je reviens à ma situation […] Si je peux acheter plus tard un portefeuille à C. ou autre chose, nous verrons. En ce moment aussi si cela se présente car vous avez bien un peu besoin d’un grand garçon comme moi qui sait ce qu’il veut. Je termine, Maman chérie, en vous embrassant de tout cœur. Jean. P.S. : Savez-vous que Paul a un petit Indochinois et Montmaraultois. Mauvaise farce pour l’abbé et sa mère et pour se marier maintenant. C’est mieux que de l’avoir abandonné mais on peut faire attention. »
Ce courrier révèle une tentative de fiançailles avec une certaine Jacqueline qui, à l’évidence, n’avait aucune chance d’aboutir, pas plus d’ailleurs que d’autres essais. Ce sera bien plus tard qu’il établira une liaison adultérine avec cette Jacqueline, alors qu’ils étaient l’un et l’autre mariés. Encore une fois, Jean sortit le couteau, rappelant à sa mère qu’elle aurait pu ne pas l’abandonner comme ce Paul qui, lui, avait reconnu son enfant, apparemment métis indochinois. Mais n’anticipons pas.
Autre lettre de Jean de Genévrier à sa mère, datée de juillet 48 et envoyée d’un bourg de l’Allier, probablement de chez Saurat où il devait être le correspondant d’une compagnie d’Assurance parisienne :
« Bien chère maman, J’ai reçu ces derniers jours votre quittance pour l’assurance de la voiture, il y a beaucoup de retard, car vous auriez dû la recevoir en mai, mais les nouveaux tarifs ont beaucoup donné de travail dans les bureaux pour revaloriser les polices. Le prix total est de 7 206 francs ; le reçu de la poste vous servira de justification de votre envoi. J’espère que vous pourrez m’envoyer cette somme sans trop tarder afin que je mette mes comptes à jour avec la compagnie. J’ai vu Alice Maume et Mme Berthon en mai. Hélène n’était pas à Montmarault les 2 fois. Je l’ai aperçue quelques jours après, le 6 ou 7 mai. Je n’ai pu m’arrêter car j’étais en retard. Que devenez-vous dans ce somptueux décor ? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, dit-on, j’espère sans beaucoup de conviction que vous aurez meilleur temps que nous. On se croirait en automne, pluie, brouillard, froid. Quelle discordance avec l’été dernier. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, tant dans un domaine que dans l’autre. Pourquoi n’avez-vous pas songé à racheter Ozina. Cela m’a fait mal au cœur de voir petit à petit cette magnifique propriété démolie par des héritiers indignes. Vous auriez pu vendre quelques valeurs et des bois pour sauver une propriété de famille, on doit faire des sacrifices. On doit avoir comme sacré ce que vos pères vous ont laissé. On est indigne d’eux sans cela. Je termine espérant avoir de vos nouvelles et je vous embrasse. Jean. »
Jean de Genévrier, relativement tôt après son retour d’Allemagne, manifesta des troubles de la personnalité qui suscitèrent un comportement inapproprié, allant jusqu’à l’agression sexuelle, ce qui expliquait les remarques apparaissant çà et là dans ses échanges avec sa mère.
Une lettre adressée par Jean de Genévrier à Cécile, datée de Paris en mars 47, donc deux ans après avoir apparemment quitté l’armée et être rentré en France, éclairait assez bien leurs relations. Après les formules préliminaires et quelques considérations sans importances, il y allait de la séquence Culture pour tous en montrant un certain intérêt pour la représentation d’Hamlet avec Jean-Louis Barrault et Pierre Renoir au théâtre Marigny. Il précisait y être allé avec un certain Jean de Cangis, probablement apparenté à son père naturel et dit avoir pris du plaisir au spectacle des Folies Bergères. Il mentionnait sa visite de l’exposition de meubles et tapisseries renaissance au Pavillon Sully du Louvres « où je suis allé, écrit-il, en temps que (Sic) délégué du tourisme » Ce dernier sous-entendu pose question. En effet, délégué du tourisme dans quel cadre professionnel ?
Pour clore la séquence Culture pour tous, Jean de Genévrier précisait qu’il était resté quinze jours à Paris et en avait profité pour visiter Notre-Dame et la Sainte-Chapelle « dont, dit-il, on est en train de remplacer les vitraux qui sont de toute beauté. »
Plus intéressant pour cerner le parcours de cet homme, cet enfant aux trois prénoms, il écrivait :
« J’ai presque obtenu ma nomination dans le centre, j’ai demandé Clermont-Ferrand ou Vichy, car à Paris, il est très difficile de trouver un appartement. Si j’étais marié, j’aurais le droit d’en faire réquisitionner un mais ma situation n’est encore pas suffisante pour que je puisse songer à le faire. »
Il avait vingt-six ans et éprouvait probablement encore un sentiment de rejet, d’abandon, en évoquant sa situation précaire. Deux ans auparavant, à la gare de la capitale auvergnate, sa mère n’avait-elle pas été absente lors de son retour d’Allemagne ? Le ton de la lettre changea :
« J’ai demandé à Madame M. et à sa bonne si c’était vrai qu’on avait téléphoné pour moi, les deux m’ont assuré que non et je n’ai jamais reçu la lettre que vous m’avait dit m’avoir écrite en réponse à la mienne. Il est possible qu’elle se soit égarée, mais c’est une chose qui arrive rarement. Je ne vois guère l’intérêt que vous avez à me raconter des histoires car je n’ai pas la méchanceté que je pourrai (Sic) avoir après les paroles et les lettres blessantes que j’ai reçu (Sic) et je me demande en les relisant (il les gardait soigneusement) s’il est possible qu’une mère qui aime vraiment son fils puisse penser un seul instant des choses pareilles, s’imagine des choses tellement ridicules et en fasse part à des personnes auxquelles on ne doit pas se confier. Vous ne devriez pas oublier si vite que la captivité a muri bien des jeunes et moi plus que tout autre, étant parti si jeune en Allemagne et n’ayant jamais ressenti d’une façon sincère et sans crainte l’affection qui unit une mère et son fils. Abandonné dans ma jeunesse et vivant ensuite dans une atmosphère qui était loin d’être celle où vivent les enfants, je suis parti au collège où votre situation de femme divorcée me fut jetée à la tête en maintes occasions par les professeurs et par les élèves qui me connaissaient comme ce Bournilhas qui était de Co. et qui me fit ainsi qu’à vous une bien mauvaise réputation à M. et ensuite à Ch. Ce fut un professeur qui me jeta à la figure mes origines et pourtant ces personnes-là étaient des prêtres […] je ne crois pas, comme vous le dites, que ce soit moi qui vous empêche de passer quelques jours à Paris, car en dehors des 35 000 francs que vous avez payé (Sic) pour ma moto, vous n’avez pas eu de grosses dépenses pour moi, une paire de souliers, un manteau, un costume […] à 4 000 francs, vous n’avez pas eu grand-chose, me cachant toujours la somme exacte que vous donniez à la mission puisque l’économe m’a dit que vous ne payez que pour les repas que je prenais à la mission, qu’il n’avait pas l’habitude de faire payer ce qui n’était pas dû. En plusieurs fois, vous avez défendu de me dire ce que vous touchiez des bois de V. et j’ai vu en plusieurs fois que Jean faisait des coupes trop sévères, coupant tous les grands arbres le long de la route de Co. aussi bien que bientôt il ne restera plus rien. Vous avez assez crié contre votre père qui avait fait une coupe sévère que Taznal a augmentée et je ne pense pas que vous vouliez me faire cette méchanceté, d’autant plus que V. m’appartient de droit et que je peux le jour où je le voudrai donner au tribunal les pièces qui me donnent le droit de propriété, mais je pense que vous préférerez le tout comme il se doit. Je termine en vous demandant de réfléchir un peu à votre attitude à mon égard et de ne pas raconter aux uns et aux autres des choses inexactes et qu’une mère n’a pas le droit de dire même si elles étaient vrais (Sic) . Il est bon de se taire pour ne pas se faire jeter la pierre à son tour, car je n’ai hérité d’aucune fortune et n’ayant pas eu la peine de la disperser, j’ai au contraire suivi ma conscience, ne tenant rancune à personne de m’abandonner et de me faire passer pour ce que je ne suis pas […] Dès que j’aurai fait réparer ma moto, je la vendrai et vous donnerai au fur et à mesure l’argent que vous m’aviez donné pour l’acheter. »
La lettre de Jean de Genévrier était en fait une réponse à ces lettres blessantes qu’il mentionnait dans son courrier de mars 47. Dans l’une, datée de septembre 46, elle lui rappelait sans ménagement qu’il avait vingt-cinq ans et qu’elle n’acceptait pas qu’il emploie à son égard « un ton qui ne mérite aucune réponse ! » Elle lui reprochait de ne pas avoir répondu à sa lettre du 23 ou du 22 août. Quelques phrases paraissant absconses, éclairent toutefois la situation de Jean de Genévrier à cette époque.
Compte tenu que cette lettre lui était adressée à la maison-château de l’avoué Saurat, Jean semblait donc déjà y vivre en 1946, non loin de celle d’Eloy Taznal, l’ex-mari de sa mère. Ce dernier mourra à cinquante-huit ans en 1957 dans le château dont il avait hérité en 1948. Les Saurat, avec leur fille Françoise, avaient l’habitude de s’installer pendant l’été dans la folie de Gardat, avant de retourner dans leur maison bourgeoise du bourg dont Saurat avait été maire et où il avait son étude d’avoué. Or, cette femme de quarante-cinq ans, au physique difficile, avait jeté son dévolu sur ce jeune homme de vingt-cinq ans – de vingt ans son cadet – dont elle connaissait parfaitement le parcours depuis sa naissance problématique, puisque son propre père, homme d’affaires des Genévrier depuis des décennies, en avait abondamment parlé à la maison depuis les années 20. Aujourd’hui, on la qualifierait de cougar. Cécile continuait ainsi la lettre adressée à son fils :
« Je ne vois pas pourquoi tu rappliquerai (Sic) ici, ici n’est pas l’usine Michelin ? De plus, je t’ai déjà écris (Sic) que je ne te recevrai plus chez moi tant que tu n’auras pas changé de conduite. Fais ce que tu veux avec ta moto, mais ne compte plus sur moi pour avoir quoi que ce soit, tu as 25 ans, tu n’as plus besoin de moi. Tranquillise-toi (Sic) , je n’ai nullement envie de mourir maintenant, donc tu n’as pas à te préoccuper que tu hériteras de 3000 francs de + ou –, donc tu n’auras pas à payer les pots cassés. Quant aux différents baux, mon homme d’affaires fera le nécessaire. Tes préjugés mesquins au sujet de Gaston me révoltent. On ne dirait pas que tu as été cinq ans prisonnier ? Je suis libre de faire coucher mes invités où bon me semble, donc je n’ai aucune observation à recevoir. Lorsque tu auras acquis autant de connaissances d’hygiène et de prudence que moi, tu pourras parler. Au lieu de t’abaisser à de tels procédés tu aurais pu me donner des détails sur ton voyage à St-Etienne où ce pauvre Pierre mourrant (Sic) t’a réclamé par dépêche. Je suis en bonne santé. Je t’embrasse tristement. Cécile de Genévrier. »
Une autre lettre, datée du 13 janvier 1947 et adressée de Maisons-Laffitte, confirmait le cruel duel mère-fils établi depuis quelques mois, montrant de profondes blessures qui se révèleront inguérissables jusqu’à la vieillesse et la mort de chacun d’eux. Cécile de Genévrier y présentait un portrait d’elle-même revu et corrigé en forme de pare-feu contre les éventuelles critiques de Jean. Elle y disait que tous ses amis avaient voulu inviter son fils à venir dîner mais que tous les appels téléphoniques étaient restés sans réponse :
« […] j’en suis peinée, de mon côté j’aurai tout fait pour te faciliter de profiter de mon séjour ici. J’ignore tout à fait quand je rentrerai. Les uns et les autres rivalisent d’affection pour moi et voulant tous m’avoir, me garder (elle énumère les amis, la famille) à Versailles, […] mais comme j’ai horreur d’accepter sans rendre, ce qui est conforme à la bonne éducation que j’ai reçu (Sic) , je n’ai jamais pu accepter jusqu’à maintenant aussi la réflexion que tu me fais dans ta lettre est bien déplaire ( ?), surtout que tu sais très bien que je me suis toujours sacrifiée pour toi directement ou indirectement. Un jour j’espère que tu sauras le reconnaître, mais il sera peut-être trop tard… »
Ces lettres, en quelques lignes, à elles seules, pouvaient récapituler un quart de siècle de la sombre vie de cet homme. Sa mère semblait, décidément, faire passer au premier plan les considérations matérielles, tout comme elle l’avait fait quelques années auparavant, en interpellant son propre père sur sa fortune. Et que pouvait-elle répliquer aux reproches de son fils ? En fait, cet enfant accidentel était devenu un homme insoumis, rappelant, sans réserve et sans prendre de formes, le parcours dont il était la victime et elle la coupable. Bien sûr, ce fils inopportun manifestait bien des travers, tout en tentant de répondre aux exhortations morales de ses maîtres, comme lorsqu’il avait été pensionnaire en Savoie. N’avait-il pas écrit le 22 janvier 1938, une lettre à Saurat :
« Excusez-moi de vous avoir fait attendre si longtemps pour vous écrire et vous remercier de tous les bons conseils que vous me donnez au début de cette année. Je sais en effet tous les sacrifices que maman fait pour me garder dans un collège et me faire donner l’instruction, chose si nécessaire actuellement. Je reconnais ma paresse et ma mauvaise volonté, aussi je veux y remédier en travaillant de mon mieux désormais, pour vous faire plaisirs (Sic) à tous. Je sais que maman n’est plus riche, on me la dit tant de fois depuis quelques années, j’en suis persuadé et même si nous étions riche (Sic), la fortune est si peu de chose que d’un jour à l’autre on peut se trouver ruiné. Je crois que pour mon oncle Edward ce temps n’est pas loin, aussi je serai trop ennuyé de me trouver plus tard incapable de gagner ma vie, aussi il faut que je travaille. Je vous remercie de tout l’attachement et de la bonté dont vous avez fait preuve tant de fois à l’égard de la famille et surtout de maman et moi et si nous ne sommes pas plus malheureux c’est grâce à vous et je vous en serai reconnaissant toute ma vie. J’espère pouvoir vous témoigner ma reconnaissance en vous écoutant vos bons conseils et en vous envoyant de temps en temps mes notes afin que vous vous rendiez compte de mon travail. Je les envoie régulièrement à maman toutes les semaines afin qu’elle sache ce que je fais. Je termine, Cher Monsieur Saurat en vous remerciant de vos bons conseils et vous demandant de bien vouloir accepter mes meilleurs vœux pour cette année ainsi que Madame Saurat et Françoise. Croyez, Monsieur, à ma profonde amitié. Jean de Genévrier. » »
Compte tenu du style et des termes, on peut douter que cette lettre fût de sa propre initiative. A l’évidence, Jean avait écrit sous la dictée d’un professeur en ce début d’année 1938, dernière année scolaire avant sa majorité en 1939 et son départ pour l’armée. On peut y voir là, la tentative de mettre au pas cet adolescent à qui l’on demandait de se conformer à la bonne éducation de son nouveau milieu social. Mais rien n’y fit. Le déterminisme qui sourdait en lui était inéluctable. Pétri de bric et de broc, ce jeune homme se laissa aller au plus facile. Il avait passé beaucoup plus de temps auprès de sa nounou toulousaine, de ses camarades de pension et de ses compagnons de captivité qu’auprès de sa mère biologique.
L’émancipation ?
Jean de Genévrier se sentait apparemment libre, mais sans aucun moyen matériel personnel. Il avait été assisté dès sa naissance, mais tout de même entouré, cajolé peut-être pendant les huit premières années de sa vie. Récupéré en 1929 comme un paquet laissé en poste restante en 1921. Transporté de Toulouse vers l’Auvergne, passant sans transition d’une famille d’accueil, rurale et aimante, à une hypothétique famille figée dans des principes factices. On peut estimer qu’à huit ans il avait déjà éprouvé des sentiments, rassemblé des souvenirs, développé une personnalité qui lui avaient conféré une identité, un tempérament.
Comment douter que de huit ans – âge auquel il se trouva parachuté dans une demeure étrangère, auprès d’une mère distante – jusqu’à dix-sept ans, âge auquel il fut, d’une certaine manière, exclu à nouveau de ce qu’il aurait pu estimer être sa maison, soit neuf ans pendant lesquels il était si rapidement passé de l’enfance à l’âge adulte, oui comment douter qu’il n’eût pas fait les expériences de la vie ordinaire pour beaucoup mais exceptionnelle pour d’autres, comme lui ? Dans des établissements scolaires religieux où se passent si souvent ce que l’on sait, il avait certainement été malmené et en même temps initié aux relations frelatées qui pouvaient expliquer que le petit Jean, puis Jean de Genévrier, ait manifesté de curieux comportements au regard des femmes en particulier. En effet, il avait un penchant pour se vanter de conquêtes féminines qui se révélèrent le plus souvent n’être que des relations, des rapports faussés, éphémères, les établissant parfois lui-même sous la contrainte, en particulier quand il s’agissait de très jeunes filles, fréquemment au service de la maison où il vivait.
Etait-il intrinsèquement porteur de principes viciés ? Comme, par exemple, le sentiment atavique du droit de cuissage ? Avait-il hérité d’un malheureux antécédent, réduisant le ou la partenaire du moment à un simple objet de plaisir, utilisable, s’il le fallait, à de vénales fins ? Traits que l’on vérifiera dans sa progéniture des années plus tard. Il ne semble pas que Jean de Genévrier ait eu des préoccupations morales.
Mais qu’en avait-il été en 1945/46 quand il rentra d’Allemagne en Auvergne, alors qu’il avait vingt-quatre ou vingt-cinq ans ? Sa mère lui avait rappelé sans ménagement qu’il avait été un piètre élève et, sans être réellement explicite, elle lui avait reproché surtout un comportement douteux. Compte tenu de ce que nous connaissons de cette période, elle faisait probablement allusion aux relations de son fils de vingt-cinq ans avec Françoise, la fille de Saurat, de vingt ans son aînée. C’est à cet âge qu’elle le mit à la porte de sa demeure du Livradois et qu’il dut se réfugier dans la folie de Gardat appartenant alors à Maître Saurat, puis en 1951 à sa fille Françoise.
Faute de grives, on mange des merles
Le petit Jean avait bien grandi. Il portait enfin un nom à particule, qu’il crut – naïvement – être une espèce de passe-partout social. Mais les années passant, devenant un homme, confronté à sa mère, dont il ignorait la vie réelle, et au voisinage, il n’était pas sorti indemne des séquelles de son obscur parcours : psychologie complexe, tendance à la maltraitance des animaux, mœurs sexuelles compliquées, égo disproportionné et en même temps sentiment d’infériorité, intuition d’être déclassé. L’illégitimité en partage. Il présentait de nombreux signes psychologiques d’un orphelin de père et de mère, et pourtant il était déjà porteur de l’inéluctable destin des Genévrier dont il avait hérité l’atavisme, autant par sa mère que par son père biologique, cousins germains.
On lui chercha une situation. Pourquoi pas assureur ? Sa mère, dépassée par ce fils indésiré qu’elle avait peu côtoyé, si l’on considère qu’après l’avoir repris à l’assistance publique de Toulouse fin 1929, il avait été plus souvent en pension que près d’elle de 1930 à 1938, sa mère donc le mit à la porte tout en l’adressant à Saurat qui connaissait parfaitement sa situation et avait correspondu avec lui pendant sa scolarité. Il éprouvait un certain attachement compassionnel pour ce pauvre jeune homme. Jean, de retour d’Allemagne, sans situation réelle, sans formation définie, s’était vu ainsi offrir le gîte et le couvert chez Saurat, moyennant quelques travaux. En effet, outre deux grosses maisons dans le bourg où il avait été maire et avoué, il possédait une grande propriété de 320 hectares dans la campagne de Gardat, comprenant une bâtisse de briques, baptisée château par courtoisie ou complaisance mais que jadis on nommait folie, espèce de grande maison de villégiature construite à la demande de l'aristocratie ou de la bourgeoisie aisée au 19ème siècle, souvent dans la campagne. Plusieurs domaines attenants assuraient un rapport financier suffisant.
Saurat avait acquis cette propriété pour sa fille unique, Françoise, qui ainsi pouvait envisager un avenir serein, voire un mariage. Cependant, de très petite taille, elle était de plus défavorisée par un physique difficile. A la mort de son père en octobre 1951, elle avait hérité du tout à la cinquantaine. Elle s’était entichée de Jean, cet infortuné jeune homme dans le désarroi, de près de vingt ans son cadet. Une rivalité était née entre Cécile de Genévrier et Françoise Saurat quand elles fréquentaient l’une et l’autre le même établissement scolaire dans la capitale auvergnate. Françoise Saurat pouvait ainsi prendre une revanche sur Cécile, la châtelaine, qui avait passablement harcelé son père quand il était l’homme d’affaires d’Aymar.
Trouver une situation à Jean de Genévrier, le caser en un mot, fut un objectif et on envisagea d’autre part plusieurs alliances locales : une Chouchou Timavon, une Jacqueline Reilla. Françoise Saurat s’était arrangée pour faire échouer toutes les tentatives, ces projets ne correspondant pas à ses secrètes espérances. Elles souhaitaient une très belle alliance. On avait pris contact avec les Vaudels de Banchord, une famille du coin, qui avaient refusé la proposition.
Pour des raisons liées aux préjugés de l’époque, on estimait que Jean de Genévrier ne pouvait avoir que des difficultés pour se marier dans le département. C’est ainsi que sa protectrice, après avoir étudié les possibilités locales, avait fait appel à la parenté de Jean, en particulier à Armand de Puechgur qui avait suggéré à une amie, veuve d’un Monsieur de Cerisier, de marier sa fille d’âge nubile avec Jean de Genévrier. Elle avait décliné l’offre.
Qu’à cela ne tienne, cet homme du monde séjournait fréquemment à Cannes où il rencontrait nombre de gens du monde. Il avait des rapports amicaux avec la famille des barons de l’empire Brode.
En attendant de trouver la jeune fille adéquate à marier, Françoise Saurat et Jean de Genévrier, de fait un couple atypique, faisait jaser dans le landerneau bourbonnais. Les frasques de Jean se multipliaient. Convaincu de son droit de cuissage, il s’en prenait en particulier à de très jeunes filles, provoquant des scandales dans la contrée, vite éteints par l’intervention – parfois financière – de Françoise. Bien évidemment, comment l’un et l’autre auraient-ils pu entrevoir leur mariage et a fortiori une postérité pouvant éventuellement hériter des biens des Saurat ? Même en allant à Lourdes, les carottes étaient cuites !
En dernière ressource, Jean de Genévrier multiplia les tentatives d’établir une relation durable avec d’éventuelles fiancées, comme cela apparaissait dans la lettre de juin 46 adressée à sa mère.
Bon sang ne saurait mentir ! Cette maxime s’appliquait sans restriction à cette engeance. Il ne fallait pas douter de l’aptitude de ces gens à élaborer des solutions adaptées aux situations les plus désespérées. Ils trouvèrent une issue comme l’avaient trouvée vingt-deux ans auparavant les Taznal et les Genévrier pour régler la venue au monde intempestive de l’enfant aux trois prénoms.
Chasse en terre lointaine
Françoise Saurat connaissait tout de la famille de Genévrier depuis des décennies. Cécile vivait comme une punition la liaison de son fils trentenaire avec cette créature quinquagénaire et, elle aussi, avait envisagé de trouver une solution acceptable au célibat de son fils, en favorisant la rencontre de Jean avec une jeune fille en vue du mariage. Mais toutes les tentatives faites dans la région avaient échoué ; la plupart des familles connaissant la bâtardise de Jean de Genévrier et sa situation plus qu’équivoque avec Françoise Saurat, déclinaient les propositions.
Alors, en désespoir de cause, on fit appel à la parenté par la jambe gauche. Jeanne de Genévrier, sœur d’Aymar, mère de Jacques de Cangis lui-même père naturel du petit Jean, avait eu un fils de son premier mariage, Armand, ci-devant marquis de Puechgur, récent titre de la Restauration. Il avait déjà soixante-six ans quand Françoise Saurat, Jean de Genévrier et consort se mirent à la recherche d’une jeune fille à marier. Ce marquis, homme du monde, séjournait fréquemment à Cannes où se rencontrait la Haute. Il était donc le demi-frère de Jacques de Cangis et ainsi l’oncle naturel de Jean de Genévrier, le Petit Jean.
Comme nous l’avons déjà dit, il connaissait la veuve du 5ème baron de l’empire, François Brode, qu’il rencontrait régulièrement lors de tournois de bridge. Et c’est au cours de ces rencontres mondaines des années 1950/51 qu’il lui parla de sa famille. Il se laissa aller à des confidences sur une situation habituellement tue. En quelques mots, il expliqua que sa mère, Jeanne de Genévrier, avait eu d’un second mariage un garçon, Jacques de Cangis. Ce jeune demi-frère, passant quelques jours de vacances dans le château de son oncle en Bourbonnais, avait engrossé sa cousine germaine, Cécile de Genévrier, et de cet accroc à la morale était né un fils. Le marquis expliqua longuement et dans les détails ce qu’était devenu depuis lors ce malheureux garçon, reconnu par sa mère en 1929, mais toujours célibataire, passant allégrement sous silence le lien que Jean de Genévrier entretenait avec Françoise Saurat.
Attentivement, la baronne Brode écouta cet ami bridgeur. Elle avait bien compris dans quelle intention le marquis avait parlé et elle réfléchit longuement avant de confier à Armand de Puechgur qu’elle-même avait une petite-fille, Sylvia, dont la situation au regard de l’état-civil posait problème. Elle ne fut pas économe de détails. Elle évoqua les conditions dans lesquelles elle était née en Allemagne, tout en ayant à l’esprit l’espoir de trouver à caser sa petite-fille :
- Quand ma fille Huguette s’est mariée en 1920 elle était encore mineure. Son mari était officier colonial britannique et dès son mariage il l’a délaissée. Elle en avait eu un fils. Ce mariage n’avait jamais marché. Il était constamment absent de la maison. Pendant quelques années, Huguette avait attendu son retour, mais il était plus préoccupé de voyages en Afrique, en célibataire, que de sa famille. Dans les années 30, elle était reçue dans les clubs niçois avec son frère et ses sœurs et c’est là qu’elle a rencontré Gyula, un comte hongrois… vous savez, cher marquis, un de ces seigneurs appartenant à ces grandes familles de magnats. Ils avaient subi les effets de la chute de l’empire austro-hongrois. A plus de trente ans, ils étaient tous les deux insouciants, loin de la réalité. Ils avaient la bougeotte et ils se sont mis à sillonner l’Europe. Au début 32, elle s’était retrouvée enceinte, ce qui n’avait pas pour autant interrompu leur périple. Il faut dire que ma fille s’était privée pendant quelques années. Dès le début décembre 32, ils étaient à Wiesbaden pour les fêtes de fin d’année. Ils soupaient dans un restaurant et ma fille a ressenti des contractions. On l’a transportée d’urgence à l’hôpital, autant que je me souvienne c’était au Josephinenheim. Elle a accouché de Sylvia, ma petite-fille, précisément comme elle me l’avait expliqué quelques années après, un jeudi de décembre à 5h45. Comme je vous l’ai dit, son mari était en Afrique du Sud depuis des mois. La déclaration de naissance avait eu lieu évidemment sous le nom marital d’Huguette. Vous comprenez donc, cher ami, que l’officialisation de cette naissance avait été malaisée. Les troubles sociaux de cette époque annonçaient comme vous le savez la guerre. Ma fille et Gyula décidèrent de confier Sylvia à un Kinderheim à Wiesbaden, le Josephinenheim dont je vous ai parlé. En fait, ils l’on laissée jusqu’en 1935. Elle avait deux ans et demi quand ils l’ont reprise.
La baronne parla sans interruption. Elle se tut, visiblement lasse. Selon les souvenirs de Sylvia, sa grand-mère était une grande femme, brune, maigre et distinguée. D’après elle, la famille Brode était atteinte d’un snobisme qui pouvait frôler la mystification. Des larmes coulaient des yeux de cette femme déjà âgée de soixante-treize ans. Elle avait vécu des instants tragiques depuis la mort de son mari vingt ans auparavant. Elle reprit, après avoir bu une gorgée de thé :
- Ma fille et mon gendre avaient décidé tout-de-même de présenter leur fille à la famille de Gyula et ils l’emmenèrent à Budapest. Et comme me l’a expliqué Huguette, ils étaient descendus à l’hôtel Ritz parce que la mère de Gyula voyait d’un mauvais œil son fils marié à une femme divorcée. Puis, de Budapest, ils sont venus à Cannes pour me la présenter. Sylvia était adorable avec ses cheveux blonds et ses si beaux yeux bleus. Ils étaient restés quelques jours chez nous, moi et ma dernière fille Marie-Jeanne. Nous habitions alors à la ‘villa La Parisienne’. Huguette et Gyula m’ont expliqué qu’ils n’avaient rien pu faire sur le moment pour régulariser la situation de leur enfant. Ils savaient que seul le divorce l’aurait permis. Et dès qu’elle l’a pu, ma fille a engagé à Cannes, une procédure. Ça n’a abouti qu’en juillet 1934. Elle avait obtenu le divorce aux torts exclusifs et aux dépens de son mari et elle avait eu la garde de son fils de neuf ans. Mon petit-fils Franz était encore bien jeune et Huguette se trouvait avec deux enfants. C’est pour ça qu’elle et Gyula avaient confié Sylvia au Kinderheim de Wiesbaden en décembre 1932. Je me suis occupée de Franz. Avec l’aide de mon beau-frère et de sa femme, cousine germaine du général Leclerc, il avait été admis au Magdalen College d'Oxford où il était resté de 1943 à août 1945. D’ailleurs, il est actuellement très proche d’une des petites nièces du maréchal Leclerc. »
Franz se mariera six ans plus tard avec Angèle, la petite nièce du maréchal Leclerc.
Le marquis très attentif, attendait la suite avec impatience :
- Mais chère amie, après tout ça, qu’est devenue votre petite-fille ?
Elle fut un peu agacée de cet insistant intérêt du marquis pour la destinée de sa petite-fille. Mais elle reprit :
- En fait, ma fille et Gyula voulaient depuis longtemps régulariser leur situation, mais vous comprenez bien, cher ami, que légalement ils n’avaient pas d’autre choix que d’attendre le divorce, constamment reporté par mon ex-gendre sans raisons objectives. Après le délai légal de viduité, ils avaient rapidement organisé leur mariage. Ils s’étaient mariés à Strasbourg en 1935 et Gyula avait reconnu Sylvia comme sa fille devant un notaire de Wiesbaden, Maître Wacker, autant que je me souvienne. Mais, et je ne l’ai su que bien plus tard, ni l’un ni l’autre, certainement par négligence, n’avait fait le nécessaire auprès des mairies de Wiesbaden et de Strasbourg pour que ma petite-fille soit légitimée par leur mariage. Ils auraient dû provoquer le désaveu en paternité de Sylvia par mon ex-gendre et elle aurait pu légalement porter le nom de Gyula, son père naturel. Ma petite-fille n’a su la vérité sur sa naissance que tardivement.
La grand-mère de Sylvia soupira, but une gorgée de thé tiède et reprit sous le regard attentif du marquis :
- Mais, en toute franchise, il faut dire que mon ex-gendre avait entrepris une procédure de désaveu devant l’Amirauté de Londres… à ma connaissance ça n’est toujours pas transcrit à ce jour, ce qui explique les difficultés dans lesquelles ma petite-fille se trouve encore aujourd’hui pour certaines démarches administratives… tout ça est le résultat de leur insouciance, et même de leur immaturité tardive, mais aussi des bouleversements de cette époque.
A l’évidence, émue, la baronne Brode hésita, but encore et baissa les paupières :
- Dans les années 41/42, le couple se querella. Ils n’avaient apparemment pas les mêmes conceptions politiques. Gyula, était un paradoxe à lui seul. Il avait des mœurs de seigneur, mais il professait des idées progressistes, sans doute influencé par sa sœur très proche de la femme de Mihály Károlyi, l’ancien premier-ministre et président de Hongrie des années 1918 et 1919… pour la petite histoire, ce richissime aristocrate avait donné la majeure partie de ses immenses terres aux paysans… mais ma fille, elle, avait des idées nationalistes, maurrassiennes, comme d’ailleurs toute ma famille et depuis toujours et comme vous, je pense, cher marquis. Ils s’étaient séparés, sans divorcer. Huguette avait pris avec elle sa fille Sylvia. Et je ne me l’explique pas, soupira la baronne, elle s’était éprise d’un officier allemand à Paris. Je me souviens qu’il faisait partie de la famille von Schlottheim. Mais, voyez-vous, cher ami, tout cela a très mal fini.
Elle s’interrompit sous le coup d’une vive émotion. Elle but lentement le reste du thé qui s’était refroidi dans la tasse. Après un long silence qui émut le marquis, elle reprit, visiblement affectée :
- Après sa séparation de Gyula, ma fille a emmené avec elle Sylvia dans ses déplacements. Elle avait une certaine vie culturelle. Fidèle à son attachement à la monarchie, elle avait donné des conférences sur le Chevalier Destouches à la Salle Pleyel. Gyula était parti pour Ankara en Turquie où il avait dit faire des affaires. Cette enfant était ballotée, elle n’avait que onze ans. Alors j’avais suggéré à Huguette de la confier momentanément à ma belle-sœur, la cousine germaine du maréchal Leclerc, qui avait épousé le plus jeune frère de mon mari. Mon mari est mort il y a plus de vingt ans mais mon beau-frère et sa femme sont toujours vivants et sans enfants. Là, je savais qu’elle serait en sureté. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Cette grand-tante a fait baptiser Sylvia à Amiens et lui a fait faire sa communion privée. Il faut dire que par désinvolture ma fille et mon gendre ne s’en étaient pas préoccupés. Vous savez, cher ami, ma petite-fille ne pouvait pas être mieux entourée. Mon beau-frère et ma belle-sœur sont des patriotes convaincus. Il y a quelques mois, on m’a rapporté qu’en mai 41, ma belle-sœur avait accueilli chez elle une famille qui fuyait en carriole, alors que les risques étaient grands dans cette région de la Somme.
La baronne prit le temps de se resservir une tasse de thé froid et continua :
- On m’a récemment dit que quelqu’un avait relaté comment ma belle-sœur et mon beau-frère avaient accueilli cette famille sur le chemin de l’exode. Si vous le voulez bien, je vous le lis.
La grand-mère de Sylvia sortit de son sac une feuille dactylographiée :
- Voici l’essentiel de ce qui est écrit : ‘On était désorientés. Une vieille dame mal habillée nous a dit qu’elle pouvait nous héberger et qu’elle habitait à cent mètres de là. C'était en fait la châtelaine du village. Elle nous a laissé des chambres en nous précisant que nous devions nous sentir comme chez nous… nous sommes donc restés un mois sur place. Elle et son mari écoutaient la BBC. Pendant ce temps-là, les troupes allemandes continuaient de déferler. Ce fut un privilège rare. Cet exemple a fait basculer ma vie.’ Cet écrit me fait du bien et en même temps me rappelle tristement Huguette.
De nouveau, elle reprit son souffle, manifestement affligée :
- Vous voyez, cher ami, combien le comportement de ma fille Huguette était en contradiction avec ce qu’elle savait de son oncle et de sa tante chez qui sa fille avait été accueillie. Mon beau-frère et ma belle-sœur étaient évidemment des ‘gens de droite’ mais exécraient les collaborateurs. Pour eux, l’honneur de la France passait par-dessus tout et la charité chrétienne était leur pain quotidien. Pourquoi ma fille était-elle tombée dans le pire ? Nous n’avons jamais eu vraiment d’explication. Elle est morte trop tôt dans des circonstances dramatiques pour Sylvia. »
Pendant quelques secondes, le marquis de Puechgur eut une espèce d’absence. Il avait été lieutenant-colonel de l'armée de l'air et le récit de la baronne l’avait renvoyé à quelques-uns de ses souvenirs :
- Ah bon ! Mais comment votre fille est-elle morte ?
- Comme je vous l’ai dit, Huguette avait laissé sa fille dans la Somme, chez son oncle et sa tante en 43, quelques mois après s’être séparée de Gyula. Elle avait rejoint Schlottheim, se méprenant sur l’issue de la guerre. Au début 45, elle croyait encore qu’elle pouvait échapper à la débâcle de l’armée allemande. Elle s’était fourvoyée. Elle est venue chercher sa fille qu’elle a aussitôt emmenée en car jusqu’au fin fond de l’Autriche. Comme vous le savez certainement, cher ami, une opération militaire avait été lancée par le troisième front ukrainien pour s’emparer de Vienne et cela avait duré du 2 au 13 avril 1945. Et ma fille et ma petite-fille étaient là-bas, fuyant devant l’Armée Rouge…
La grand-mère de Sylvia sanglota. Le marquis se leva et appela une employée de maison :
- Voulez-vous apporter du thé !
Mais très dignement la baronne se reprit, se redressa et s’assit à nouveau, s’excusant auprès du marquis visiblement touché.
- Vous comprendrez pourquoi et combien j’ai été bouleversée quand on m’a rapporté ce qui s’était passé ensuite… cela avait été dramatique. Elles étaient toutes deux seules. On m’avait dit que l’Armée Rouge écrasait tout sur son passage et ne faisait pas de quartier. Elles étaient arrivées vers le 18 avril 1945 à Feldkirch, à la frontière de l’Autriche et du Liechtenstein. Elles étaient descendues dans un hôtel. J’ai su par son acte de décès qu’il était situé au 15 de la Marktplatz. Dans la nuit du 20 au 21 avril 45, Huguette avait été prise de terribles maux de gorge, de vomissements et d’une très forte fièvre. Elle avait dit à Sylvia qu’elle allait mourir, se croyant empoisonnée. Toujours par son acte de décès, j’ai su qu’on l’avait transportée à l’hôpital municipal de Feldkirch au 7 de la Walgaustraße. Le médecin avait diagnostiqué une scarlatine qui avait entrainé une néphrite aigue et une crise cardiaque. C’était un samedi m’a-t-on dit, le 21 avril 1945, elle avait été emportée en quelques heures. Elle était morte à 9h30 et Sylvia n’avait plus revu sa mère. Elle avait douze ans et elle était complètement seule. Des religieuses l’ont prise en charge.
Les yeux embués, elle baissa les paupières.
- Triste époque, dit faiblement le marquis.
Elle continua, les joues empourprées :
- Vous devez peut-être savoir qu’Hitler est mort quelques jours après, le 31 avril. Mais aussi qu’il s’était passé d’autres événements à Feldkirch. On m’avait appris que la Suisse avait refusé le 25 avril l’asile à Pierre Laval et qu’il avait pris l’avion à Feldkirch pour l’Espagne. Allez savoir pourquoi, on m’avait même précisé que c’était un Junkers. On sait qu’il a été exécuté à la prison de Fresnes le 15 octobre 1945.
Le marquis avait ainsi compris ce que Sylvia avait subi pendant ces années de guerre. Cependant, l’histoire de cette enfant ne s’arrêtait pas là ! La baronne Brode se reprit :
- Imaginez-vous, cher ami, cette enfant de douze ans, seule, même si les bonnes sœurs l’avaient prise en charge… Sylvia m’a expliqué il n’y a pas très longtemps ce qui s’était passé dans les quelques jours après la mort d’Huguette. On avait hâtivement enterré sa mère dans le cimetière. Elle ne m’a pas parlé de cérémonie religieuse. Elle avait dû expliquer aux bonnes sœurs qu’elle avait une tante à quelques kilomètres seulement. Une lointaine tante de son père, la princesse Marezza von Liechtenstein. Les bonnes sœurs avaient téléphoné à Vaduz et on l’avait conduite à Schaan à une quinzaine de kilomètres de Feldkirch dans une institution religieuse.
Un silence gêné s’établit dans le salon. Il commençait à se faire tard et la baronne se sentait fatiguée. Le marquis lui proposa de la revoir quelques jours après. Elle sourit tristement, en acquiesçant.
Trois jours plus tard, les deux amis se retrouvèrent pour le thé. La baronne avait repris un peu de forces et le marquis attendait impatiemment de connaître la suite de l’infortune de Sylvia. En effet, il était d’autant plus intéressé qu’il envisageait déjà une éventuelle rencontre de son neveu Jean de Genévrier et de la petite-fille de la baronne Brode. La grand-mère reprit le récit où elle l’avait laissé :
- Vous savez, cher ami, la scolarité de Sylvia avait été élémentaire, ballottée d’un hôtel à l’autre, d’une institution à l’autre jusqu’en 45, entre la France, l’Autriche, la Hongrie, la Roumanie, la Russie, l’Angleterre, la Suisse, le Liechtenstein et je ne sais où encore. Donc, comme je vous l’ai dit il y a quelques jours, Sylvia a été recueillie dans une institution religieuse de Schaan, au Liechtenstein. En fait, elle n’y est restée que de mai à septembre 45. On l’a scolarisée et la langue qu’on lui parlait était l’allemand, comme au Kinderheim quelques années avant. Cette situation m’était pesante. J’ai demandé qu’on la conduise ici à Cannes où je l’ai accueillie. J’étais très inquiète pour sa santé et sa scolarité et je l’ai inscrite au Cours Maintenon de Cannes. Vous voyez, dans la rue Edith-Cavell. Patricia Blay, la petite fille de la fondatrice de cet établissement, était sa principale camarade. Elles prenaient souvent le goûter à la maison. Donc, dès la rentrée 1945, Sylvia a été admise au Cours Maintenon où elle est restée jusqu’en juin 1948. Elle présentait un retard scolaire évident, mais elle était intelligente et avait tout de même suivi sans grande difficulté les cours de 6ème et 5ème. Mais vous savez, cher ami, elle a aussi bénéficié de la culture de ses parents qui étaient amateurs de musique, de littérature et de peinture.
La baronne Brode fit une pause, se leva et alla se rafraichir le visage. Elle revint plus alerte et se mit à parler de tout autre chose au marquis de Puechgur. Mais il espérait encore plus de détails sur cette jeune fille qui, selon lui, aurait pu, enfin, être destinée à son neveu. Il se hasarda :
- Mais, chère baronne, depuis 48, qu’est devenue votre petite-fille ? Quel parcours pour une adolescente ! Elle n’a donc pas pu voir son père depuis la mort de sa mère en 1945 ?
- En fait, à la fin du Cours Maintenon, elle avait déjà quinze ans et demi et elle vivait mal d’être dans une classe où ses camarades avaient deux ans de moins qu’elle. Elle avait manifesté le désir de s’occuper de jeunes enfants. On lui a trouvé une formation dans le Valais Suisse, à Sierre, à la Clinique Sainte-Claire. Elle y est restée d’octobre 1948 à juillet 1950. En fait, il n’y a pas si longtemps qu’elle est revenue. Cela a été éprouvant physiquement pour elle. Elle n’avait pas une excellente santé. Mais aussi, il y avait quelques problèmes financiers car les études étaient payantes. Sa tante Liechtenstein est allée lui rendre visite et elle ne l’a pas trouvée en bonne forme. D’ailleurs cette tante m’a écrit à cette époque. En novembre 49, elle avait demandé comme d’habitude, à la directrice de l’institution ‘La Providence’ où était Sylvia, la permission de la recevoir à Lausanne et on lui avait répondu qu’on avait pris la décision de ne plus la laisser y aller, parce qu’à chaque fois qu’elle en revenait elle était insupportable. Des amies de cette tante qui avaient vu Sylvia récemment, lui avaient rapporté qu’elle n’avait pas bonne mine et qu’elle était frêle pour son âge. Vous savez, cher marquis, j’étais très inquiète d’autant plus que cette tante m’avait précisé craindre que cette ambiance n’ait pas été profitable pour cette jeune fille de presque dix-sept ans. Il est vrai qu’elle s’y trouvait à mon initiative.
Il était près de six heures et demie. Ce Tea Time avait été plus long que d’habitude. La baronne Brode était fatiguée :
- J’ai beaucoup parlé, cher ami… j’ai dû vous épuiser avec mes histoires de famille. Je pense que samedi prochain nous pourrions reprendre cette conversation.
A l’évidence, le marquis était resté sur sa faim. Il aurait aimé savoir rapidement ce qu’était devenue la jeune Sylvia qui maintenant devait approcher la vingtaine. Elle était encore mineure. N’avait-il pas, quelques jours auparavant, amorcé ces échanges avec la baronne dans le but précis de l’amener à parler de sa petite-fille ? Il n’avait pas perdu de vue l’éventuel mariage de son neveu, Jean de Genévrier. Qu’à cela ne tienne s’était-il dit, la prochaine fois il saurait si cela était possible ou non. De toutes les manières, ici, à Cannes, on était loin de l’Auvergne profonde.
Le marquis de Puechgur et la baronne Brode se retrouvèrent avec plaisir ; lui avec un regain de curiosité.
- Comment allez-vous aujourd’hui, chère baronne, vous savez j’ai beaucoup réfléchi à ce que vous m’avez révélé sur votre petite-fille. Tout cela est navrant mais aussi bien intéressant. Ce n’est pas une vie banale.
La grand-mère de Sylvia se sentit engagée à poursuivre :
- Vous savez, j’aurais préféré que Sylvia soit épargnée. Mais, comme je vous l’ai dit, elle était en Suisse où nous pensions qu’elle aurait pu atténuer son retard scolaire et aussi réparer sa santé. Après coup, je m’étais fiée aux courriers que sa tante Liechtenstein m’avait envoyés en 49. Elle était étonnée qu’on l’ait dirigée vers une formation de nurse alors qu’elle avait de grandes dispositions pour la musique et qu’elle aurait pu étudier le piano et le chant. Elle semblait douter que Sylvia ait choisi elle-même cette orientation de nurse. Ce n’était pas faux. En fait, c’est moi-même qui l’avais orientée, bien sûr avec l’avis de ma belle-sœur Leclerc.
La baronne Brode reprit son souffle :
- Et puis, en toute honnêteté je dois vous dire que dans une de ces lettres de novembre, cette tante faisait allusion à Gyula, le père de Sylvia. Elle disait avoir rencontré à Lausanne un des oncles polonais de mon gendre qui supposait que Gyula était sur la Côte d’Azur… pourtant en 49, nous ne l’avions pas vu. En fait, il n’était pas en odeur de sainteté dans sa famille.
Le visage de la grand-mère de Sylvia se ferma, se remémorant un événement qui l’avait profondément bouleversée.
- Il me faut vous parler de Gyula. En fait, il a été élevé jusqu’à l’âge de dix-huit ans par un père très connu en Hongrie dès la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle. Il recevait dans une de ses immenses propriétés toute la haute aristocratie européenne et des têtes couronnées et dépensait sans compter et Gyula en est resté à cette conception obsolète de la société. Il voyage, descend dans les grands hôtels et restaurants, ne se pose jamais la question des moyens financiers qu’il lui faut pour vivre. Il a souvent compté précisément sur ce richissime oncle maternel polonais qui vit encore à Lausanne à l’Hôtel Beau-Rivage. Mais à lire les lettres de la tante Liechtenstein, il semble lui avoir coupé les vivres. La mère de Gyula est morte en juin 49 à Lausanne. Elle était elle-même aidée par son frère. J’ai omis de vous dire, cher marquis, que Sylvia était restée en Suisse jusqu’en juillet 50 et que grâce à sa tante Malatesta, elle avait aussitôt été engagée comme hôtesse d’accueil à l’aéroport de Rome-Ciampino. Elle n’avait pas encore vingt ans. D’ailleurs, elle y est encore… elle doit rentrer à Cannes dans quelques jours. Il est prévu qu’elle parte pour Lourdes où elle devrait travailler dans le magasin O’Tooly. Cela pour lui faire comprendre la réalité de la vie.
- Mais, chère amie, ne m’avez-vous pas dit que vous alliez me parler de son père ?
La baronne fut déstabilisée. Dans un premier temps, elle avait eu l’intention de parler de son gendre, mais elle s’était engagée dans un récit d’évitement. Elle se rendit compte de son hésitation et se ressaisit tout en se demandant si ce qu’elle allait dire au marquis était bien utile. Elle se racla discrètement la gorge et se versa une tasse de thé.
- En effet, j’ai encore l’esprit troublé. Comme vous avez pu en juger, ma petite-fille a eu une enfance et une adolescence décousues et, je l’avoue, je n’ai pas été toujours à la hauteur, déconcertée que j’avais été par la mort d’Huguette et le comportement inapproprié de mon gendre il y a quelques temps. Oui, je dois dire qu’on m’a fait savoir il y a quelques mois que Gyula était allé en Italie pour voir sa fille. Et son attitude avait été ambiguë au point que Sylvia en avait été effarée et en avait parlé à sa tante Malatesta. Il fut repris très sévèrement et même inquiété. Voilà, cher ami, ce que je voulais vous dire sans ambages sur mon gendre.
Les deux amis se regardèrent attentivement, semblant s’être acquittés d’une mission. Le séjour de l’oncle de Jean de Genévrier tirait à sa fin.
- Vous savez, chère amie, que je partirai pour Paris dans trois jours et j’aurais souhaité aborder avec vous plus précisément une situation que nous pourrions sans doute régler nous-même. Comme je vous l’ai expliqué au début de mon séjour, mon neveu Jean de Genévrier a actuellement trente et un ans. Je vous ai donné des détails sur son parcours aussi mouvementé que celui de votre petite-fille. Il cherche à se marier. Sa mère désire évidemment qu’il connaisse une jeune fille de bonne famille ayant des points communs…
La baronne n’en fut pas surprise. Elle avait deviné au cours des nombreux et longs échanges qu’ils avaient eus, que le marquis avait une intention. Elle s’y attendait même. En fait, cela allait aussi dans le sens de ses propres attentes. Elle souhaitait depuis plusieurs mois que Sylvia puisse se trouver, enfin, dans une situation stable, quitte à la marier.
- Ecoutez ma chère amie, je vous propose que dès mon retour à Paris nous mettions par écrit de quoi organiser leur rencontre. Je vous souhaite une bonne fin de journée, chère baronne.
De l’infatuation à la transaction
De retour à Paris, le marquis de Puechgur s’empressa de prendre contact avec son neveu et Françoise Saurat. Les échanges furent nombreux et semblaient combler de plaisir les uns et les autres. Pensez donc, on avait dégotté la perle rare : une belle jeune fille d’à peine vingt ans, avec un pedigree de haute noblesse européenne, descendante entre autres du roi Christian IV de Danemark par de nombreux princes. Jugez-en se disaient-ils entre eux, le grand-père a été gouverneur de Fiume et de la Côte croate et l’arrière-grand-père avait été Grand-maître de la Cour austro-hongroise et avait possédé des milliers d’hectares, des châteaux, une écurie de plus de cent chevaux et un remarquable hôtel particulier à Budapest ; le jackpot quoi ! Mais encore, et la baronne Brode ne s’était pas privée de le rappeler, sa petite-fille était aussi une descendante d’un duc, plusieurs fois ministre de Napoléon 1er, qui avait négocié le mariage de l’empereur et de Marie-Louise d’Autriche quand il était ambassadeur de France à Vienne. Et ils se gargarisaient de titres, d’alliances flatteuses. Rendez-vous compte, une authentique comtesse dont le nom était celui d’un héros de l’épopée austro-hongroise contre les Ottomans. Oui, un vrai titre de comtesse datant du 18ème siècle, alors que la famille de Genévrier s’était affublée d’un titre de baron de complaisance ! Françoise Saurat boursoufflée, entrainait dans son délire celui qui avait été l’enfant aux trois prénoms. Quelle promotion ! pensait-elle, et cela grâce à elle.
En juin et juillet 1952, la baronne Brode et le marquis de Puechgur entretinrent une correspondante assidue dont le seul but était d’organiser une rencontre entre Sylvia et Jean. Pourquoi donc les rapprocher ? Selon eux, tous deux avaient un point commun : une naissance aux circonstances problématiques. Pourtant, il n’y avait que peu de similitudes entre les deux situations. A cette époque, en 1952, Jean avait trente-et-un ans et Sylvia dix-neuf. Les marieurs organisèrent donc une réunion au début septembre par l’entremise de Madame de Sainte-Perrine dans son château du Bois en Bourbonnais. Pourquoi cette rencontre n’avait-elle pas eu lieu dans la propriété où vivaient, ensemble, Jean de Genévrier et Françoise Saurat ? On le comprend aisément.
L’affaire, en forme de transaction, fut promptement conclue puisque le mariage civil fut programmé pour dans le bourg où était née Françoise Saurat et où son père avait officié comme avoué et maire, et le mariage religieux à Cannes.
Et c’est là que réapparut la réalité des faits, qui, soit dit en passant, sont têtus comme l’a écrit Mark Twain. En effet, tous les échanges, les palabres, les bonnes intentions n’avaient en rien modifié les documents permettant d’identifier un individu. Et il fallait produire les actes de naissance et autres pièces. Bien entendu, la bâtardise de Jean ne pouvait pas être gommée. Mais pour Sylvia, comment donc ces gens-là s’y prirent-ils pour court-circuiter les obligations administratives ? La présentation aux autorités locales de l’acte de naissance de Sylvia, tel qu’il était encore rédigé à cette époque, aurait contredit tous les beaux discours sur ses origines. Car, comme l’avait dit la baronne Brode au marquis de Puechgur lors de leurs abondants échanges à Cannes, l’acte de naissance n’avait pas été rectifié à Wiesbaden, établissant que Sylvia était la fille de Gyula et d’Huguette, malgré la reconnaissance légale devant un notaire de Wiesbaden. Sans conteste, la cause en était aux aléas de l’histoire politico-militaires de cette époque et à la légèreté des parents.
Y avait-il eu une solution à la situation ? Poser la question était douter de l’imagination fertile de la fine engeance entourant Sylvia, tant la grand-mère Brode que l’oncle Puechgur ou même l’entremetteuse Françoise Saurat. Jean ne semblait pas encore bien armé pour participer efficacement à ce tortueux scénario. On avait donc utilisé une trouvaille digne d’un brevet d’invention. Alors qu’on était en 1952 et que Wiesbaden était en Allemagne Fédérale, en zone occupée par les Français, la fine équipe avait décidé que Wiesbaden était en zone russe et qu’il était impossible d’obtenir l’acte de naissance de Sylvia. C’était ainsi ! Cela illustrait tout-à-fait la propension de ces gens à tricher. Alors on avait fait appel à des amis pour établir un acte de notoriété travestissant la réalité. Ce document demanda la déclaration sur l’honneur de familiers de Françoise Saurat et du marquis de Puechgur, entre autres Rose du Veau de Compère et Jeanne des Près de Jauneix. Ils attestèrent que Sylvia était née de Szilvester (en fait, le frère de son père), à Wiesbaden, « ville dont le statut politique ne permettait pas d’obtenir dans les délais les papiers nécessaires au mariage. » Qu’importe, le mariage était effectif. La tragi-comédie pouvait commencer !
Premier acte : show must go on
Ainsi – comme nous l’avons déjà souligné, alors qu’ils ne se connaissaient pas, s’étant rencontrés quelques heures autour d’un thé – les maria-t-on en octobre 1952 à la mairie du bourg où les Saurat étaient implantés, puis religieusement à Cannes où vivait les Brode, famille maternelle de Sylvia. Les deux témoins furent l’inévitable Françoise Saurat et une de ses amies proches. Cérémonies des plus sobres d’après Sylvia qui avait refusé d’être en blanc ! De son propre aveu, ce ne fut pas la joie. Elle s’était étonnée de l’absence de Cécile de Genévrier, sa belle-mère, aux deux cérémonies. Sur la photo prise après la cérémonie religieuse, célébrée dans la chapelle du Souvenir de Cannes, figurent Sylvia en tailleur noir et Jean, Françoise, le marquis de Puechgur, la tante Brode-Leclerc et son mari ; n’y est pas la grand-mère Brode qui n’avait alors que soixante-treize ans et qui ne mourra pourtant qu’en 1958.
Un an après son mariage Jean de Genévrier écrivait à sa mère :
Gardat, octobre 1953. « Chère maman, Je viens de recevoir votre carte-lettre et vous réponds de suite. D’abord pour nous excuser d’avoir fait faux bond pour la visite promise : cela est dû à l’interdiction du Dr qui soigne Sylvia de faire de la voiture. Depuis notre retour de Bretagne, elle est allée voir le gynécologue par trois fois et la dernière fois, il y a une quinzaine de jours, il est venu sur place lui empêchant même de faire 35 km. Voilà ce qui explique notre absence à aller vous voir. En effet, après un retard de 15 jours dans ses règles, je lui ai fait examiner aussitôt. Il y aurait un grand espoir, mais il faut beaucoup de précautions, aucune fatigue ni surmenage. Un Leclerc nous offrait un superbe voyage fin septembre (un des symptômes de sa mythomanie), autour du 20, nous avons dû refuser malgré la joie qui nous envahissait depuis le début août où nous avions accepté leur offre. Avant le printemps, il n’est donc pas question de longs déplacements car la naissance serait prévue pour le 15 mai, ce qui nous enchante, après la promesse faite à N.D. d’Auray de lui consacrer notre premier enfant. Je comptais sur mon passage en Livradois pour emporter des affaires que j’avais encore là-bas. Pourriez-vous me les envoyer en gare de B. où je les prendrai, et mes effets qui sont restés, linge, vêtements, livre de messe, collection de timbres (que je continue), pourriez-vous joindre le livre d’astronomie de Flammarion et le ‘Monde merveilleux des insectes’ que m’avaient donnés Edward. Je me monte une bibliothèque et je voudrais bien avec ces deux livres, très beaux comme reliure et planches en couleur. J’espère petit à petit pouvoir meubler les pièces que Melle Saurat nous a données à Gardat, mais j’étais tellement gâté en Livradois par les jolis meubles que je ne puis m’acheter, que je ne puis m’habituer à des meubles de pacotille. Quand on débute dans la vie, sans argent, ni linge, ni mobilier, on ne peut satisfaire tous les goûts ou désirs que l’on a. Je voudrais, à cause de cela, récupérer un peu de ce que j’ai laissé. Pourriez-vous m’envoyer en même temps la peau de bique et les guêtres qu’oncle Armand m’avait données, enfin tout ce que vous voyez qui peut m’être utile et agréable d’avoir. Vous qui disiez, ou aviez tellement peur que je reste ? jargeot (patois bourbonnais : quelqu'un qui parle souvent et qui est un peu simple d’esprit), vous voyez que je me suis décidé et que je sais encore bien choisir (le malheureux, il n’avait rien choisi) car Sylvia est parfaite à tous points de vue, moral et physique, très pieuse, croyante, dévouée, intelligente, de bonne famille et belle à damner un saint. Je me demande même si l’oncle Jean n’en est pas un peu jaloux. Enfin, il ne pensait peut-être pas qu’elle était si adorable, et elle a si bon cœur. Soyez assez gentille pour m’envoyer tout cela. Si vous avez cette photo de moi vers 9 ans avec mes cheveux bouclés, la même que celle qui était dans le grand salon en ovale. Ma femme à qui on a décrit cette photo voudrait tant l’avoir, ou le cliché si vous ne pouvez pas envoyer la photo. C’est bientôt ses vingt-et-un ans et je voudrais bien lui faire un grand plaisir. Je termine regrettant encore, mais ce sera pour plus tard que je vous présenterai mon trésor. Je vous embrasse affectueusement. Votre Jean. »
Cette lettre est à la fois pathétique et cocasse. S’ajoutant aux autres courriers qui ponctuent le parcours de cet ancien enfant placé, elle montre la psychologie fondamentalement inchangée, de l’écorché vif. On le voit encore tentant de s’accrocher aux quelques signes matériels qui avaient jalonné sa courte enfance auprès de sa mère, tout en estimant, paradoxalement, qu’il avait été un enfant gâté, vestige de la tentative de formatage des ecclésiastiques qu’il avait autrefois côtoyés. Ce qui montre qu’il avait bien tenté de s’approprier les codes de sa nouvelle famille et essayé de s’intégrer à son nouvel univers au sortir de l’assistance publique.
En fait, en le déplaçant de sa famille d’accueil jusque dans le château du Livradois, on lui avait assigné un rôle social dont il ne connaissait pas le texte, condamné ainsi à l’improvisation. Mais cela demandait du talent et ce garçon, démuni en fait, avait été condamné à ne se saisir que de quelques répliques à utiliser en cas de besoin, pour se défendre dans les situations où il se sentait agressé ou insécurisé. Sa vulnérabilité se traduisait par une agressivité patente, accompagnant le début de la mégalomanie dans laquelle il s’installera peu à peu. Bien entendu, le milieu où il avait été propulsé depuis l’âge de huit ans, favorisait cette folie des grandeurs. Mais aussi dans cette lettre, il fait l’éloge de sa jeune femme qui attendait son premier enfant. C’était à l’évidence un faire-valoir, démontrant à sa mère, qui le considérait comme un jargeot, un bon à rien, un dégénéré, qu’il avait réussi à se parer d’insignes de qualité : une femme parfaite, de haute naissance, belle, pieuse, généreuse. En fait, les marques de la distinction. Un bel objet à exhiber !
La publication des échanges épistolaires de cette période entre Cécile de Genévrier et son fils Jean de Genévrier nous dispense de longs commentaires, puisque ce duel par écrits interposés se suffit à lui-même pour rendre compte de l’inextinguible rapport de haine et d’amour insatisfait qui s’était installé entre la mère et le fils depuis des années.
Gardat, 25 décembre 1953. « Chère maman, Je ne vous ai jamais accusé réception du colis de vieux vêtements reçus. Cela ne valait pas vraiment pas la peine de les envoyer, ce sera tout juste bon à frotter les parquets. Nos domestiques n’en voudraient pas. Je pensais que le manteau de fourrure d’oncle Armand que j’avais mis en 1946 et même déchiré un jour lorsqu’il y avait les guides au clos, était toujours en état ainsi que les guêtres en cuir. Ce sont des choses qui ne s’abiment pas, à moins d’être dans un endroit très humide. J’ai vu dans les greniers de Genévrier des bottines ornées de dorures qui dataient de 1885, pas abimées. Pour ce qui est de ma photo ovale du grand salon, voulez-vous me l’envoyer, je la ferai rephotographier et je vous renverrai la vôtre. J’ai donné à V. les pellicules de mon mariage à retirer, je vous en enverrai une. En vérifiant mes comptes de fin d’année, je m’aperçois que je ne vous ai pas réclamé vos deux échéances d’assurances, celle de mai 1953 et celle d’octobre qui se montent chacune à 4 461 francs ce qui fait 8 922 francs que vous n’avez qu’à envoyer à Melle Tagournet à l’étude Delcroux. Nous avons fêté les 21 ans de ma femme avec sa tante de Liechtenstein qui lui a fait de beaux cadeaux. Je pense que vous avez passé la fête de Noël à Clermont. Je vous avez (Sic) fait une carte pour vous envoyer mes vœux. Je l’ai perdue. Aussi je vous envoie mes souhaits de santé pour 1954 et je vous embrasse. Jean »
Royat, janvier 1954. Cher Jean, Je suis bien en retard pour répondre à ta lettre du 25 décembre, mais suivant ton grand désir d’avoir pour offrir à ta femme la photo de ton jeune âge, je me suis mise en quatre pour la faire refaire. Je l’aurais (Sic) dans quelques jours et je te l’enverrais (Sic). Je suis fort étonnée que tu aies trouvé raisonnable et juste de me reprocher dans ta dernière lettre de t’avoir expédier (Sic) tes vieux vêtements, quand dans ta lettre datée du 23 octobre, tu m’en faisais la nomenclature (comme si je ne savais plus ce qui est à toi) et en me demandant de t’expédier le tout, ce que j’ai fais (Sic) immédiatement, non sans une grande peine de me séparer des derniers souvenirs de mon enfant surtout que je trouvais qu’en dehors des timbres et de tes quelques souvenirs d’enfance encore dans ta chambre, rien ne valait le port ; donc je n’accepte pas que tu m’en fasses grief. Contrairement à ce que tu peux penser, j’ai passé Noël en Livradois, car sans ma voiture, mes fermiers et conscierges (Sic) n’auraient pu aller à la messe de minuit, par contre je suis venue ici comme chaque année pour la messe de minuit du 1er janvier. Tu ne me donnes aucune nouvelle de la santé de ta femme, j’espère qu’elle n’est plus souffrante, je serais très heureuse d’avoir la photo de votre mariage. Je suis venue passer quelques jours dans mon appartement pour me remettre du gros surmenage que j’ai eu durant trois mois en Livradois. Je te joins à ces lignes le mandat pour couvrir les échéances d’assurances, comme tu ne m’indiques jamais ton numéro de C.C. postal, ce sont toujours les mêmes frais de l’envoyer à Melle Tagournet où (Sic) à toi, c’est pour cela que je te l’envoie directement. Je ne veux pas clore ces lignes sans t’envoyer mes meilleurs vœux de sainte et joyeuse année, surtout la santé pour vous deux et pour le petit enfant que vous avez demandé à Dieu, c’est du fond du cœur que je vous les adresse. Je t’embrasse bien affectueusement. Cécile de Genévrier. »
Quelques mois après, alors que sa première fille venait de naître quatre jours auparavant, Jean écrivit banalement à sa mère :
De la clinique, avril 1954 : « Chère maman, Je vous envoie ces quelques lignes en hâte pour vous faire part de la naissance de votre petite fille, survenue hier dimanche 25 avril à 11h45 pesant huit livres cinquante avec 12 jours d’avance sur la date présumée. La maman et sa fille sont en parfaite santé, la fille est une Genévrier pur-sang, portrait vivant d’Isabelle de Genévrier et de Mme de La Tremoïlle, très brune, aux yeux bleus, au teint très frais. Je termine ayant beaucoup de lettre à faire pour annoncer à tous les parents et amis l’heureux événement et vous embrasse affectueusement. Jean. »
Mais cet heureux événement fut loin d’éteindre la querelle filiale ; au contraire, il fut l’occasion de fourbir à nouveau les armes :
Gardat mai 1954. « Chère maman, Nous avons en effet été pris non par les mondanités mais par la famille de ma femme qui vient de partir seulement ce matin vendredi à 10 h ½. Notre petite Aurore a été en effet baptisée et nous avons fait ensuite une petite réunion de famille, où aucun ami n’a pu être invité, car un baptême est une fête familiale. Pendant l’été, nous donnerons encore une petite réception pour les amis. Nous avons été très pris et partions tous les après-midi à travers le pays pour faire connaître à nos cousins, oncles, tantes la région et les beautés de la France. Je reconnais que notre petite Aurore a été bien gâtée en couverts, timbales, chaîne d’identité, médaille, bracelets d’ivoire, etc… ??? , coquetier, la seule chose à laquelle personne n’a pensé encore c’est une assiette à bouillie. Mais si vos moyens ne vous permettent pas de faire ce cadeau, vous avez dans vos bijoux des objets divers, des choses qui peuvent servir à une enfant soit tout de suite, soit plus tard. Je veux en effet que lorsque ma fille arrivera à sa majorité et plus tard au mariage elle ait ses bijoux personnels, son argenterie. Quand vous vous êtes mariée, n’aviez-vous pas dentelles, bijoux, argenterie, etc… et si l’on a plusieurs enfants, je tiens à ce que chacun, fille ou garçon ait ce qu’il faut. Moi je me suis marié avec seulement ma chevalière. Je veux que mes enfants aient plus que moi-même. Je vous remercie du colis reçu à la clinique pour Anne. Comme elle est très forte et qu’il fait chaud, elle a déjà été mise en barboteuse et a étrenné votre petite Jacquette. Notre tante Leclerc lui a apporté aussi un petit trousseau qu’elle avait fait faire dans un couvent à Vanves (?) Nous allons avoir bientôt une pleine armoire de linge car des amis nous ont envoyé des petites robes, souliers, etc… Il est vrai que les enfants salissent beaucoup et qu’il faut toujours être prêt à les changer. Le général Christian de Castries qui vient de s’illustrer en Indochine était le cousin germain de notre tante Leclerc, aussi nous avons été très touchés de ce drame. Je termine, chère maman, vous remerciant à nouveau pour ma jolie petite fille et vous embrasse affectueusement. Jean ; P.S. : Nous vous envoyons par ce même courrier une boîte de dragées. »
Le Livradois, 23 mai 1954. « Mon cher Jean, J’ai bien reçu ta lettre il y a quelques jours à laquelle j’aurais voulu répondre autrement que tu m’y obliges, car ta mémoire semble te faire défaut. Tu me dis que tu t’es marié avec seulement ta chevalière ? Tu as voulu ignorer ta maman pour ton mariage, logiquement tu en as subi les conséquences, tu n’as qu’à t’en prendre à toi-même, car une mère doit compter avant tout dans le cœur d’un fils. Tu oublies qu’à mon mariage mon père ni ma belle-mère (l’Anglaise, seconde femme de son père) ne m’ont donné ni dentelle, ni argenterie, ni bijoux, seulement un coffre-fort d’occasion vide et des factures de mon trousseau, des comptes de tutelle. Tu oublies que j’ai dû vendre des bijoux pour vivre et payer les dettes de mon ex-mari. Tu oublies que je suis divorcée et que j’ai respecté l’usage de rendre à la famille de mon ex-mari l’argenterie que j’avais reçue. Tu oublies que j’ai dû vendre ce qui me restait de valeur pour payer ton instruction, t’élever jusqu’à l’âge de 18 ans. D’autre part, si j’avais eu des bijoux, ce n’est jamais l’usage que d’autres que le parrain et la marraine en offrent. Tu m’écris que le baptême étant une fête strictement familiale, donc seul (Sic) la famille y assistait, j’en conclus que ta mère n’est pas la famille… elle sera peut-être invitée à la réception des amis que tu comptes donner cet été ??? mais je ne suis pas dans cette catégorie. Mon cher enfant, à l’avenir évite d’écrire à chaque fois des choses blessantes à ta maman, chacune de tes lettres en contient car il m’est très dur de toujours remettre les choses au point (elle avait écrit initialement : de te rafraichir la mémoire). Je ne doute pas que ce que je pense t’envoyer, travail de mes mains (elle avait initialement écrit : de mes doigts) n’a pas la valeur de ce qui est fait par des professionnels. J’ai toujours considéré dans les cadeaux reçus l’intention du cœur et non la valeur vénale. Lorsque tu m’auras présenté ta femme et ta chère petite fille, à ce moment je lui offrirai mon modeste cadeau. J’espère que la jeune maman se remet bien de ses couches et que la petite Aurore se porte à merveille. N’aurais-tu pas une photo à m’envoyer. J’attends toujours celles promises de ton mariage. Je vous embrasse tous trois affectueusement. Ta maman. PS : je te remercie beaucoup pour les dragées qui étaient très bonnes, la boîte est très belle. »
Gardat, novembre ou décembre 1954. « Chère maman, Je vous écris ces simples lignes pour vous demander de vos nouvelles et pour vous signaler que votre prime d’assurance auto est à échéance depuis octobre 1954 et s’élève à quatre mille quatre cent soixante-neuf (4 469 francs). Si vous pouviez me l’envoyer sans trop tarder, je l’enverrais de suite avec les autres que j’ai en retard. Nous nous sommes absentés pas mal ces derniers temps et avons fait un très beau voyage en Belgique où ma femme a des parents. Nous avons passé quelques jours chez sa tante l’Impératrice Zita (symptôme de sa mythomanie), qui est d’une bonté fantastique et qui en a tant vu. Elle a beaucoup admiré Marie-Germaine et lui a souhaité de nombreux petits frères et petites sœurs, de faire comme son fils Otto de Habsbourg qui vient d’avoir des jumeaux. Moi pour ma part, je trouve qu’un à la fois suffit, je ne vois pas comment on installera la voiture avec un tout petit et Anne, qui est encore trop jeune pour rester assise pendant plusieurs heures en auto. Elle n’aura guère que 14 mois maximum quand le petit frère viendra au monde. Nous nous sommes arrêtés en revenant chez le cte et la ctesse de Paris, elle est la cousine germaine du père de ma femme (symptôme de sa mythomanie), quelle belle famille, onze enfants, tous en bonne santé et les plus jeunes courant sur les pelouses qui entourent la propriété ; ils doivent venir dans la région et nous faire une surprise. J’espère bien qu’ils ne viendront pas tous à la fois, car la maison serait vite trop petite. Mais que ce soit les uns ou les autres, ils sont charmants de simplicité. Mon beau-père doit arriver ces jours-ci. Nous nous entendons très bien. Il aime beaucoup la campagne et la France et parle douze langues et compose de la musique, aime beaucoup les vieilles ruines et le calme qui les environne. Il me rapporte des têtes de rennes avec leurs bois superbes pour faire un râtelier pour mes fusils de chasse. C’est dommage que vous n’ayez le grand cor de chasse que vous aviez, il aurait bien arrangé le tout. Il faudra qu’au cours de l’été, je puisse aller en Livradois voir votre menuisier, je voudrais lui faire faire des petites commodes et armoires pour les enfants futurs ainsi que des tables et chaises alsaciennes pour eu, qu’ils aient leur pièce avec leurs meubles. J’espère que vous êtes en bonne santé et que l’hiver n’est pas trop rigoureux. Je termine, car le facteur est là. N’oubliez pas mon assurance, 4 469 francs ; Je vous embrasse affect. Jean »
Alors, l’ex-petit Jean, devenu Jean de Genévrier, nouvellement père de famille, se révéla pleinement dans le mensonge – plutôt la mythomanie –et la fanfaronnade, son alliance avec une authentique aristocrate aux belles ascendances lui étant monté à la tête. Tandis que sa première fille Marie-Germaine de Genévrier venait de naître, il répondit à sa mère, à la machine, en exprimant envers elle son intime, profond et constant ressentiment qui traversera sa vie. Il se persuada – et voulu persuader sa mère, être par son père naturel, le petit-fils d’un avocat célèbre. Or ce grand-père paternel, mort à soixante ans le 14 février 1919 à Genévrier, ne fut absolument pas qualifié d’avocat sur son acte de décès.
On a beau laver la caque, elle sent toujours le hareng
Il sème à tout vent
La vie familiale que Jean de Genévrier et sa femme Sylvia avaient récemment inaugurée par leur mariage en 1952 et la naissance de leur fille Marie-Germaine, allait s’étoffer en donnant naissance à quatre autres enfants jusqu’en 1959. Mais de quoi ces événements familiaux étaient-ils annonciateurs ?
Rappelons que, en réalité, le couple et les enfants n’étaient pas chez eux ! Par la faveur marchandée de Françoise, ils occupaient l’hiver la maison du bourg où Saurat avait eu son étude d’avoué et l’été la folie de Gardat. L’avoué y étant mort à quatre-vingt-deux ans, c’était sa fille, Françoise qui en était désormais propriétaire. A la naissance du dernier enfant des Genévrier, une fille, en 1959, elle avait donc cinquante-huit-ans. Jean de Genévrier en avait trente-huit et Sylvia vingt-sept ans. Oui, cette famille de sept personnes – les Genévrier – n’était pas chez elle ! Pourquoi ?
Dans la lettre du 28 mai 1954, qui débute le présent récit, les personnages – le casting – étaient là, en place pour jouer la pièce dont Françoise Saurat avait imaginé le scénario. Cette situation était née de son tortueux plan, probablement d’abord avec l’assentiment de Jean de Genévrier, de faire des enfants du couple ses propres enfants, prétextant qu’ils seraient ainsi ses héritiers. En effet, les parents étaient alors dépourvus de biens personnels : Jean devait attendre la mort de sa mère pour hériter du château et des terres du Livradois et sa femme ne pouvait prétendre qu’à un chimérique héritage des importants biens d’Europe Centrale. Ils étaient ainsi vulnérables devant les alléchantes propositions de Françoise Saurat dont la fortune était alors bien réelle avec sa folie en forme de château, agrémentée d’un beau parc, sa forêt longeant une rivière sur plusieurs kilomètres, son cours de tennis, ses domaines et leurs cheptels, ses grandes maisons de ville…
Pour légitimer son but insensé, elle exhibait la généalogie de Sylvia, éminent argument de son projet. Elle avait toujours à portée de main deux documents constituant le fer de lance de son action assidue de conquête d’une position de mère de substitution : d’une part, les tableaux généalogiques de Sylvia la montrant descendante, peu éloignée des rois de Danemark, de Pologne, des princes Lichnowsky ou Khevenhüller-Metsch et, d’autre part, le plan de toutes ses propriétés de Gardat dessiné sur une espèce de toile imperméable. Dès 1959, elle y avait porté des annotations précisant ce qui reviendrait à sa mort aux uns et aux autres des enfants Genévrier, selon un principe archaïque en usage dans la prétendue aristocratie !
La vie familiale s’était établie, prenant – en apparence – des airs de normalité. Mais tout cela était de la poudre aux yeux. Jean de Genévrier se révéla tel qu’en lui-même. Dans la grande maison de ville, Françoise Saurat avait loué un appartement à la directrice du laboratoire de biologie du bourg. La quarantaine, divorcée, mère de deux filles de douze et quatorze ans. Pour un pervers narcissique, c’était une proie accessible et facile. Elle devint rapidement la maitresse de Jean de Genévrier, sous le même toit que sa femme, au vu et au su de Françoise Saurat. D’ailleurs, il l’épousera des années plus tard. La pauvre Sylvia dut supporter offenses sur vexations, se réfugiant parfois dans quelques passions platoniques pour échapper au désespoir. Mais les turpitudes de l’ancien enfant placé, devenu un adulte instable, ne se limitèrent pas à ces avanies. Il entretint parallèlement à son mariage et à son concubinage effectif, une relation adultérine avec la femme du médecin d’un village voisin de Gardat. De cette femme, de cinq ans sa cadette, il eut une fille, Marie-Claude, quasiment du même âge qu’un des enfants Genévrier. Etait-ce suffisant pour noircir le tableau ? Non, il fallut qu’il en rajoutât ! D’une autre femme, une certaine Chouchou, il eut une autre fille. Il serait difficile d’énumérer les jeunes bonnes, employées de maison provisoires de Françoise, qui subirent ses incessants harcèlements.
Non contents de se complaire dans la débauche, Jean de Genévrier, sa maîtresse et Françoise Saurat, sans doute pour alléger leur mauvaise conscience, crurent nécessaire de souiller Sylvia d’ignobles soupçons d’infidélité répétée. Ces mœurs dont les enfants étaient naturellement les témoins, furent banalisées. Et, effets logiques en éducation, ils en seront ultérieurement de joyeux imitateurs. Même, le plus jeune des fils de Jean de Genévrier ira jusqu’à s’inventer une paternité illégitime avec un châtelain du voisinage, s’imaginant ainsi s’approprier une noblesse dont il est totalement dépourvu, tout en contribuant à salir sa propre mère et ridiculiser son père ! Les enfants Genévrier n’auraient-ils hérité que de l’ignominie de leur père et de leur mère adoptive ? La succession des biens, elle, plus de vingt-cinq ans après la mort de Françoise Saurat, n’est toujours pas complètement réglée, la fratrie s’entredévorant. En revanche, la transmission du pire est bien effective !
Connivence coupable, Françoise Saurat chaperonnait le tout. Cherchait-elle à se venger de n’avoir été qu’un accessoire dans le parcours de Jean, de l’assistance publique à son mariage et dans la naissance de ses enfants ? En tous cas, elle voulut parfaire son œuvre en adoptant la fratrie Genévrier, ultime expression de la bonté chrétienne dont elle se gargarisait. N’était-elle pas la marraine de la première-née du couple, légitimant ainsi son ascendant sur cette famille ? L’adoption des cinq enfants d’un an et demi à sept ans eut lieu en 1961, se traduisant par l’adjonction du propre nom de Françoise au nom des enfants qui devinrent ainsi Genévrier-Saurat. L’œuvre était-elle achevée ? L’intention aurait pu être louable, si Françoise Saurat n’avait considéré que la transmission généreuse de ses biens, puisqu’elle était sans postérité. Ce ne fut pas le cas. Des années plus tard, Jean de Genévrier, dans une longue lettre adressée à Françoise Saurat, avouera avoir été naïf de croire à ses bonnes intentions en précisant que Sylvia, elle, plus psychologue que lui, avait vu juste en s’y opposant.
Pour une approche de la personnalité de Françoise Saurat, il faut savoir qu’au 19ème siècle sa famille paternelle comptait essentiellement des cultivateurs dans un petit village bourbonnais et qu’à la naissance de son père, en 1870, son grand-père était déclaré comme maçon et n’avait pas su signer. Devenu avoué et homme d’affaire des Genévrier, on peut remarquer que ce fut une belle ascension sociale qui souvent, s’accompagne d’une certaine mégalomanie.
Mais la contestation de Sylvia avait été vaine et, pour survivre, elle ne put envisager que la fuite, dépossédée qu’elle était de son rôle de mère et d’épouse ! Dans cette lettre, Jean de Genévrier reconnaît avoir été berné par Françoise Saurat, tout en passant sous silence ses propres abjections. Et Sylvia, le cœur brisé, décida de s’arracher à cette insupportable situation. En 1966, elle quitta Gardat pour aller se réfugier dans une ville d’eaux proche, où elle dut travailler pour subsister et demanda la séparation. Complètement abattue, elle alla à Paris trouver de l’aide auprès de son frère et de sa belle-sœur, nièce du maréchal Leclerc. Son état psychologique était grandement altéré et son frère, ulcéré, écrivit le 20 décembre 1966 à Jean de Genévrier :
« Mon cher Jean, Etant donné la gravité de ce que j’avais à vous dire, j’ai été déçu de ne pouvoir vous joindre au téléphone comme convenu hier à 20h, ni à G., ni à Gardat. J’ai multiplié les appels à Gardat (votre fille A. m’ayant dit que vous y étiez) jusqu’à ce matin, mais ceci sans succès. Je viens vous donner mon conseil formel de venir ici à Paris de toute urgence voir Sylvia et la ramener avec vous dans son foyer. Elle a abandonné enfin son projet de procédure en séparation et est prête à rentrer du moment que vous l’accueillez avec affection auprès de ses enfants. Je suggère que vous lui téléphoniez au plus vite chez Melle Valentin pour arranger son retour. Il faut qu’elle passe Noël avec ses enfants. Cette brouille actuelle ne doit pas durer, elle risque d’avoir un effet terrible pour les enfants plus tard. De plus, je dois vous dire qu’à mon avis toute cette aventure peut finir très mal dans un avenir proche avec des conséquences irréparables pour les enfants. Sylvia semble être en très mauvais état de santé, et je ne pense qu’elle puisse tenir longtemps dans son état actuel. Vos enfants n’ont que Melle Saurat qui est tout de même âgée, et vous deux ; il faut donc que vous vous regroupiez tous les deux autour de vos enfants et que vous trouviez un modus vivendi entre vous. La situation actuelle est tragique et je crains les pires issues pour Sylvia. Ceci rejaillirait sur les enfants et sur vous-même et votre nom ; elle ne demande plus la séparation et donc vous êtes responsable d’elle. Il faut la ramener près des enfants et éviter les catastrophes. Contrairement à ce que vous pensiez au téléphone hier, je me suis toujours opposé à ces projets de séparation et encore plus évidemment de divorce dont il n’a je crois jamais été question. Quand Sylvia s’est plainte de torts que vous auriez eu (Sic) envers elle, je lui ai dit que la loi protégeait les mères de 5 enfants évidemment et qu’elle devait rester auprès d’eux et n’avait rien à craindre. Quand elle m’a dit qu’elle voulait travailler, je lui ai dit que c’était une bonne idée à condition qu’elle restait (Sic) près des enfants. Je me suis toujours opposé absolument à cette idée folle de séparation et l’ai apprise une fois que les démarches étaient faites. Je l’ai aidé (Sic) ensuite ainsi que Tante M. quand elle était à V. pensant que ceci serait une période temporaire et que vous feriez un arrangement ensemble. C’est envers et contre mon avis qu’elle a refusé la conciliation, et sans que je le sache qu’elle a quitté V. brusquement pour venir ici. Elle aurait maintenant une situation auprès d’une maison qui fournit du personnel de remplacement. Mais ceci est une folie. Il faut que cette fugue cesse. Elle est prête à rentrer. Venez lui parler et pour l’amour des enfants entendez-vous ensemble. Renvoyez vos torts dos à dos et trouvez une solution de vie qui préserve l’avenir des enfants. J’ai longtemps sermonné Sylvia et dans les 2 cas, je ne peux faire qu’appel à votre bon cœur. Mais en plus je vous répète que si vous ne profitez pas du fait qu’elle retire sa procédure maintenant et veut rentrer, vous risquez très gros car Sylvia est dans un état que je trouve très inquiétant. Je vous demande donc de prendre contact avec elle au plus vite. Je vous demande d’agir tout de suite, au moins pour vos enfants. Amitiés. K. »
A la lecture de cette lettre, Jean de Genévrier ne pouvait qu’être pris à son propre piège. Depuis son enfance, en tous cas depuis son arrivée à huit ans en Livradois, il avait appris à ruser, confronté aux arguments spécieux de sa mère et de la famille de Genévrier, des éducateurs et des enseignants religieux. Mais à la lecture de cette lettre, il ne pouvait plus manœuvrer, bien que le frère de Sylvia s’y présentât en défenseur des valeurs familiales et de la soumission de la femme aux règles de cette époque. N’oublions pas qu’on était en 1966, il y a près de cinquante-sept ans. Sylvia venait tout juste d’avoir trente-quatre ans et Jean allait avoir quarante-six ans. L’âge de leurs cinq enfants s’étalait de cinq à douze ans ! Françoise Saurat, soixante-cinq ans, matriarche névrosée, régnait sur une famille qu’elle avait contribué à disloquer.
La vie des uns rendit infernale la vie des autres. L’ex petit Jean se vautrait dans l’adultère sans vergogne, sa maîtresse biologiste se pavanait, Françoise se régalait de la zizanie. Prisonnier de sa débauche, Jean de Genévrier tentera de violer la plus jeune fille de sa maîtresse. Qu’en était-il des enfants ? La fille de Saurat avait mis le grappin sur eux, jusqu’à les priver d’une scolarité normale dans les établissements du voisinage, en prétendant assurer simultanément les cours de niveaux différents. La différence d’âge entre la plus jeune et la plus âgée était de six ans, ce qui expliquera le faible niveau scolaire de la fratrie Genévrier. Seul le fils aîné obtint laborieusement le baccalauréat pour suivre péniblement une année en I.U.T., ce qui ne corrigea pas une piteuse orthographe que déplorera Jean de Genévrier dans une lettre adressée à Françoise Saurat le 5 mai 1987. Ce travers subsiste des décennies plus tard.
Envers et contre les recommandations faciles de son demi-frère, Sylvia ne renonça pas à se libérer de cet enfer où régnait l’indignité. Elle quitta Jean de Genévrier – l’ancien assisté se prévalant de noblesse et d’un titre de baron, croyant que c’était le dernier rempart contre une vulgarité innée – et ainsi elle dut renoncer à vivre sa vie de mère auprès de ses enfants, devenus par la malignité de Françoise Saurat, des enfants Genévrier-Saurat.
Parlant relativement bien l’allemand (langue usuelle de son enfance), et peu ou prou l’anglais et l’italien, pour survivre, elle travailla dans l’hôtellerie de standing et dans un magasin de maroquinerie, de juillet à octobre 1966, puis de juillet à décembre 1967. Il est vrai qu’elle fut aidée par l’entregent d’Ivan Loiseau (1892-1981), titulaire de plusieurs prix littéraires, commandeur de la Légion d'honneur, qui était alors secrétaire général de la Compagnie fermière de Vichy. Il sympathisait avec Sylvia car sa propre mère était une aristocrate croate. Elle partit alors pour une ville d’eaux proche de Clermont-Ferrand où elle fut accueillie par deux amies qui joueront un rôle certain dans sa vie jusque dans les années 90. Ainsi, début 1968 rencontra-t-elle celui qui deviendra son second mari pendant près de vingt-trois ans et dont elle aura deux enfants. Cependant, elle dut compter avec l’esprit tortueux de Jean de Genévrier. Par tous les moyens, parfois les plus vils, il voulut s’opposer à la nouvelle vie de Sylvia. Ce fut vain. Elle demanda le divorce qui fut effectif en 1971 et prononcé aux torts et griefs réciproques, Sylvia ayant reconnu sans difficulté avoir refait sa vie, selon l’expression consacrée, depuis 1968. Bien entendu, son second mari entreprit les démarches auprès de la mairie de Wiesbaden où était née Sylvia, pour que soit finalement rectifié son état civil erroné depuis 1935, et que soit célébré leur mariage civil à Chamalières en 1971 et religieux en 1972, au temple protestant de Clermont-Ferrand. Lux ex tenebris invictus, la lumière triomphe de l'obscurité !
Pour régulariser sa situation à l’approche du mariage de sa fille aînée prévu pour décembre 1977, Jean de Genévrier se maria en novembre avec celle qui était sa maîtresse de longue date. Mais le mariage de sa fille fut encore pour l’ex-petit Jean, l’ancien assisté, l’occasion de tenter de jouer les paons. Lors d’échanges épistolaires postérieurs, Jean étalera la perversité de ses relations avec Françoise. Il était vrai qu’elle le discréditait cruellement. Lui ira jusqu’à reprocher à celle qui lui avait mis le pied à l’étrier social de ne l’avoir « considéré que comme un fainéant, un incompétent, un malhonnête », mais aussi d’avoir mis la main sur ses enfants. Il aura la franchise tardive de reconnaître que Sylvia avait été utilisée pour servir, il aurait dû préciser avec son propre et lâche assentiment, le plan maléfique de Françoise Saurat à qui il écrivait sept ans après son divorce :
11 novembre 1977. « Si en juillet à notre retour de vacances, la coupe était pleine, pour moi il y a très longtemps qu’elle déborde, non point par le fait de mon incompétence, de ma fainéantise ou de ma malhonnêteté, mais tout simplement par l’excès de mufleries dont je suis l’objet depuis des années, que j’ai fait semblant d’ignorer pour les enfants pour lesquels j’ai eut (Sic) le tort d’accepter une adoption dont Sylvia plus psychologue que moi ne voulait pas. Je l’ai laissée faire te croyant sincère et loyale quand tu disais que tu ne ferais rien pour les enfants sans mon avis, mais ce qui t’importait avant tout, c’était d’imposer ton despotisme, de m’avoir à ta merci en faisant verser les allocations en ton nom et en me privant ainsi même de l’argent des cigarettes. Je paie les études, je suis père et mère et tu n’es rien, un être bon à rien, recueilli par charité, n’ayant jamais voulu faire d’études, incapable de diriger les enfants, de garder ta femme… (C’est ainsi que Françoise Saurat manifestait sa mégalomanie, se prenant pour une femme-orchestre, dépossédant Jean de Genévrier et Sylvia de leurs liens parentaux légitimes) Hélas, je n’oublierai jamais les scènes de Chenonceau et de Noirmoutier, de Gardat, des Beaux, etc, etc… où l’on ne pouvait jamais être seuls (Sic), même pour aller à la chasse, où on ne pouvait accepter un dîner chez des amis parce que Mademoiselle n’était pas invitée, alors la voiture ne sortira pas. Les scènes je m’en souviens trop bien et Melle Crochet venant prévenir que Sylvia était capable de mettre du poison dans ton assiette, etc, alors ce n’était, elle, qu’une propre-à-rien, une aventurière, une parvenue, une hystérique, une voleuse, etc, etc. Je dois en passer car il faudrait deux blocs de papier à lettre, même pour recopier certains carnets que j’ai écrit, gardé de 1952 à maintenant (1977), c’est du reste ce qui me permet parfois de vérifier certaines choses, car moi, je n’ai pas la possibilité de changer les événements ni les faits suivant l’inspiration du moment. J’ai donc fait une grosse bêtise de faire ou laissé (Sic) adopter les enfants. Les allocations t’ont permis pendant 18 ans de payer celle de la propriété et surtout de me dire ce sont mes enfants, fou (Sic) le camp, je n’ai pas besoin de toi. En effet, C. s’occupe depuis deux ans de ta comptabilité que tu as reprise complètement en mains (Sic) depuis novembre 69, 8 ans déjà. Il était du (Sic) a (Sic) l’époque 120 000 de vétérinaire à B. et 300 000 de charges sociales, c’est tout et vous alliez alors deux fois au bord de la mer… Pierre avec l’argent que j’ai fourni, sauf les 35 000 de sable ou ciment que tu as payé sur des millions encaissés depuis juillet va pouvoir habiter les ruines du vieux château et faire l’imbécile pour payer les allocations familiales, les impôts d’une trentaine d’hectares (autant de moins pour toi) avec 20 moutons de capital, en lui louant de plus les terres ou (Sic) sont tes moutons. Où les mettra-tu (Sic) les tiens s’il veut y mettre ceux qu’il achètera en empruntant puisque tu n’es pas capable de lui donner ceux que tu as. Tu as à ta charge C. et I., A., le pauvre paiera longtemps ta faiblesse envers lui, car il est malin comme un singe, il est intelligent, il comprend tout, en effet c’était le portrait de sa mère. Je le plains beaucoup et l’aiderai tant que je pourrai lui aussi, parce que pour toi, tu l’as écrit à Mtre Robert Champagne, un seul t’intéresse, C. Ma petite A. se jette dans la fournaise, elle étouffe dans cette maison sale, désordre, sans heure, sans direction, ou (Sic) les pommes, le sucre, le chocolat, le plan de la propriété, les factures, les slips sont sous les couvertures. Bel exemple pour les enfants. N’est-il pas plus facile de tout jeter au milieu de la pièce, de traiter les gens de tarés, de dégénérés, etc. que de beaux discours, tous ces médiocres qui eux ne s’abritent pas derrière la religion, derrière une speudo-charité (Sic) plus qu’ostentatoire, car qu’as-tu fait pour acquérir ce que ton père t’a donné en mourant et quel était en 1948 ton cri d’angoisse quand H. qui est toujours à V. venait par l’entremise de Mme de Villa pour acheter Gardat ? Que de faits oubliés ou faits passés pour inventés ou transformés, beaucoup de témoins sont hélas disparus, sauf 2 qui ont vécu ces heures et même s’en souviennent sans compter ce qui est écrit. Depuis plus de trois ans, je n’ai plus pleuré pour avoir l’argent de l’essence pour monter à Gardat soigner les bêtes avec les moyens du bord, surveiller les moutons, tailler les haies, élaguer les arbres, labourer et quand le moment de vendre les bêtes, moutons ou autres arrivait, toi tu encaissé, moi je paie fuel, ficelle, botteleuses, lames de faucheuses, tronçonneuse, chaînes, traitement des moutons, tondeuses, aiguisage des peignes, outils, huile, aiguisage des socs, etc. pas avec l’argent que je t’ai soi-disant volé, non je ne t’ai pas volé de bêtes, même cette année pour partir en vacances. Le 12 mai, ma mère m’avait reversé 500 000 sur une vente que j’avais faite de bois. J’ai le reçu de la banque à ta disposition. De même que les reçus des autres chèques ayant servi pour le vieux château, car j’ai quand même, comme C., quelque chose des Genévrier. J’inscris tout, même les cigarettes, l’essence, le whisky, les assurances, etc. La petite tronçonneuse était passée sous le gyrobroyeur en mai en nettoyant les côtes du domaine du S. J’ai eu à payer 76 200 de réparation, personne ne viendra te les réclamer. La robe de mariée d’A. je l’ai fini de payer 111 600 et Mtre M. 50 000, j’en ai honte moi, aussi je vais lui rembourser. Haïr les gens comme tu le fais, crier bien fort, hurler pour les empêcher de parler, quels arguments bas et vulgaires pour quelqu’un qui donne sans cesse des leçons d’éducation, d’honnêteté, de morale. Pour ma petite A., je la voudrais heureuse, car il y a longtemps comme Isabelle qu’elle ne sourit plus, mais P. bien que très gentil n’a pas plus de situation que bien d’autres et moins d’expérience et de force. Tant que Mtre M. vivra (il se suicidera le 9 février 1978) il tiendra. Peut-on avoir toute une vie heureuse, la mienne l’est quand je suis seul avec Yvette loin des soucis de voir cinq enfants tristes, égarés sous une coupe sans envergure, idéaliste à sa manière. Pour ce mariage, toutes les malhonnêtetés auront été faites. 1°) aux fiançailles, les histoires Sylvia qui si Jean de C. et Antoine de la B. avaient voulu ne serait pas D., peut-être même B. ou A. ou K. ou tant d’autres. 2°) les places à table, Y. entre I. et A. Maintenant les faire-part commandés sans me les montrer. Tu paies. Je pouvais aussi les payer. Ils coutent moins chers que les travaux du vieux château, la robe d’Anne ou l’essence tous les jours pour aider mon P. Tu les as adoptés pour leur donner des ruines. Tu devais tout payer. Quels reproches indirects à P. d’avoir acheté 20 000 francs de chaux et de ciment, alors qu’on en a utilisé 68 000 + le plâtre +5 000 kg de sable supplémentaire. Pour le mariage (il eut lieu le 17 décembre 1977, un peu plus d’un mois après cette lettre), je ne sais si nous irons. Le fiasco pour ton bonheur sera complet, car ma mère que tu le veuilles ou pas a droit au titre de son père ou de sa mère, ctesse autant que la ctesse S-D. Officiellement, Y. est ma femme, avec contrat déposé. Nous ne tenons pas à faire les figurants grotesques dans ta pantomime. Depuis des années, je ne te coûte que quelques bouchées de pain à midi et depuis des années tu t’escrimes à me rabaisser devant mes enfants : ‘votre père est un fainéant, un pauvre type, un propre à rien’. Si je reviens t’importuner à Gardat c’est pour mes enfants. Toi tu es vierge, gloire à toi, mais je ne les abandonnerai pas à ta volonté. Tout se décide hors de moi. Tant pis. Je ne leur dis rien. Ils comprendront bien vite et ont déjà compris mon attitude. Ils jugent et ne disent rien. La plus triste est « B », belle, intelligente, douce, sensible, une petite sainte et pourtant bien malheureuse, sans un sou le lundi, que des vêtements de ses frères et sœurs, mais elle ne dit rien. Puisse-t-elle sortir aussi bien vite de cette tristesse. Je termine aujourd’hui ce journal, mon A. vient d’arriver, nous allons le faire manger et dormir en paix. »
Cette lettre rappelle le contenu et le ton de celles que Jean de Genévrier écrivait à sa mère quelques vingt ou trente ans auparavant. Décidément, cet homme – malgré les titres de baron ou de vicomte dont il avait tenté indument (par ignorance plus que par snobisme) de s’affubler sur les faire-part de son mariage avec Sylvia, elle, authentique comtesse – ne se dégageait pas de la gangue dans laquelle sa mère l’avait engoncé en l’abandonnant en mars 1921. Mais le mariage arrangé de sa fille aînée avec le fils d’un notaire fut vite assombri par un triste et violent événement. Moins de deux mois après la fête nuptiale, le beau-père fut découvert dans une chambre d’hôtel. Il s’était brulé la cervelle ! Un scandale éclata : lui et sa famille, femme et enfants, avaient détourné des centaines de millions de francs. Trois des survivants furent condamnés et emprisonnés.
Pour tenter de bien comprendre la psychologie chaotique de Jean de Genévrier, la lecture des ouvrages de Boris Cyrulnik est recommandée.
Comme on fait son lit on se couche !
Après de départ de Sylvia, après le divorce, après son remariage avec sa maîtresse, son installation dans la maison de sa nouvelle femme, à quelques kilomètres seulement de Françoise Saurat, la nature de la vie de Jean de Genévrier, l’ancien enfant aux trois prénoms, fut conforme à ses choix : whisky quotidien et libertinage. Ses enfants se marièrent, s’éloignèrent, s’opposèrent violemment tant devant les tribunaux que physiquement. Ils se marièrent entre 1977 et 1982, certains fuyant les lieux où ils avaient été témoins de tant d’abjection. Ils eurent des enfants et l’ancien garçon placé fut ainsi grand-père de dix-sept petits-enfants. Pour gagner quelque argent et avantage, il fit des va-et-vient entre son nouveau domicile et la proche propriété de Françoise Saurat où il effectuait des travaux agricoles, tentant de se constituer une retraite.
Paradoxalement, Françoise Saurat accueillera plusieurs fois dans sa propriété de Gardat, Sylvia et son second mari et leurs deux enfants en décembre 1977, en avril et juillet 1982, en avril et juillet 1983. Au lieu de cultiver la rancœur, Sylvia, généreuse, portée au pardon, avait rangé ses griefs dans un coin de sa mémoire.
Les rapports de Françoise Saurat et Jean de Genévrier s’envenimèrent. Elle alla jusqu’à l’accuser de violences physiques, prévenant son notaire qu’il pourrait arriver le pire. Certains des enfants Genévrier se comportèrent envers leur mère adoptive à l’instar de leur père. Cécile de Genévrier et Françoise Saurat vieillissaient ; Jean de Genévrier et sa nouvelle femme buvaient immodérément. La maladie s’installa. L’ancienne maîtresse de Jean mourut relativement tôt, à soixante-et-onze ans. Cécile finit sa vie à plus de quatre-vingt-douze ans à l’hôpital bitord, au terme d’une existence ponctuée par de perpétuels affrontements avec son fils. Elle laissa au petit Jean, la propriété du Livradois, mais aussi de nombreuses dettes. Françoise, elle – maltraitée tant par celui, le petit Jean, à qui elle avait mis, quarante-cinq ans auparavant, le pied à l’étrier social que par ses enfants adoptifs – fut écartée de ses propriétés et abandonnée en maison de retraite. Elle mourut également à plus de quatre-vingt-douze ans. Commença alors la lutte fratricide des enfants adoptés, lutte qui n’a pas encore trouvé d’issue définitive.
Mais l’enfant aux trois prénoms, le petit Jean, alias Jean de Genévrier, pu, enfin, à la mort de sa mère, s’installer dans le château du Livradois et jouer – difficilement, compte tenu de ses revenus réels – au châtelain, lui qui en avait tant rêvé pendant des décennies. Les relations avec ses enfants et même ses petits-enfants furent des plus difficiles. Certains de ses enfants et beaux-enfants allèrent jusqu’à le mener en justice. La transmission du pire était ainsi accomplie !
La fin de l’enfant aux trois prénoms fut triste : abandonné par sa progéniture, alors que sa santé était chancelante puis déclinante, il dut s’entourer d’aides extérieures dès 1996. Il mourut à soixante-dix-neuf ans dans un triste état à l’hôpital bitord, le 12 janvier 2001, en ayant eu la délicate attention de prendre des dispositions avantageuses à l’égard de celles qui l’avaient accompagné dans sa fin de vie. L’enfant aux trois prénoms, fils de personne, le petit Jean, mourut dans la vacuité d’une identité jamais revêtue.
Porteur du pire, ses enfants contestèrent aussitôt les dispositions prises par leur père et, par les moyens les plus bas, tentèrent de faire annuler les volontés de leur géniteur. On peut déplorer que la fin de vie du petit Jean ait été aussi triste – à cause de ses enfants – qu’avait été le début de sa vie, à cause de sa mère et des Genévrier.
Epilogue
Aurait-on pu écrire le même récit pour chacun des innombrables enfants abandonnés à leur naissance ? Nous ne le pensons pas. Le parcours du petit Jean, né de père et de mère non dénommés, puis – par le vouloir d’une jeune femme repentante – devenu Jean de Genévrier, est singulier, spécifique même. Nous pouvons nous poser nombre de questions sur la destinée de ces enfants. S’agissant de Jean de Genévrier, laissons-nous aller à une certaine uchronie et posons-nous des questions simples mais dont les réponses sont malaisées.
La vie de chacun étant soumise, selon ses conceptions, à la contingence ou à la nécessité, trois scénarios étaient possibles. Selon le premier, il n’aurait pas été abandonné, Cécile de Genévrier et Jacques de Cangis se seraient mariés et cet enfant aurait été légitimement, dès sa naissance, Jean de Cangis. Selon le deuxième, Cécile de Genévrier et Eloy Taznal auraient eu un enfant viable comme ils le souhaitaient, le petit Jean n’aurait donc pas été récupéré et aurait vécu ce que la plupart des enfants abandonnés et placés vivent. Le troisième scénario est celui qui lui a été imparti, se traduisant par les rôles qu’il a effectivement joués ; il est devenu une victime puis un tourmenteur, parfois les deux simultanément.
Assurément, notre destin n’est pas – heureusement – l’objet de la machine à remonter et à redescendre le temps, satisfaisant ainsi nos fantasmes. Cependant, qu’on le veuille ou non, la part de déterminisme génétique, l’atavisme, qu’elle soit biologique ou psychologique, et la part dépendant de notre libre arbitre fabriquent notre personnalité, constituée assez souvent de bric et de broc. Et elle nous dévoile, en définitive, notre finitude, notre incomplétude.
Soixante-et-un an après l’avoir libéré, l’administration, ignorante de la psychologie de ses administrés, avait ranimé chez Jean de Genévrier le syndrome d'abandon. En effet, n’avait-il pas reçu de la DRAC, le 25 mars 1991, alors qu’il venait d’avoir soixante-dix ans, une lettre adressée sous son patronyme d’enfant abandonné, soit le troisième prénom ?